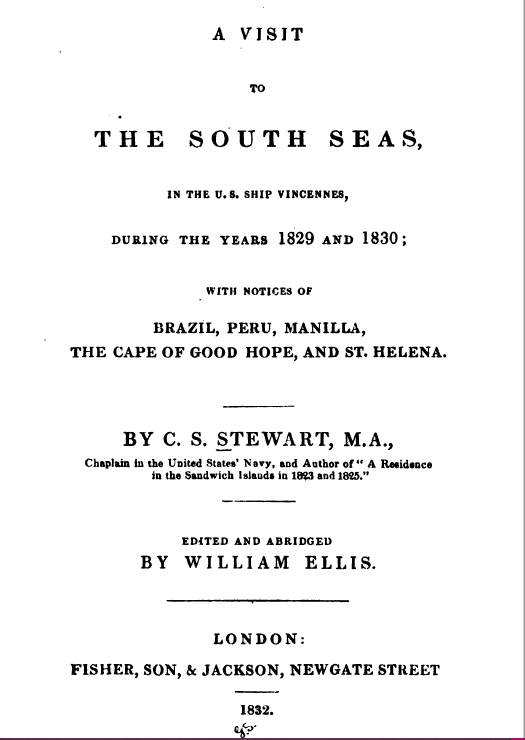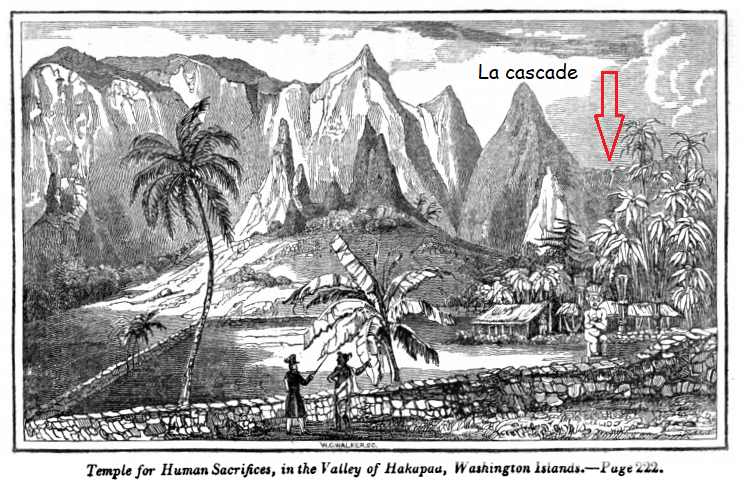1829 - A VISIT TO THE SOUTH SEAS - Charles Samuel STEWART

Portrait du Pasteur Charles Samuel Stewart
Pour consulter la documentation concernant le Vincennes, cliquer sur ce lien.

Le Vincennes, sloop de guerre américain - Illustration de Currier
*- Les notes entre parenthèses avec * sont de Jacques Iakopo Pelleau.
*- Les notes entre parenthèses sans * sont de l’auteur.
*- Les nombres de trois chiffres entre parenthèses renvoient aux numéros de pages de l’édition de 1832.
(127) Lettre XXIV
(* Ces lettres sont adressées à un certain H_____.)
TRAVERSÉE VERS LES ÎLES WASHINGTON
U.S.S. Vincennes, en mer
Le 26 juillet 1829
Les îles Washington sont la toute première destination du Vincennes ; cet archipel se trouve à proximité des îles du Marquis de Mendoça avec lesquelles on les rassemble fréquemment sous le terme général de « Marquises ». En raison de leur situation et de leur proximité, elles forment une entité, (128) tout comme les îles de la Société (* Les Îles Sous le Vent actuelles) et les îles Georgiennes (* Les îles du Roi Georges : Tahiti et Moorea, de nos jours) ; elles se situent à un peu plus d’un degré dans l’ouest des premières.
Bien que les Marquises fussent découvertes par un voyageur espagnol dès 1595, le groupe Washington, pourtant tout proche, resta inconnu du reste du monde jusqu’en 1791. Cette année-là, elles furent aperçues pour la première fois par le capitaine Ingraham de Boston ; l’année suivante, le capitaine Roberts, qui venait aussi de Boston, leur donna le nom par lequel on les désigne habituellement de nos jours et qui, selon l’usage, leur revient de droit. (* Le Français Marchand y passa deux mois après Ingraham et les baptisa « Îles de la Révolution » ; c’est bien ce dernier, et non Roberts, qui les nomma « Îles Washington ».)
Elles sont au nombre de trois – Huahuka (* Ua Huka/Ua Huna), Nuku Hiva ou Nuuhiva et Uapou (* Nuku Hiva/Ua Pou) – et forment un triangle inclus entre les latitudes 8°38’ et 9°32’ sud, et les longitudes 139°20’ et 140°10’ ouest de Greenwich. Uahuka est la plus orientale des trois ; Nuku Hiva se trouve à environ vingt milles vers l’ouest en ligne droite ; Uapou se situe à environ trente milles au sud de la partie centrale de Nuku Hiva.
Avec sa vingtaine de milles de longueur, et à peu près la même distance en largeur, Nuku Hiva est de loin la plus vaste des trois îles, et dispose de trois ou quatre bons ports sur ses côtes ; elle est la seule à avoir été fréquentée par des navires. Vous ne manquerez pas de vous rappeler que c’est aussi l’île sur laquelle le Commodore Porter (* en 1813/1814 ; voir Bibliographie) fit escale afin de remettre son escadre en état pendant la dernière guerre entre les États-Unis et la Grande Bretagne, et qu’elle est le cadre principal du journal qu’il publia par la suite.
Les habitants n’ont pas changé ; ils sont comme ils étaient à l’époque, si ce n’est qu’ils sont un peu plus corrompus, influencés par les mœurs licencieuses et immorales de blancs venus de pays civilisés et chrétiens, qui vivent à proximité immédiate du port occasionnellement visité par des navires.
Afin de nourrir l’intérêt que représente notre croisière parmi les différentes îles que nous avons l’intention de visiter tout au long de notre voyage, il me parait judicieux de commencer par porter le regard sur (129) ceux qui, tout comme le reste de la Polynésie, sont encore dans leur état originel de paganisme. De la sorte, il nous sera plus aisé de comparer la condition humaine et les perspectives offertes à des êtres immortels toujours plongés dans l’obscurantisme du paganisme avec d’autres (que l’on peut qualifier avec emphase de « chair de leur chair »), sur la condition et le caractère desquels se sont déjà exercées les influences édifiantes et régénératrices du Christianisme.
Les habitants des Marquises ne forment qu’un seul et même peuple dont les caractéristiques physiques et morales sont absolument identiques. Comme le capitaine Finch (* du Vincennes) n’a pas l’intention de jeter l’ancre dans ces îles (* du sud-est), le récit et les observations que je vais faire ne concernent que les Nukuhiviens.
Nous sommes désormais à seize jours de mer depuis notre départ de Callao et aucun incident digne de ce nom n’est à relever.
( . . . / ˙˙˙)
(132) LETTRE XXV
ARRIVÉE À NUKU HIVA
U.S.S. Vincennes, Baie de Taiohae
Le 27 juillet 1829
Nous voici de nouveau à l’ancre. Hier à douze heures, juste après la célébration du culte, nous aperçûmes Uahuka, la plus orientale des îles Washington, à une trentaine de milles de distance sur notre bâbord (* 48km). Nous prîmes la direction de sa pointe sud-ouest et longeâmes sa côte méridionale, à une distance de quinze milles (*24km). Cette partie paraît élevée, abrupte et désolée ; un peu trop, nous sembla-t-il, pour être habitée. Nous estimâmes son altitude la plus élevée entre quinze cent et deux milles pieds (* 450/600m).
Tout comme la majeure partie des autres îles tropicales hautes que j’ai déjà visitées, elle est profondément sillonnée de vallons étroits, séparés les uns des autres par des éperons rocheux abrupts qui descendent vers la mer depuis les hautes terres. On aperçoit, de ci de là, de petites plaines ou plateaux et, occasionnellement, des plages de sable peu étendues, sans apport d’alluvions ; la côte est généralement escarpée, et les brisants viennent s’écraser contre ses falaises lugubres. Nous ne vîmes point de forêts sauf sur les monts les plus élevés de l’intérieur ; mais les crêtes et les vallées et l’île toute entière verdoient sous une couverture d’herbe épaisse.
En faisant voile vers l’ouest, le paysage se fit de plus en plus sauvage, et nous mîmes le cap vers le sud-ouest. Nous rencontrâmes alors deux îlots qui avaient été, à l’évidence, autrefois rattachés à la grande terre ; en les contournant de près, la partie occidentale de l’île nous apparut soudain, présentant à notre regard deux petites baies enchâssées par des collines recouvertes de bosquets et de buissons.
À ce moment-là, nous n’avions encore vu aucun signe de présence humaine ; sur la grève, tout paraissait aussi immobile que dans le désert. Nous étions fort déçus de cette situation et, à l’approche de la nuit, nous nous apprêtions à faire voile en direction de Nuku Hiva dont la silhouette se dessinait au couchant quand soudain, le promontoire rocheux qui nous faisait directement face se trouva couronné d’une foule d’insulaires à la peau claire dont on distinguait parfaitement les silhouettes nues agitant des lances dont les extrémités étaient ornées de bandes d’étoffe blanche, et faisant voler leurs vêtements au-dessus de leur tête. Notre voilure ayant été apprêtée pour continuer notre route, nous fîmes un passage rapide devant eux tandis qu’ils cabriolaient les longs des crêtes, gesticulant de tous leurs membres et agitant des tapa (* étoffe végétale).
Nous réduisîmes la voilure aussi vite que possible et, dès que nous fûmes sous le vent de l’île, notre vitesse se réduisit à une progression presque imperceptible ; nous nous attendions alors à revoir notre joyeuse bande quand d’autres silhouettes apparurent sur les crêtes, dévalant les pentes d’un promontoire rocheux qui nous faisait face, tout en criant, sifflant et agitant des bandes d’étoffe.
Les collines en amont de cet escarpement s’élèvent de manière abrupte et sont recouvertes de magnifiques forêts. En nous rapprochant, nous découvrîmes qu’il abritait, derrière une avancée rocheuse, une petite plage de galets s’ouvrant sur un vallon étroit couvert de bosquets jusqu’à la grève. L’entrée du vallon ne fait que quelques toises de largeur, et il est tellement boisé (134) que c’est un véritable écrin de verdure. Nous n’aperçûmes aucune habitation digne de ce nom ; il est probable que l’abri des bosquets et les recoins de rochers constituent le seul logis de ces quarante ou cinquante Naturels aperçus dans les collines ou se pressant sur la plage en une frénésie effrontée.
On ne peut imaginer la sauvagerie d’un tel spectacle, et rares sont ceux qui ont pu en être témoins. La beauté pittoresque des collines boisées et le vallon illuminé des rayons du soleil couchant, la nudité des insulaires, la grossièreté de leurs gesticulations, l’extravagance de leurs vociférations illustrant l’homme dans l’état le plus simple de sa nature déchue, hôte dénudé de la forêt et des grottes, ne pouvaient que forcer le saisissement de quelqu’un qui n’a jamais été le témoin d’un tel tableau. Et je suis certain de ce qu’aucun d’entre nous ne fut déçu de la profondeur des impressions ou du degré d’exaltation occasionnés par ce premier spectacle offert par les Mers du Sud.
Pour ce qui me concerne, bien que singulièrement sauvage et saisissante, comme vous le savez bien, mon cher H_____, ce genre de spectacle n’avait rien d’une première. L’état d’exaltation que je partageais avec mes compagnons n’était qu’un plaisir mitigé car, dans mon esprit, il ne manquait pas de se trouver étroitement associé à l’ignorance, la perversion et les milliers de maux que mes observations personnelles m’ont conduit à croire inséparables d’une telle condition humaine.
Au cœur de ce brouhaha, alors qu’il nous apparaissait inapproprié d’accoster, le Capitaine Finch demanda à notre fanfare de jouer un morceau de musique sur le pont. Dès que la mélodie fut assez puissante pour atteindre la grève, l’effet fut immédiat : ils s’accroupirent comme par magie. Comme la nuit tombait rapidement, nous n’avions plus le temps d’envoyer un canot à terre et, tandis que la fanfare continuait à jouer quelques airs (135), nous prîmes la direction de Nuku Hiva, toutes voiles dehors. Bientôt, l’écho de leurs voix ne fut plus qu’un souvenir mais nous pouvions les apercevoir, assis sur les rochers et sous les sombres frondaisons, encore sous l’emprise silencieuse du ravissement et de l’admiration, tandis qu’allongeait ses ombres, le soir les enveloppait peu à peu.
Cet épisode bref et intense déclencha chez moi une remontée de souvenirs et de pensées qui me rendirent mélancolique : la réminiscence du chemin de vie que j’avais imaginé et espéré suivre en vivant parmi une race aussi inculte que celle-ci ; les sentiments de satisfaction, de bonheur et de succès que j’avais éprouvés lors d’activités missionnaires qui peuvent procurer de telles émotions ; l’interruption de tous mes projets ; mon actuelle fonction et son objectif de visiter cet archipel sans essayer de dissiper les ténèbres qui obscurcissent l’esprit de ses habitants mais seulement de les observer une journée et ne plus jamais les revoir, les abandonnant à leur ignorance et à leurs péchés tels des victimes privées de salut face aux vices des individus qui font halte chez eux de temps en temps ; tout cela m’emplissait de tristesse.
Il est probable qu’aucun navire ne se soit jamais autant approché de cette petite baie et, avec son équipage au grand complet en uniforme blanc des dimanches, avec nos pavillons flottant au vent et notre fanfare bien accordée, notre magnifique vaisseau a dû donner à ces frustres habitants une vision fugace d’un monde meilleur. Ô ! Que vienne promptement sur ces rivages un esquif plus fortuné qui ne soit pas vecteur de rêve ou de « fable habilement tournée », mais un messager de la sagesse divine et de la puissance de Dieu, chemin du salut.
La distance entre Ua Huna et Nuku Hiva ne dépassant pas les trente milles (* 48km), nous naviguâmes toutes voiles dehors une partie de la nuit, puis laissâmes filer. À six heures ce matin, cette dernière île se trouvait encore à une dizaine de milles de notre proue, nous donnant à découvrir la totalité de sa côte orientale. Ua Pou, la troisième île du groupe, était aussi en vue (136), à vingt-six milles au sud (* 41km) ; Ua Huna était encore visible à l’est, à une distance à peu près identique. Nous déterminâmes que les pics de Nuku Hiva culminaient entre deux mille et trois mille pieds d’altitude au-dessus du niveau de la mer (* 600/900m). La paroi orientale de cette dernière, formée d’une succession de précipices abrupts, est complètement inabordable. Portés par une douce brise, nous approchâmes le seul élément qui attirât notre attention : le promontoire formant l’extrémité sud-est de l’île. C’est une falaise escarpée et massive surmontée d’un rocher gigantesque qui la fait étrangement ressembler à la tour de garde en ruine d’un château-fort effondré, épaulée de solides bastions se terminant par une formation rocheuse que l’imagination a peu de peine à transformer en remparts et en créneaux. Je garde en lieu sûr un dessin précis que j’en ai réalisé ; et, suivant l’exemple du Capitaine Jones de l’USS Peacock, nous nommâmes ce cap « La Tour du Roc ».
En passant au large, s’ouvrit sur notre droite la profonde baie de la vallée de Oomi (* Hooumi) où demeurent les Taipi (* La Baie du Contrôleur), cette tribu guerrière avec laquelle le Commodore Porter eut maille à partir alors qu’il réparait ses navires dans le port où nous sommes à l’ancre aujourd’hui. La végétation occupe toute la vallée que des bosquets de cocotiers et d’arbres à pain recouvrent jusqu’aux crêtes des montagnes. Un promontoire de verdure tapissé d’herbe, et une langue de mer s’enfonçant profondément dans les terres de trois ou quatre milles séparent cette vallée et sa baie de celles des Hapas (* Hapaa), la seule tribu qui s’interpose entre les Taipi et les Teii, tribu occupant Taiohae, la vallée qui encercle notre mouillage.
Mis à part un rocher affleurant (* Teohotekea) à moins d’un mille au sud de « La Tour du Roc », en face de la vallée des Taipi, rien ne faisait plus obstacle à notre progression ; nous nous rapprochâmes de la côte en direction d’une flottille de pirogues de pêche. Elles étaient bondées d’hommes de la tribu Hapaa qui, en apercevant le navire, commencèrent à remonter leurs lignes et leur matériel, se préparant à nous aborder. (137) La perspective d’examiner de près ces créatures mit nos ponts et entreponts en ébullition. Dès que le navire s’avança parmi eux, et que montèrent vers nous les éclats de voix et les rires joyeux saluant notre arrivée, exprimant leur surprise de nous trouver là, chacun de nous s’empressa de jeter une corde à l’intention de ceux qui sautaient dans la mer, leur fournissant un moyen de s’accrocher au navire à son passage et d’escalader ses flancs. Bénéficiant ainsi de cette aide, cinq ou six hommes arrivèrent à leurs fins alors que nous naviguions toutes voiles dehors. Certains d’entre eux étaient entièrement nus ce qui les rendait encore plus sauvages que la plupart des habitants des îles Sandwich (* Hawaii) que j’ai rencontré ; mais ils se montrèrent d’une nature joviale et enjouée.
Ils nous firent bientôt comprendre que leur tribu et celle des Taipi étaient en guerre, comme de coutume, et que, deux jours seulement auparavant, s’était déroulée, entre eux, une bataille navale non loin de l’endroit où nous nous trouvions. Leurs grimaces de rancœur et de haine mortelle vis-à-vis de leurs ennemis dont ils pointaient du doigt la vallée, leur pantomime grotesque de la bataille, les décharges de mousqueterie et la mimique des coups reçus nous amusaient fort. Ils s’employaient aussi avec éloquence et gesticulations à nous amener à épouser leur cause, et à porter le fer chez ces pauvres Taipi dont le simple nom les faisait trembler de terreur. Dans cette perspective, ils nous invitèrent à nous ancrer près de leur vallée, juste en face de nous. Comprenant que nous étions décidés à continuer notre route vers le prochain mouillage, ils restèrent à bord car les Teii étaient désormais leurs amis et alliés.
Certains membres de l’équipage se trouvèrent si rapidement gênés par leur nudité qu’après quelques minutes à peine passées en notre compagnie, ces hommes se trouvèrent métamorphosés de sauvages dévêtus en loups-de-mer portant tunique, pantalon et ciré, tirant sur les cordages et montant dans les haubans pour aider à la manœuvre du navire avec autant d’expertise (138) que s’ils avaient été marins toute leur vie.
Entre la « Tour du Roc » et l’entrée de Taiohae, ou La Baie de Massachusetts, comme la nomma Porter, la distance est de huit milles (* 15km) environ ; une fois dépassée la vallée des Hapaa, la côte est périlleuse ; elle tombe en à-pic et ne présente aucune ouverture, aucune plaine côtière. Outre l’éloignement de la « Tour du Roc », l’approche de Taiohae est annoncée par deux points de repère remarquables ; le premier est un rocher rougeâtre, le second est une trainée blanche descendant une falaise sombre qui, de loin, a l’aspect d’une cascade servant probablement de canal de ruissellement aux fortes pluies.
L’entrée elle-même est signalée par la présence de deux îlots, ou gros rochers, de chaque côté du chenal, appelées « Sentinelles » de l’est ou de l’ouest selon leur position. Nous contournâmes celle de l’est de si près que nous aurions pu y lancer des biscuits et, d’un coup, la totalité de la baie et de la vallée s’offrit à notre vue.
Imaginez un bassin au pourtour qui ondule sur huit ou neuf milles de circonférence, s’étire sur presque trois milles jusque dans les terres depuis l’étroit passage formé par les Sentinelles, et se termine par une plage de sable circulaire qui, de loin, parait mesurer trois-quarts de mille de longueur. Cette plage forme le bord d’une vallée de largeur identique qui s’élève graduellement sur presque deux milles, et se sépare ensuite en trois ou quatre autres branches plus étroites et plus pentues pour se terminer soudain, de chaque côté, aux pieds abrupts et escarpés d’une chaine de montagnes élevées qui encerclent l’ensemble et redescendent de chaque côté jusqu’aux Sentinelles de l’entrée, formant des promontoires rocheux élancés joliment recouverts d’une végétation verdoyante.
Depuis la plage centrale, des bosquets luxuriants s’étendent entre des collines chatoyantes dépourvues d’arbres mais tapissées de prairies herbeuses aux couleurs de bruyère, et remontent en direction des vallées supérieures jusqu’aux collines les moins élevées qui les encerclent et bordent les montagnes les plus hautes. En haut de la vallée principale, une gigantesque pyramide (139) de roche (* Tetumu) se dresse formant une composition étonnante et remarquable ; à droite, en arrière, une muraille basaltique verticale de plusieurs centaines de pieds couronne les cimes montagneuses et, lui faisant face, sur la gauche, une immense falaise de roche grise en surplomb, recouverte d’arbres et richement ornées de plantes épiphytes, se dresse comme prête à fondre sur la vallée en-dessous depuis la paroi en saillie sur laquelle elle repose. L’ensemble est entrecoupé d’innombrables crêtes et vallons le long desquels des cours d’eau, formant rapides et cascades, descendent en écumant.
La couverture végétale est si épaisse que peu d’habitations indigènes se laissent apercevoir. Deux ou trois occupent la crête dénudée des collines les plus proches ; on entrevoit, çà et là, à travers l’épais feuillage qui les enveloppe, les toits de chaume blanchis de quelques autres, et l’on peut en discerner une ou deux, solitaires, dans la montagne.
Telles sont, mon cher H_____, quelques-unes des toutes premières et puissantes images de la baie et de la vallée de Taiohae.
Au passage des Sentinelles, le vent qui nous avait portés faiblit soudain et cessa d’un coup ; de telle sorte que nous fûmes contraints de jeter l’ancre à plus d’un mille de la plage. Néanmoins, se leva alors une légère brise qui nous poussa un demi-mille plus avant où nous trouvâmes l’endroit souhaité pour mouiller du côté est, en face du lieu de l’ancien camp du Commodore Porter (* Hakapehi).
Alors que nous nous nous portions vers cet endroit-là, nous aperçûmes deux ou trois pirogues se rapprochant de nous depuis les pêcheries du bord de mer, et deux autres en provenance du centre de la baie ; à peine avions nous lâché l’ancre que des dizaines de naturels des deux sexes quittèrent la grève pour se diriger vers nous à la nage ; entourant bientôt le navire, ils s’ébaudissaient et soufflaient comme une bande de dauphins. Nous les laissâmes monter à bord où une énorme (140) confusion régna bientôt. J’évaluerais à cent cinquante ou deux cents au moins la quantité des présents.
Il nous fallut attendre au moins deux ou trois heures pour voir une pirogue officielle se ranger à nos côtés. Le groupe était composé de Moana, le prince, ou roi de la tribu, un garçonnet âgé d’environ huit ans ; de Haape, tuteur du prince et régent durant sa minorité, accompagné de son fils Tenae (Tainai ?), du même âge que Moana ; et de Piaroro, ou Piaoo, un chef de haut rang de la tribu voisine des Hapaa. Aucun d’entre eux ne portait d’autre vêtement que le simple pagne « maro » composé d’un tapa ordinaire, l’étoffe indigène. Je n’ai jamais vu de gamins aussi vifs que le prince et son camarade et, sans consultation préalable, ils devinrent sur le champ les chouchous des officiers.
Haape est un homme d’âge mûr, au visage doux et, apparemment d’un comportement tout aussi aimable. Il nous accueillit avec grande cordialité, certain qu’avec l’arrivée d’un des « navires de Porter », comme ils nomment tous les bateaux américains, il allait s’attacher l’allié dont il avait besoin contre les Taipi. Il est d’une taille à peine supérieure à la moyenne, pas très corpulent, ressemblant tout à fait à un chef de troisième catégorie des îles Sandwich. La plus grande partie de ses cheveux grisonnants était rasée à l’exception d’une touffe élégamment étirée et nouée par un bandeau de tapa blanc. Pour tout bijou, il n’arborait qu’une paire de pendants d’oreille finement ciselés dans une dent de cachalot.
Dès que l’on pose les yeux sur Piaroro, on devine le prince de haut rang, de par nature et de par le sang, l’un des hommes les plus magnifiques que j’aie jamais vu. Il est grand et bien taillé, pas très musclé mais admirablement proportionné, d’une allure générale, d’un grain et d’un galbe de membres qui feraient honneur à Apollon. Sa peau est si parfaitement recouverte de tatouages (* tatau, dans le texte) prenant la forme d’élégantes figures symétriques (141) qu’il donne l’impression d’être habillé. Bien qu’à l’évidence, il ait le teint aussi clair que ses compagnons, la totalité de son visage et de sa tête, de son torse et de ses épaules sont, de la sorte, aussi noirs qu’on peut s’imaginer un Othello.
De même, ses traits sont de grande noblesse. Ses dents sont d’une régularité et d’une blancheur rares ; l’expression de son visage est aristocratique tout en restant affable, et ses manières sont dignes et réservées. Il semble que la coiffure soit une des préoccupations majeures des deux sexes ; la chevelure de Piaroro était arrangée avec le plus grand soin et se caractérisait par deux chignons élégamment maintenus par du tapa blanc.
Comme la langue hawaiienne ne diffère radicalement pas de celle parlée dans cet archipel, les quelques bribes que j’en possédais me permirent, jusqu’à un certain point, d’échanger quelques idées avec eux. De même, grâce aux cinq ou six membres d’équipage originaires des îles de la Société et de Hawaii, le Capitaine Finch fut en mesure d’expliquer les raisons de sa visite afin de leur faire comprendre que nous ne venions ni pour faire la guerre ni pour commercer, mais dans le but de leur manifester notre bonne volonté, acquérir le ravitaillement nécessaire et faire de notre mieux pour leur être serviables.
Après ces informations de notre part et quelques autres qu’ils nous donnèrent sur la situation actuelle de l’île et de leurs tribus, on leur servit des rafraîchissements sous la forme de pain, raisins secs, pommes, etc. Lorsque la fanfare entama ses premières mesures sur le pont, ils quittèrent tous la cabine et la rejoignirent sur la dunette où, jusqu’au coucher du soleil, ils laissèrent libre cours à leur surprise et aux manifestations de leur joie enfantine.
À notre arrivée au mouillage, nous avions hissé un drapeau blanc en haut du mât de misaine signifiant la liberté d’accès au navire pour ceux qui désireraient monter à bord. Le capitaine expliqua la présence du drapeau en haut du mât, et informa les chefs (142) que tous ceux qui en avaient envie pouvaient monter à bord lorsqu’il flottait, mais qu’en l’absence de ce pavillon, il fallait considérer le navire comme tapu (* tabu, dans le texte) jusqu’à ce qu’on le voie flotter à nouveau. Il termina en disant qu’on allait descendre le drapeau pour la nuit, et que tous les gens présents à bord, hommes et femmes, devaient commencer à quitter le navire.
Haape et Piaroro annoncèrent notre requête aux foules agglutinées sur les ponts et dans les gréments, se lançant alors dans l’exercice périlleux de l’autorité en des circonstances pas plus réjouissantes pour eux que pour leur population, mais ils adoptèrent la manière douce et tranquille, celle qui, je crois, se voit agréée généralement par les Polynésiens en toutes circonstances.
Tout d’abord, on ne prêta que peu d’attention aux ordres, mais lorsque le Capitaine Finch réitéra son injonction auprès des chefs, insistant qu’il fallait quitter le navire, ils prirent un ton plus ferme et plus autoritaire qui fit plonger les hommes par-dessus bord dans une confusion générale ponctuée de babillage et d’exclamations.
Quant aux dames, elles ne se sentaient manifestement pas concernées par les ordres, et s’étaient regroupées calmement, tenant pour sûr que, comme pour tous les autres navires qui avaient fait escale auparavant, elles allaient pouvoir s’installer sur le Vincennes jusqu’à ce que l’ancre soit levée. Et ce n’est que lorsqu’on leur eût répété à plusieurs reprises les ordres de quitter le navire qu’elles commencèrent à comprendre la réalité de la situation ; rien ne put égaler alors l’expression de surprise sur leur visage. De par leurs atermoiements et leurs mouvements dilatoires, elles paraissaient déterminées à éprouver la réalité d’une mesure jusqu’alors inconnue.
Il leur fallut prendre acte de notre départ dans nos cabines et des gestes polis des officiers leur indiquant les marches de la passerelle pour qu’elles commencent à sauter dans l’eau l’une après l’autres aux cris de « Taha ! taha ! » (Allez ! allez !) et de « Pull away ! » (Éloignez-vous !), comme elles ont appris à le dire. Le sourire au coin des lèvres, les chefs prirent congé et montèrent dans leur pirogue en disant : (143) « Quel navire étrange, non ? ». Je ne doute pas que c’était la première fois qu’ils voyaient une telle restriction imposée à l’encontre de la plus grossière des débauches.
Une fois le navire débarrassé du bruit, de la nudité, des relents d‘huile de coco et autres odeurs qui nous avaient fort incommodés, le Capitaine Finch me convia dans sa yole à faire un tour du port, ou plutôt de cette partie de la baie où nous étions mouillés. L’excursion fut charmante, et le paysage, baigné de la douceur du coucher de soleil, n’avait rien à envier en sauvagerie ou en beauté à ceux qu’il m’avait déjà été donné de contempler.
LETTRE XXVI
VALLÉE DE TAIOHAE
À bord du Vincennes, vaisseau de la Marine des États-Unis, Nuku Hiva
Le 28 juillet 1829
À peine le tambour eut-il battu le branle-bas du matin que le Vincennes se trouva entouré de bruits, de vociférations, d’invectives et autres formes grossières de réjouissances locales. Le navire étant encore tapu, l’officier de quart les autorisa à grimper dans la chaloupe qui avait été descendue et amarrée à quelque distance ; ils y montèrent si nombreux que, malgré sa belle taille, l’eau arriva bientôt au niveau de ses bords. Le drapeau blanc n’ayant pas été hissé ce jour-là, ils furent contraints de se satisfaire de cette situation.
Avant le petit-déjeuner, alors que le Capitaine Finch et moi prenions un bain de mer dans une partie isolée de l’est de la baie, les chefs rencontrés la veille nous rejoignirent en compagnie d’un anglais nommé Morrison. Il résidait sur place depuis quelques années en qualité de santalier. Le capitaine s’empressa d’accepter son offre de nous servir d’interprète, fonction qu’il était mieux à même de remplir que nos Naturels des îles de la Société et de Hawaii que la connaissance imparfaite de l’anglais (144) et les variantes lexicales, entre les différentes langues polynésiennes et la leur, mettaient souvent dans l’embarras. Du côté des chefs, la cause première de leur visite était de savoir quand ils pourraient recevoir le Capitaine Finch et ses officiers à terre ; le rendez-vous fut fixé à 11 heures et nous les quittâmes pour aller prendre notre petit-déjeuner.
Un peu plus tard, de fortes averses de pluie s’abattirent sur la baie, descendant des montagnes de l’intérieur ; mais, un peu avant midi, le ciel s’éclaircit, et nous nous préparâmes à rendre la visite promise. Outre le capitaine, notre troupe était composée des lieutenants Dornin et Magruder, des aspirants Irving, Taylor, Bissel et Smith, d’un sergent et d’un garde des troupes de marines, et de moi-même. La procession des embarcations, l’étalage des armes et des uniformes, notre procédure d’accostage, tout cela ne pouvait que déconcerter ou intimider ceux que nous nous apprêtions à honorer de notre présence. Sur la plage, les chefs qui attendaient de nous accueillir avaient l’air bien embarrassé. Cette situation provenait probablement d’un sentiment d’infériorité car, tandis que Haape nous conduisait chez lui, ses tout premiers mots furent de s’excuser de ne pas être en mesure de nous offrir des distractions en retour de notre amabilité à son égard et envers ses amis lors de leur montée à bord la veille.
Le festin est chez eux la toute première manifestation d’hospitalité, et il craignait sans doute que nous nous attendions à être ses convives en cette occasion. Voyant que nous comprenions la situation et que nous n’étions pas contrariés, ils se détendirent et retrouvèrent bientôt leur liberté de ton. Tout comme la veille, ils n’étaient vêtus que d’un simple maro ou pagne. Une ou deux douzaines d’hommes, de femmes et d’enfants descendirent en groupe assister à notre débarquement, mais la grande partie des habitants se trouvait au navire ou occupés en d’autres lieux.
La maison de Haape, chez lequel réside le jeune roi Moana, est située sur le promontoire rocheux d’une petite colline près de la plage, et domine la baie. (145) (* C’est le paepae Haèèi, demeure du maître-sculpteur Edgar Tamarii, au-dessus de la boulangerie Joseph).
Elle est de petite taille mais elle est bien visible depuis le mouillage et elle ressemble à un joli cottage. Les maisons sont de taille variable, de vingt à cent pieds de long (de 6m à 30m), de huit à seize pieds de haut (de 2.4m à 4.80m) et de dix à quatorze ou seize pieds de large (de 3m à 4.20 ou 4.80m) ; elles ont toutes la même forme et le même style, mais diffèrent en tous points de celles des îles Sandwich.
Ici, au lieu de descendre des deux côtés du faitage jusqu’aux débords, les toits ne portent de chevrons que sur leur partie avant, tandis que la partie postérieure descend perpendiculairement ou selon une forte déclivité depuis le faîte jusqu’au sol donnant, vu de l’extérieur, l’impression d’une case coupée en deux dans le sens de la longueur. Pour ce que j’ai pu en juger, elles sont toutes sans exception érigées sur des plateformes de pierre brute, parfois des assemblages de rochers massifs, qui font d’un à quatre pieds de hauteur (de 0.30m à 1.20m) et qui s’étendent à une distance de trois ou quatre pieds (de 0.90 à 1.20m) tout le tour de la maison. Les chevrons descendent jusqu’à une poutrelle de bois qui court tout le long de la toiture et qui est supportée par une rangée de gros poteaux circulaires de trois à cinq pieds de haut (de 0.90m à 1.50m) au-dessus desquels les avant-toits se prolongent assez loin pour protéger efficacement l’entrée des intempéries.
Tout à fait au sommet, les chevrons reposent sur une poutre similaire à la précédente qui est supportée par deux ou plusieurs poteaux de huit à quatorze pieds de haut (de 2.40m à 4.20m). Entre ces chevrons, l’espace est comblé par des tiges de bambou ou du bois léger de l’hibiscus (* Il s’agit ici de l’hibiscus tiliaceus, le hau/fau marquisien, purau, en tahitien ; burao, en français) qui sont placées parallèlement à une distance de deux ou trois pouces les unes des autres (de 5cm à 9cm) ; ces tiges sont elles-mêmes recouvertes de tiges plus légères placées horizontalement à intervalles réguliers. L’ensemble est ligaturé avec soin aux intersections. La partie arrière du toit et les deux extrémités de chaque côté sont aménagées de la même manière, ainsi prêts à être recouverts de chaume. En fait de chaume, il s’agit soit de feuilles d’arbre à pain, soit des branches de cocotier, soit des palmes du chamoerops humilis (* Le latanier pritchardia pacifica ou « vahakekuà ») ; en fonction de leur nature, ces éléments sont préparés selon différentes méthodes. La branche de cocotier mesure de douze à seize pieds de long (de 3.60m à 4.80m) et possède de longues folioles s’étirant comme des plumes de chaque côté de la nervure principale. (146) On fend cette nervure ou tige par le milieu, et les deux parties sont tressées l’une avec l’autre formant un ensemble de la même longueur et mesurant d’un pied et demi à deux pieds de large. Une fois prêtes, ces palmes sont placées en double épaisseur sur les chevrons en commençant par le bas, celles du haut chevauchant celles du bas, tout comme on le fait pour les ardoises ou les bardeaux.
La feuille de l’arbre à pain mesure deux pieds de long (0.60m), un et demi ou plus de large, et est marquée de profondes découpes. Pour s’en servir de toiture, on les enfile le plus serré possible sur une tige de bois léger mesurant de dix à douze pieds de long (de 3m à 3.6m) d’un demi-pouce de diamètre (1.5cm). Le tout est ensuite fixé au toit et sur les côtés, de la même manière que les palmes de cocotier, ce qui donne une couverture plus durable et de meilleure qualité.
Mais c’est le latanier qui fournit la couverture la plus prisée et aussi la plus utilisée là où l’arbre pousse en abondance. Ces palmes en forme d’éventail sont fixées une à une à une tige fendue d’hibiscus (* purao/purau), leur partie centrale distante d’environ un pied (0.30m) l’une de l’autre ; les tiges sont ensuite installées sur le toit à une distance équivalente, se chevauchant ainsi de tous les côtés. Bien loin de prendre un aspect brûlé sous le soleil comme les huttes de paille des îles Sandwich, toutes ces variétés de couverture blanchissent remarquablement. Si bien que de loin, elles chatoient sous le soleil parmi la végétation comme autant de petits cottages platinés bien de chez nous.
Les façades des habitations sont rarement fermées. Parfois elles sont entièrement ouvertes, auquel cas, les poutres et les poteaux sont généralement finement sculptés et ornés de tresses de fibres végétales de différentes couleurs, blanches, noires, jaunes, &c. fixées horizontalement ou formant des losanges pleins de fantaisie.
Dans la plupart des maisons, néanmoins, la façade est recouverte de bambous fixés horizontalement aux poteaux à des intervalles d’un ou deux pouces (de 1.5cm à 3cm) ou en treillis afin de laisser passer la lumière, auquel cas, (147) on trouve une petite porte au milieu, sous forme de panneau coulissant que l’on peut ouvrir ou fermer à loisir. C’est par une façade et une porte du même genre que nous entrâmes dans la demeure de Haape.
Outre son épouse, d’autres femmes de la famille, des enfants et des serviteurs, quelques personnes se trouvaient aussi dans la maison, certaines debout, d’autres allongées de-ci de-là. Les femmes étaient drapées de grandes capes de tapa blanc. La plupart d’entre elles portait un joli turban de la même étoffe, d’autres, un bandeau seulement dont l’extrémité était élégamment fixée d’un côté de la tête ; d’autres encore portaient les cheveux détachés dont les boucles tombaient sur les épaules. L’épouse de Haape, une jeune femme élégante et gracieuse, donnait le sein à un nourrisson de quelques mois qu’elle considérait avec amour.
L’arrangement intérieur de chaque habitation est identique. Un tronc poli de cocotier s’allonge de toute la longueur de la maison à une distance d’un ou deux pieds (de 0.30m à 0.60m) du pan arrière du toit. À quatre pieds en avant environ (1.6m), un autre tronc lui est parallèle ; l’espace entre les deux est recouvert d’herbes et de nattes qui constituent le lit de toute la famille et de la maisonnée. Le tronc le plus central sert d’oreiller commun tandis que l’autre, de support pour les jambes qui reposent dessus (* D’autres descriptions disent le contraire). Le sol du reste de la maison est un pavé sur lequel ils prennent leurs repas et s’adonnent à leurs activités domestiques.
Des calebasses de nourriture et d’eau, des jattes et des plateaux de bois, des herminettes de pierre, de nombreuses lances et casse-têtes, d’autres objets grossiers et quelques mousquets remontés dans le faîtage, c’était là tout le mobilier de l’habitation.
La foule qui s’était jointe à nous à l’intérieur, la chaleur et l’étroitesse des lieux, les nuages de mouches et la forte odeur d’huile de coco eurent tôt fait de nous mettre mal à l’aise. Alors, après avoir échangé quelques civilités et donné l’assurance de nos bonnes intentions, le Capitaine Finch distribua aux chefs des deux sexes de petits cadeaux qui étaient pour eux des trésors tels que des haches, (148) des couteaux et des pièces de calicot, acceptés avec autant d’enthousiasme que de jalousie, les récipiendaires s’empressant de mettre en sureté ce qui leur revenait.
Après cet épisode et l’examen attentif de quelques lances, calebasses, plats en bois et autres articles du cru, nous suggérâmes de faire une promenade parmi les plantations et les bosquets de l’intérieur. Au moment où nous quittions la maison, on nous désigna un homme dans la foule ; c’était un chef de guerre, de petite taille mais d’une musculature imposante et très athlétique, dont les traits anguleux et l’expression de sauvagerie étaient rehaussés par une tête hérissée d’une abondante chevelure frisée entretenue, probablement, dans l’intention de terroriser les ennemis au combat. Il portait une lance à la main et, à notre requête, entreprit une démonstration de mouvements et de gesticulations rapides doublés de grimaces et de cris sauvages tels qu’on les pousse lors d’une attaque. L’exubérance du spectacle était si réaliste qu’on s’attendait presque à être transpercé de sa lance sans avoir eu le temps de réagir.
Le sol de la vallée est accidenté et entièrement couvert de bosquets d’arbres à pain, de cocotiers et de nombreux autres arbres, sans presque la moindre trace d’agriculture. Nous parcourûmes un peu plus d’un mille, et nous n’aperçûmes qu’un ou deux petits enclos contenant des taillis de mûrier à papier, de la canne à sucre, de dracæna terminalis (ou cordyline fructifosa) et quelques plants de tabac. Ces enclos étaient bien entretenus, et les clôtures de bambou les entourant présentaient une belle facture ; ils étaient fixés dans le sens de la longueur à des poteux plantés dans le sol et ligaturés avec des cordages de bourre de noix de coco tressée. Parmi la végétation naturelle, je reconnaissais maints vieux amis des îles Sandwich tels que le pandanus odorotissimus, l’aleurites triloba (* Le bancoulier), l’arum costatum (* Le taro), l’eugenia malaccensis (* Le jambosier rouge ou pommier rose/tumu kehika), l’acacia, le gardenia, le palma christi (* Le ricin commun), &c.
Un ruisseau bondissant descend d’un vallon supérieur en direction de la mer ; (149) ses vifs méandres, au travers de bosquets épais, rehaussent le pittoresque des humbles bâtisses des habitants éparpillées à l’ombre des grands arbres surplombant ses rives. Nous le longeâmes sur environ un mille sans rien trouver quoi que ce fût qui nous intriguât mais, après une traversée de vingt-deux jours depuis les côtes arides et désolées du Pérou, nous appréciâmes la fraicheur et la luxuriance de de la végétation qui nous entourait.
Notre promenade se termina en un lieu qui pourrait prendre le nom de Théâtre ou Opéra de la vallée, à savoir une vaste plateforme rectangulaire empierrée entourée de terrasses inférieures, elles aussi pavées ; la première est destinée aux spectacles publics de chants et de danse, et les dernières sont mises à disposition des spectateurs assemblés autour de la scène. Ces divertissements sont les plus en vogue et plus prisés des habitants des îles Washington et de l’archipel des Marquises. Chaque vallée habitée dispose d’un Tahua (* Tohua), ou place publique du même acabit ; certaines sont si vastes, nous a-t-on dit, que dix mille personnes pouvaient y prendre place.
Impatient de visiter un de leurs temples, je demandai à notre interprète où l’on pouvait en trouver. Il me répondit en pointant du doigt un bâtiment tout proche qui paraissait en ruines et dont l’aspect ne différait aucunement de celui des habitations ordinaires qui nous entouraient. « C’est un Meae. » (* Meàe), ajouta-t-il. Il expliqua que l’état dans lequel il se trouvait résultait d’une guerre qui s’était déroulée au cours de l’année passée entre les Teii de la vallée et leurs voisins Hapaa ; ces derniers ayant été victorieux, ils avaient détruit jusqu’aux temples, emportant toutes les idoles et laissant les bâtiments en ruines. Il semble que, depuis lors, personne n’ait songé à remplacer les statues ou à réparer les anciens bâtiments. Cette marque d’indifférence vis-à-vis des emblèmes de leurs superstitions (150) m’étonna grandement.
Il semble qu’on doive aussi attribuer à cette défaite la pauvreté manifeste des chefs et de la population, tout autant que l’état de négligence et de dégradation dans lequel se trouve la région. Haape est véritablement vassal de Piaroro, chef des Hapaa qui joue les hôtes apparents mais garde un œil despotique sur la vallée dont il perçoit les redevances.
Après nous être régalés de cette magnifique boisson qu’est l’eau de coco, dont les chefs nous abreuvèrent en quantité, nous reprîmes le chemin de la plage.
Avant de remonter dans nos embarcations, les chefs nous laissèrent à comprendre qu’ils nous rendraient notre visite au cours de l’après-midi ; le Capitaine Finch invita alors les femmes de leur famille à les accompagner.
Elles promirent de venir à condition qu’on envoyât des canots les chercher, expliquant que le tapu leur interdisait strictement de monter à bord d’une pirogue.
C’était la première fois que nous nous trouvions en présence d’une manifestation tangible du singulier système de superstition si largement répandu sur cet océan. De nombreuses questions concernant son existence et ses caractéristiques se sont fait jour pendant notre séjour, et nous avons eu la bonne fortune d’y trouver des réponses quasi satisfaisantes.
La population est divisée en deux classes distinctes : les gens du commun et ceux de la classe tapu. La classe commune ou ordinaire englobe toutes les femmes et les filles, quel que soit leur rang, de même que tous les hommes qui sont à leur service personnel. Cette classe inclue tous les hommes, jeunes ou vieux, qui participent aux chants et aux danses sur leurs aires de réjouissance, ce qui tendrait à faire croire que cette occupation est efféminée ou dégradante. Tous les autres hommes appartiennent à la classe tapu.
Tout comme dans les autres groupes humains où cette disposition est en vigueur, les restrictions sur les lieux d’habitation et la nourriture concernent surtout sur les membres de la classe ordinaire. (151) Jamais une femme ou un membre de la classe inférieure n’a le droit de pénétrer dans la maison d’un homme de la classe tapu. Par conséquent, les épouses, les autres femmes et les serviteurs qui résident avec elles de manière temporaire ou permanente, font la cuisine et prennent leurs repas dans des bâtiments annexes. Bien que l’accès aux maisons de hommes et à leur nourriture soit interdits aux femmes, ceux-ci ne se privent pas d’entrer dans les maisons de ces dernières et de s’y restaurer à leur guise.
Pour ce qui concerne la nourriture, le fruit-à-pain, la noix de coco, l’igname et différentes sortes de plats composés de ces éléments, ainsi que la plupart des poissons, sont consommés par les deux classes sans discrimination, à l’exception des mets sur lesquels on a imposé un tapu en les plaçant dans un panier, une calebasse ou tout récipient appartenant à une personne tapu ; le seul contact avec ces objets les limite à un usage restreint. Néanmoins, les restes humains, le porc, la tortue, le poulpe, la bonite et le thon sont en permanence tapu pour ceux qui ne font pas partie des privilégiés.
On ne doit jamais passer la main, s’assoir ou s’allonger sur ce qui est déjà passé au-dessus de la tête d’une personne ou de la main d’un homme tapu. Ils pensent qu’en agissant de la sorte, on profane l’objet en question, ce qui aurait pour conséquence de diriger la colère des dieux contre la personne qui avait provoqué la mise à l’écart de l’objet en se le passant au-dessus de la tête. En conséquence, lorsqu’une telle infraction se produit, qu’elle soit accidentelle ou volontaire, l’individu ayant profané l’objet, en s’en servant comme d’un objet ordinaire, devient la cible de la vengeance de son propriétaire ; la mort sera le seul prix de sa maladresse et de son arrogance. En attendant le trépas annoncé de ce dernier, la victime de cet incident est généralement en proie à de grands troubles ou de terribles calamités.
Si une femme s’allonge sur un objet consacré par le simple toucher d’un homme tapu, ou bien si elle l’enjambe, l’article ainsi profané ne pourra jamais plus être réutilisé, et la femme sera mise à mort.
En général, néanmoins, (152) un incident, tel celui précédemment cité, a pour principale conséquence gênante d’interdire l’usage premier de l’objet. Par exemple, si un homme tapu passe la main sous une natte, on ne peut s’y allonger à nouveau, mais on peut la porter comme cape, ou bien elle peut servir de voile à une pirogue. Par contre une voile tressée ne peut servir de natte vu le nombre de personnes qui sont passées en-dessous.
Cette superstition est bien illustrée par un incident qui s’était déroulé le matin tandis que le Capitaine Finch distribuait des cadeaux chez Haape. Souhaitant donner un ballot de cotonnade blanche à une des femmes de chef, il le lui tendit en passant au-dessus de la tête d’un homme assis à ses côtés qui, s’exclamant « Tapu, tapu ! », s’en empara sur le champ. Sans donner plus d’explications, l’interprète dit au capitaine que c’était là de l’abus de pouvoir, et que s’il avait l’intention de donner une autre cotonnade à cette femme, il devait faire en sorte de na pas le passer au-dessus de la tête de quiconque.
Avant l’Évangélisation, je ne me souviens pas avoir entendu mentionner de tapu réservé aux pirogues ordinaires chez d’autres groupes humains du Pacifique ; quant aux îles Sandwich, je sais que ce n’était pas de mise, pour les pirogues ordinaires en tous cas.
Il semble que l’observation rigoureuse de ces superstitions arbitraires soit la loi principale de ces gens, et la seule référence du peuple aux notions de bien et de mal.
Au lieu d’imputer les calamités de la vie aux vices et aux abominations morales dont ils se rendent coupables, ils préfèrent interpréter les maladies et la mort, la famine et la guerre, et toutes les catastrophes, comme des conséquences de violation ou de mépris envers leurs interdits insignifiants, et les exigences capricieuses du tapu.
La table du dîner venait à peine d’être desservie cette après-midi-là que le quartier-maître annonça l’approche d’une pirogue de guerre ; les chefs en grand apparat vinrent bientôt se porter à notre flanc. (153) L’embarcation était une pirogue simple, de taille moyenne, mesurant à peu près vingt pieds (* 6m) de long et trois (* 0.90m) de large ; elle était d’une construction brute et grossière, grandement inférieure aux simples pirogues de pêche des îles Sandwich ; on l’avait taillée dans un tronc d’arbre à pain et non dans du bois de koa (* toa = arbre de fer, casuarina equisetifolia), normalement destiné à ce genre d’embarcation dans cet archipel. Elle différait aussi de celles des îles Sandwich de par sa forme, sa poupe et sa proue.
(Dessin de l’auteur : la pirogue et ses occupants décrits ci-après)
La proue était basse, presqu’au niveau de la mer, faisant saillie horizontalement de plusieurs pieds à l’avant du corps de la pirogue et se terminant par une figure de proue sculptée en forme de tête hideuse. Entre cette dernière et la proue même, on avait dressé trois palmes de cocotier de trois ou quatre pieds de haut à côté desquelles, en tête de pirogue, assis sur une plateforme de treillis, se tenait droit comme un Turc, un chef important des Taiòa, tribu qui demeure dans une région à l’ouest de cette vallée. Il était enveloppé d’une grande cape blanche d’étoffe indigène, et sa tête était couverte d’une feuille de bananier séchée et finement tressée en un bonnet seyant. Au milieu de l’embarcation, vêtu de son seul pagne, se tenait Haape arborant une coiffure identique en taille et en forme à celle du chef Taiòa. Quant à Piaroro, bien en vue à la poupe sur une plateforme frangée de belles palmes, il tenait le rôle de timonier, une longue rame à la main, donnant le rythme à une troupe de six ou huit gaillards qui propulsaient l’embarcation sur les flots.
Tout comme Haape, Piaroro ne portait qu’un pagne. Au lieu d’avoir les cheveux proprement noués avec du tapa sur le sommet de la tête comme précédemment, il les portait répartis de chaque côté en deux énormes touffes frisées qui lui descendaient jusqu’aux épaules entourant son visage d’un aspect sauvage et farouche. Aux oreilles, il arborait des ornements d’ivoire magnifiquement ciselés et polis dont la blancheur contrastait fortement avec le noir de jais de sa chevelure.
L’extrémité de la poupe de la pirogue était aussi particulière que la proue. De chaque côté, elle se prolongeait par une pièce de bois arrondie, courbée vers le haut comme les patins d’une luge, qui se terminait en pointe aplatie à six ou huit pieds (1.80m ou 2.40m) au-dessus de la surface. Entre les deux, tout à fait en haut, était accrochée une grossière effigie de divinité en position inclinée, tandis que de leurs sommets partaient deux cordes fixées à la plateforme centrale sur lesquelles étaient suspendues des touffes de cheveux humains, trophées des victoires sur leurs ennemis.
S’approchant des flancs du navire, ils prirent un rythme solennel et un air important qui témoignaient d’emblée de l’apparat et de la pompe du moment. Ils semblaient nous signifier : « Nous sommes d’avis que notre pirogue et ses attributs supporteront avantageusement la comparaison avec vos barques et vos oriflammes. »
Entretemps, un canot avait été envoyé à l’intention des dames qui se présentèrent peu après, très modestement enveloppées de larges bandes de tapa blanc, et portant des turbans dont l’étoffe était aussi fine que le tulle. Le cérémonial des rafraichissements se répéta, et le capitaine Finch leur offrit à nouveau des cadeaux de calicot afin de confectionner des capes et d’autres articles d’habillement. Pendant leur séjour à bord, (155) nous pûmes assister à une nouvelle démonstration de force du tapu ; aucune des femmes ne voulut monter sur la dunette qui est la partie la plus agréable du navire tant que les chefs se trouvaient dans la cabine en-dessous.
Après un concert d’une heure dispensé par la fanfare, tous rentrèrent à terre apparemment très satisfaits de leur visite. Le capitaine raccompagna dans sa yole le jeune prince Moana et son camarade Teinae qui nous avaient accompagnés à bord le matin ; les chefs suivirent dans leur pirogue et les femmes dans un cotre.
______
LETTRE XXVII
DANSE DANS LA VALLÉE DES HAPAA
Baie de Taiohae à Nuku Hiva,
Le 29 juillet 1829
Après l’une des excursions les plus épuisantes que j’aie jamais faites, incluant même la descente dans le cratère du volcan de Hawaii, je prends ma plume à huit heures, mon cher H____, afin de coucher sur le papier les spectacles de la journée avant que mes observations ne perdent de leur fraîcheur.
Vous serez bien étonné d’apprendre que la danse est au cœur du sujet.
Ayant entendu dire qu’une démonstration de festivité païenne allait se dérouler dans l’intérieur des terres, une partie de l’équipage décida d’y aller en groupe afin d’y assister. Je me joignis à eux, non seulement pour le plaisir de l’Opéra, mais aussi afin d’acquérir une connaissance avantageuse du pays et de l’état véritable de sa population.
Nous quittâmes le navire entre neuf et dix heures, avec Morrison comme guide. Notre excursion commença par l’ascension des collines herbeuses que l’on aperçoit depuis la baie, et dont les éclats doux et brillants sous le soleil jettent un air civilisé sur la rudesse du paysage à l’entour. (156) Le sentier s’allonge sur un demi ou trois quarts de mille (800m et 1km) jusqu’au sommet qui offre le magnifique spectacle, d’une part, sur le port, les promontoires avoisinants et les riches bosquets s’élevant de la plage jusqu’aux montagnes ; d’autre part sur les nombreux vallons, les cascades et les pics isolés des montagnes de l’intérieur.
Au tournant d’un passage abrupt, sur le tombant d’une colline, deux guerriers en tenue de combat se dressèrent soudain devant nous, en route pour le Vincennes. Les deux hommes étaient de noble stature, et chacun de leurs membres, de par la beauté de sa musculature, aurait pu servir de modèle à un sculpteur.
Leur tenue, parfaitement identique, était singulièrement remarquable et impressionnante, surtout leur couvre-chef qui força instantanément l’admiration de tous.
Il était formé d’un croissant de trois ou quatre pouces de large (* 9cm à 12cm) en son milieu ; le bord supérieur faisait saillie verticalement tandis que le bord inférieur courait sur le front, le long de la chevelure, jusqu’aux pointes qui se terminaient sur les tempes, juste au-dessus des oreilles. Un joli liseré large d’un huitième de pouce (* 6mm) en gansait la bordure, tandis que sa partie centrale était entièrement recouverte de petites baies écarlates de l’abrus precatorius (* pōniu, en marquisien) fixées sur le matériau dont il était fabriqué au moyen de la gomme qui suinte du tronc de l’arbre à pain.
Le croissant formait la visière d’une casquette plaquée sur la tête, jusque sur la nuque, et l’armature sur laquelle repose la lourde coiffe de plumes qui la couronne. Ce plumet était composé de longues plumes caudales de coq, noires et soyeuses, les plus belles que j’aie jamais vues, dont celles du milieu atteignaient les deux pieds de long (* 60cm). Elles étaient étroitement accolées à la visière de telle manière à former un éventail pointu en travers de la tête ; les plumes du centre se dressaient à la verticale, puis prenant une forme oblique jusqu’aux dernières, les plus basses, aux extrémités, leur retombaient largement sur les épaules. Leurs pointes qui tombaient du sommet pour couvrir leur front (157), se chevauchant de chaque côté en une courbe régulière, jouaient dans le vent avec la grâce des plumes d’autruche, conférant au spectacle une touche de luxe et de bon gout qu’aucun ornement parmi ceux observés dans le pays précédemment ne nous avait donné à imaginer.
Leurs oreilles étaient entièrement cachées par des ornements de bois léger blanchis à la chaux. La partie antérieure de ces derniers est parfaitement plate et ressemble à une oreille humaine mais en beaucoup plus grand ; sur la partie arrière, des tenons enserrent le lobe percé de l’oreille à travers lequel passe une longue tige qui maintient le tout. Des colliers de dents de cachalot ornaient leur torse, et des touffes de cheveux humains frisés pendaient à leurs poignets et à leurs chevilles. Autour des reins, d’autres touffes de cheveux étaient accrochées au-dessus de leur grand pagne de tapa blanc. De courtes capes du même tapa, maintenues par un nœud sur la poitrine, et de longues lances, complétaient le costume.
Jamais auparavant il ne m’avait été donné l’occasion d’assister à un spectacle aussi soudain et impressionnant que l’apparition brutale de ces deux personnages. Leurs nobles coiffes ondulant fièrement dans le vent, leur allure intrépide, leurs muscles dénudés et bronzés et tous leurs attributs sauvages, les faisaient ressembler, en cet instant, à des géants. L’Indien d’Amérique couvert de ses peintures de guerre les plus hideuses ne soutiendrait pas, je crois, la comparaison avec l’un de ces guerriers redoutables et majestueux.
La conviction de nous voir rejoindre leur tribu, les Teii, en guerre contre les Taipi, s’était rapidement répandue dans la vallée et, dès qu’ils aperçurent notre groupe, nous comptant parmi leurs alliés indéfectibles, ils se précipitèrent sur le sentier, criant de joie, d’exultation et de triomphe, simulant une attaque en se lançant dans une posture sauvage et menaçante, le regard mauvais de férocité et de vengeance, (158) brandissant leurs lances, les agitant en tous sens, prêts à transpercer l’ennemi : « Taipi ! Taipi ! Te mate i te Taipi ! » -- « Taipi ! Taipi ! Mort aux Taipi ! ». Après quoi, éclatant d’un rire tonitruant, et nous signifiant qu’avait déjà commencé la fête à laquelle nous nous rendions, ils reprirent avec entrain leur course vers la plage.
Nous descendîmes alors dans une grande vallée (* Teuhitua) dont les crêtes forment la frontière orientale de la baie de Taiohae. Pendant les deux milles qui suivirent (* 3.2km), notre marche prit un caractère très différent de celui du chemin que nous avions emprunté à travers les collines dénudées de l’autre côté ; nous avancions complètement recouverts de l’ombre de profonds bosquets d’arbres à pain, de cocotiers et d’autres grands arbres dont les frondaisons nous laissaient à peine entrevoir le ciel. Les habitations étaient très dispersées et généralement plus grandes et plus soignées que celles des cultivateurs et des pêcheurs des îles Sandwich. Elles étaient toutes conformes à la description déjà donnée. Les hautes plateformes sur lesquelles elles sont élevées leurs confèrent un air de propreté et de confort sans pareil, et contribuent évidemment à la bonne santé des habitants en les protégeant de l’humidité du sol. La plupart des occupants étaient partis à la fête ou à la pêche, mais ceux que se trouvaient là nous saluèrent amicalement de tous côtés.
Au terme de trois milles (* 4.8km), notre chemin changea encore d’aspect et prit la forme d’un sentier humide et encaissé courant, solitaire, le long du lit d’un torrent qui avait cessé de gronder depuis longtemps, et qui plongeait soudain sur la grève. Fort heureusement, le gazouillis des oiseaux cachés dans les buissons à l’entour égaya cette portion du trajet et nous redonna le sourire. Après avoir traversé le cours d’eau, nous émergeâmes de l’ombre des grands arbres et arrivâmes bientôt près d’un autre ruisseau, au pied d’une haute colline escarpée, longue d’un demi-mille (* 800m) (159). C’est l’un des éperons rocheux dominant la crête qui borde la vallée de Taiohae avec laquelle il forme la frontière entre les tribus. Peu d’escaliers sont aussi pentus ; sans l’assistance des encoches laissées en zigzags par les pas des insulaires, et les touffes de longues herbes à l’aide desquelles nous progressions en nous y agrippant, il nous eût été quasiment impossible d’atteindre le sommet.
Nous étions si proches du flanc de la montagne qu’aucun souffle d’air ne nous parvenait ; avec le soleil qui déversait ses rayons brulants sur nos épaules, jamais auparavant aucun effort ne m’avait autant épuisé. Les forces et la détermination de quelques-uns parmi nous avaient presque atteint leurs limites ; un officier, au bord de l’évanouissement, faillit même tomber dans le précipice, et l’un des Naturels qui le suivait dut le charger sur son dos et le porter jusqu’au sommet. Sans les rafraîchissements d’eau de coco qui nous avaient permis d’entretenir notre vigueur, et dont les Naturels nous avaient abondamment abreuvés tout au long du chemin en compensation de quelques modestes rations de tabac, jamais nous ne serions venus à bout de cette colline, et nous aurions certainement renoncé à notre excursion alors que nous nous trouvions à peine à deux milles (* 3km) de distance du but. Il est à remarquer, cependant, qu’en 1814 (* Octobre 1813, très exactement), les insulaires transportèrent au sommet de cette même montagne un canon de calibre neuf pouces (* 26cm), que le Commodore Porter leur avait confié afin de mettre un terme au conflit avec les Hapaa. Il est presque incroyable qu’ils aient pu transporter en haut d’un tel précipice, et à la seule force de leurs poignets, un canon de cet acabit ; et pourtant, c’est la pure vérité.
Le Vincennes à l’ancre, réduit à la taille d’une canonnière, la silhouette diffuse de Uapou loin vers le sud, et la vaste étendue océanique se fondant imperceptiblement dans de le ciel : depuis le sommet, la vue circulaire sur la baie et la vallée offrait au regard un spectacle mêlé de beau et de sublime. (160) C’est aussi là-haut que nous saluâmes de nos cris de joie les alizés d’est qui nous rafraîchirent et nous revigorèrent tout le reste de notre excursion. En gagnant de la hauteur, nous atteignîmes le territoire Hapaa ; sur notre droite, on nous montra une petite prairie d’un demi-mille (* 800m) de large, scène de la première escarmouche du Commodore Porter contre cette tribu. Arrivés à son extrémité, nous surplombâmes une vallée intérieure leur appartenant dans laquelle se déroulaient les festivités vers lesquelles nous nous dirigions d’un pas vif. Au-delà de cette vallée, encore plus loin vers l’est, à une distance de quatre ou cinq milles (* 6 ou 8 km), on nous indiqua le pays et les habitations des Taipi, une race qui était au centre des conversations de tous et, apparemment, l’objet de toutes leurs craintes.
Depuis la crête, nous entamâmes notre descente vers notre destination ; nous traversâmes de faibles pentes herbeuses sans rien rencontrer qui fût digne d’intérêt jusqu’à nous en trouver à moins d’un demi-mille (* 800m). À cet endroit-là, nous enjambâmes un joli ruisseau dominant une belle cascade de quinze ou vingt pieds de haut (* 4 ou 6m), puis nous longeâmes le cours d’eau bouillonnant, bordé de bosquets d’arbres à pain et de cocotiers parmi lesquels étaient dispersés les cottages et les plantations ; c’est là que le son lugubre et monotone des tambours et de la musique provenant de la fête vint nous heurter les oreilles pour la première fois. En devenant de plus en plus distincts, ces grondements nous firent accélérer le pas jusqu’à ce que, ayant aperçu notre groupe, une foule de Naturels en tenue de fête, se précipita à notre rencontre, nous accueillant avec des cris de joie. En pénétrant ainsi dans cette foule, et en y jetant un rapide regard circulaire, on était comme transporté à l’époque de Cook et des premiers navigateurs à s’aventurer sur ces mers, que la découverte de l’existence et des coutumes de peuples nouveaux n’avait surement pas manqué de surprendre, de charmer, voire de fasciner.
Le sous-bois est un de ceux que les Muses en personne auraient aimé fréquenter. (161) Des arbres majestueux embrassent le tohua ou aire de danse qui borde le torrent. Leurs cimes élevées sont si étroitement imbriquées les unes dans les autres qu’elles ombragent complètement le vallon et que, au lieu de nous accabler de leur brûlure éclatante, les rayons du soleil, qui nous avaient écrasés le long du chemin, enveloppaient les groupes de danseurs d’une douceur accueillie avec reconnaissance.
L’assistance était composée de plusieurs centaines de gens des deux sexes, chacun portant les tenues conformes à leur rang social. Les plus remarquables du lot étaient les guerriers en livrée de combat et les danseurs aux parures fantaisistes ; à l’évidence, chacun avait apporté le plus grand soin à la préparation des vêtements, surtout les femmes. Pour rendre justice aux Hapaa, je dois admettre que le soin porté à leurs tenues de tête et à leurs capes illustre parfaitement la grâce et le bon gout dont ils savent faire preuve, une élégance qui aurait fait leur renommée dans les cercles les plus raffinés de la mode en dehors de leurs îles cerclées d’océan.
Le blanc est la teinte la plus courue, particulièrement pour ce qui concerne l’embellissement de la tête. Leurs turbans adoptent des styles variés ; le plus ordinaire se compose d’une pièce d’étoffe indigène enserrant bien la tête, et dont les extrémités forment un gros nœud ornant le front, ou un côté de la tête au-dessus des tempes. Les autres disposent d’extrémités plus longues se terminant en houppettes ou cocardes sur le sommet ou les côtés. Pour d’autres encore, une échancrure permet à la chevelure bien maintenue de retomber en bouclettes sur le cou et les épaules. Certaines femmes ne portent qu’un filet ou un bandeau, avec ou sans ruban pendant aux extrémités ; nombreuses, enfin, sont celles qui laissent leurs tresses de jais complétement libres de flotter négligemment sur leurs capes.
Ici, les femmes portent moins fréquemment le « pau » qu’aux îles Sandwich (* Hawaiien : pā’ū ; jupon de tapa nommé kāèu/èuèu aux Marquises ; ou pareu à Tahiti d’où provient le mot français paréo.) Le seul vêtement qu’elles affectionnent (162) particulièrement est le kahu, ou grande cape, dont les Hawaiiens se couvrent eux-mêmes pour se protéger de la fraîcheur vespérale ou matinale. Tantôt elles en resserrent les plis autour de la taille, tantôt elles le laissent flotter librement sur les deux épaules ou sur une seule ; parfois elles le portent d’un bras laissant l’autre dénudé.
Jusqu’à aujourd’hui, tout ce que j’avais vu en bord de mer m’avait conduit à me demander si, conformément à leur réputation, les Naturels de cet archipel ne formaient pas une race vraiment plus belle, un peuple plus raffiné que les insulaires des îles de la Société et des îles Sandwich. Mais à l’aune de leurs représentants rencontrés à cette fête, je suis désormais persuadé qu’ils jouissent de toutes ces qualités, tout particulièrement les femmes. Nombreuses parmi les présentes étaient d’une beauté remarquable ; leurs traits se rapprochent beaucoup plus de ceux des Européennes que de ceux de la plupart des peuples primitifs que j’ai rencontrés. Beaucoup d’entre elles ont le teint clair, à peine plus sombre, en tous cas, qu’une jolie brunette ; avec parfois, une subtile carnation des lèvres et des joues. Bien qu’elles soient plutôt petites, la délicatesse de leurs mains et de leurs bras soutiendrait la comparaison dans les salons de la noblesse la plus policée.
À la différence des indigènes observés sur la plage de Taiohae, nous avons remarqué un teint généralement plus clair parmi cette assemblée ; il faut l’attribuer à l’humidité plus forte qui règne dans ces montagnes, ainsi qu’à l’ombrage permanent porté par les grands arbres sur les habitations de cette vallée. Mais pour de nombreuses femmes, ce teint inhabituellement diaphane est le résultat d’un artifice suivi d’un isolement presque total à l’abri des rayons du soleil. Le suc d’une petite liane indigène nommée papa (* pāpā : derris elliptica) la propriété de blanchir la peau ; chaque matin, celles qui recherchent la clarté de teint se lavent de cet onguent, s’enveloppent ensuite dans leur vêtement et restent cloîtrées la plus grande partie de la journée. Et si elles doivent mettre le pied dehors, elles se protègent sous une grande et large palme de latanier (163) qui leur sert d’ombrelle. Elles terminent la journée par le bain habituel.
À l’approche de festivités, à l’arrivée d’un navire ou à l’occasion de n’importe quelle manifestation publique, elles plongent dans un cours d’eau afin d’éliminer toute trace verdâtre de la liane papa, puis s’enduisent soigneusement le corps d’huile de coco, et se parent de leurs plus beaux atours. Nombreuses sont celles qui ajoutent à l’huile le suc jaune pâle du curcuma ou une mixture à base du même rhizome cuit au four qui est d’une teinte orange vif (* La fabrication de ce parfum, èka moa, était le monopole des Hapaa, et le processus en a été décrit par William Pascoe Crook ; voir bibliographie). De la sorte, elles sont certaines de conférer à leur peau une beauté nouvelle qui n’a pourtant rien de ragoûtant pour l’œil civilisé.
Parmi les hommes, il existe une catégorie, du genre dandy je suppose, qui adopte l’usage féminin du suc de la liane papa, qui évite les rayons du soleil et qui, ce faisant, fait le sacrifice des privilèges du tapu. En leur qualité de chanteurs ou de danseurs aux festivités publiques, ces hommes tombent de toute façon sous le coup des restrictions.
À notre arrivée, les chants et les danses s’interrompirent à peine quelques instants, faisant cesser l’agitation et les cris mais, dès que les chefs nous eurent accueillis et installés aux places d’honneur d’où le spectacle était le mieux visible, les festivités reprirent.
Ce tohua, ou théâtre, est une structure, en tous points supérieure à celle visitée la veille ; il est si massif et si bien construit que sa longévité ne fait aucun doute. C’est une place de forme oblongue, de soixante pieds de long et de quarante de large (* 18m x 12m). Le mur d’enceinte est constitué d’énormes pierres ou dalles de rocher, de trois pieds de haut (* 1m), dont beaucoup font de quatre à six pieds de long (* 1.20m à 1.8m), étroitement jointes entre elles, et taillées avec une régularité et une finesse vraiment étonnantes si l’on considère la rusticité des outils employés.
Au niveau du sommet de ce mur, tout autour de ce théâtre, s’étend un vaste pavé de dalles de pierre, larges de plusieurs pieds. (164) Elles forment des sièges pour les chefs, les guerriers, les personnalités de haut rang ainsi que pour les chœurs et les chanteurs déclamant les récitatifs qui accompagnent les danses. Plus bas de quelques pouces, sur un autre pavage encore plus vaste, sont disposés de gros cailloux plats installés à un intervalle de six ou huit pieds (* 1.8 à 2.4m), servant de sièges aux batteurs de tambours ou d’autres instruments grossiers ; en contrebas, une aire de terre battue, d’environ vingt pieds de long sur douze de large (* 6m x 3.6m), constitue la scène sur laquelle les danseurs exhibent leur art.
Dans la partie du spectacle à laquelle il nous fut donné d’assister, les danseurs étaient un jeune chef de dix-huit ou vingt ans qui se tenait à une extrémité de l’aire de danse ; aux deux autres coins, à l’autre extrémité, lui faisaient face deux garçonnets de huit ou dix ans. La musique, si l’on peut la nommer ainsi, provenait de quatre tambours placés de chaque côté du pavé central ; les voix et les forts battements de mains montaient des cent cinquante chanteurs environ, installés sur la plateforme supérieure avec les chefs et les guerriers.
Les tambours étaient petits, mesurant pas plus de deux pieds et demi de haut (* 75 cm) et un pied de large (* 30cm), taillés dans un tronc de tou (cordia) (* Le noyer d’Océanie, cordia subcordata) évidé jusqu’au sommet sur une épaisseur d’un pouce (* 2.5cm) et sur les deux tiers de la longueur. Le pied était aussi évidé, laissant entre les deux parties une séparation percée d’un petit trou au centre. Les couronnes étaient recouvertes d’une peau de requin attachée à une tresse plate de fibre de noix de coco, d’une manière tout à fait identique à celle que nous employons pour ligaturer nos tambours. Ils sont posés sur le sol, à la verticale, devant le batteur qui le frappe rapidement, uniquement avec les mains, les doigts collés, tandis que l’avant-bras repose sur le bord. De longs orifices ovales, taillés tout autour de la partie inférieure, sont destinés à amplifier le son.
Un lent battement de tambour marqua le début de la danse qui continua sur de gracieux mouvements des mains, des bras et des pieds, au même rythme ; quand celui des tambours s’accéléra (165), l’enthousiasme devint intense. Les chants débutèrent aux premiers pas des danseurs qui participaient eux-aussi soit en solo soit en duo, et auxquels répondaient l’orchestre ou le chœur.
De par l’élégance de ses traits et de sa silhouette, le principal danseur était d’une beauté incomparable ; il n’était pas très grand mais de proportions admirables. L’usage de la liane papa, et sa retraite à l’abri des rayons du soleil, lui avaient conféré un teint aussi clair que la plupart d’entre nous.
Sa tenue comportait peu d’ornements. Elle se composait d’une grande quantité de barbes blanches frisées, portées très haut, faisant le tour de la tête tandis que de grosses touffes de cheveux humains noirs pendaient à ses poignets et ses chevilles ; son pagne était formé d’une énorme quantité d’étoffe blanche qui lui enserrait la taille.
La tenue des garçonnets était beaucoup plus étonnante et fantaisiste. Le premier portait un cimier de plumes et des ornements de guerrier aux oreilles et autour du cou ; le couvre-chef et le plumage étaient aussi hauts que lui. Au-dessus de son pagne, une longue bande d’étoffe blanche était fixée par devant en un gros nœud dont les longues extrémités pendaient de chaque côté. À cette bande d’étoffe étaient accrochées quatre cordelettes de tapa tressé, deux devant et deux derrière, dont les extrémités se terminaient par d’énormes touffes de cheveux noirs fixées à des pièces de bois rondes, plates et blanchies à la chaux. Sa taille, ses poignets et ses chevilles étaient aussi ornés de touffes similaires ; dans chaque main, il tenait une touffe blanche plus petite.
La tenue de tête du second était un épais bandeau d’étoffe blanche roulé autour du front ; au-dessus, surmontée d’un grand ornement de tapa blanc, une couronne de plumes noires s’avançait en plis sur le devant pour former une cocarde se déployant en éventail comme une queue de paon, pour générer un ensemble aérien et d’un gout exquis. Son collier se composait de couronnes de fleurs de jasmin du Cap et d’une liane aromatique très brillante (166) ; des guirlandes des mêmes fleurs étaient entrelacées dans les plis réguliers de son pagne immaculé.
La danse cessa au terme de vingt ou trente minutes ; un groupe d’une cinquantaine de jeunes femmes, assises sur une haute plateforme toute proche, entonna alors un chant triste et monotone où se répétaient inlassablement la même mélopée si caractéristique de tous leurs chants, tandis qu’elles frappaient en cadence dans leurs mains ajustées en creux afin de produire un son très particulier. Dans le but de comprendre ce dont nous étions les témoins, nous posâmes les questions qui nous firent découvrir les raisons de cette cérémonie.
Quelques mois auparavant, on avait demandé à ces filles de préparer un certain nombre de chants ; conformément aux lois du tapu, elles avaient été placées à l’écart de la population jusqu’à l’accomplissement de leur tâche. La fête d’aujourd’hui marquait le lever du tapu consécutif à cet aboutissement, mais ce n’était qu’une fête ordinaire, pas assez intéressante pour attirer les foules qui se pressent habituellement aux célébrations plus éclatantes.
Ces manifestations sont connues sous le nom générique de koìka. On les célèbre à une grande quantité d’occasions, mais les plus célèbres sont celles organisées à l’occasion des rassemblements organisés pour la récolte des fruits à pain, et en cas de ratification d’un traité de paix à l’issue de guerres entre tribus.
La passion de ces gens pour cette sorte de divertissement est telle qu’afin d’y participer, ils n’hésitent pas à y apporter leur nourriture de toutes les vallées, et à se lancer dans de longues et épuisantes traversées de leur île. Pour se rendre dans une autre île, ils n’hésitent pas, non plus, à s’exposer aux multiples dangers d’une traversée sur leurs embarcations délabrées. De surcroit, une fois sur place, ils risquent de perdre la vie dans les conflits qui ne manquent pas d’éclater à la clôture des festivités, et auxquels chacun est tenu de participer, d’un côté ou de l’autre. (167)
Les chanteurs professionnels, appelés kaìoi, sont les poètes, les compositeurs et les interprètes des chants entendus en ces occasions. Les sujets sont variés, souvent fournis par l’actualité, l’escale d’un navire ou n’importe quel incident passé. Fréquemment, il arrive aussi que, tout comme pour les ballades de notre pays, certains de ces chants deviennent très populaires et finissent par être adoptés par toutes les classes de la société. Ils regorgent presque tous de langage et d’allusions obscènes, tout comme les conversations de chaque jour, et parfois à un degré abominable, au-delà de tout entendement.
J’étais trop occupé à prendre des notes pour prêter attention à tous ces mots souvent répétés ; ce que j’en savais me suffisait, et je trouvais bien heureux de ne pas avoir à les retenir.
Avant même la fin de festivités, la grossièreté de la foule qui nous entourait se fit vraiment dérangeante, et tout portait tellement à croire que la débauche allait s’en suivre, que le charme du début, porté par la nouveauté et la beauté sauvage de la scène, se brisa soudain. Accompagné de deux ou trois amis, je repris le chemin du navire, bientôt suivi de tout le groupe.
Dans mon cas, le but principal de cette excursion était de voir le paganisme à l’état pur (le paganisme dont l’obscurantisme n’a jamais été touché par un seul trait de lumière chrétienne) afin que ce dont je serais le témoin visuel me permette d’en attester l’existence même. Et je peux vous assurer, mon cher H_____, que ce but a été parfaitement atteint. Avant même que mes yeux aient subi la moitié du spectacle, depuis le tréfond de mon âme, je voulais crier « Arrêtez, ça suffit ! » mais c’était trop tard, l’évidence s’imposait à moi dans tous ses détails les plus abominables.
Les danses étaient moins licencieuses que ce à quoi je m’attendais, mais tout le reste, en des centaines d’exemples, regorgeait de tant d’atteintes grossières à la décence (168) que je m’empressai de fuir, dégouté de ces horreurs, si mortifié en ma qualité d’homme, si déprimé par la dépravation et la culpabilité de l’être humain, que je ne pouvais penser à rien d’autre. Je ne pus même pas trouver la force d’échanger quelques mots avec mes compagnons, et je partis en tête de file afin qu’ils ne puissent comprendre le degré de détresse qui m’oppressait.
J’avais atteint une telle prostration que, pour la première fois de ma vie, je crois, non pas dans un esprit de rébellion, mais porté par une profonde angoisse, j’ai levé les yeux au ciel et me suis exclamé : « Oh ! Pourquoi le péché a-t-il été autorisé à entacher un monde par ailleurs si pur ! Pourquoi a-t-il été autorisé à corrompre la gloire la plus illustre de l’homme et, jusque dans les pays les plus reculés, parmi toutes les classes de la société, en des circonstances beaucoup trop nombreuses, pourquoi a-t-il été autorisé à le déchoir au niveau de la bête ! ». Toi, ô Dieu, Tu le sais car Tu es Sagesse ; et par Ton Saint nom béni, Tu es aussi Bonté et Vérité ; « Justice et Sagesse sont les demeures de Ton trône ! ».
_________
LETTRE XXVIII
FORME DE GOUVERNEMENT
DISTINCTIONS CIVILES ET RELIGIEUSES
Baie de Taiohae à Nuku Hiva,
Le 30 juillet 1829
Le Capitaine Finch a quitté le navire tôt ce matin, accompagné d’un groupe d’officiers, afin de se rendre par voie de mer dans une vallée appelée Taioa, située à une distance de quatre ou cinq milles (* 6.5 ou 8km) à l’est de notre port. La première section de notre équipage, quarante hommes au total, ont aussi quartier libre à terre. Néanmoins, comme le temps est humide et pluvieux, et que de fortes rafales de vent soufflent de la montagne, je vais rester à bord pour faire « hana paa » comme disent les Naturels, c’est-à-dire « faire jeûne » ; c’est un renseignement sur les coutumes de cet archipel que j’ai recueilli par d’autres moyens que la simple observation visuelle. (169)
C’est la première fois que j’évoque cette grande différence de forme de gouvernement et de politique économique entre ce pays, les îles Hawaii et celles de Tahiti. La structure monarchique bien organisée qui caractérise ces deux derniers archipels d’une manière si manifeste et si précise dans ses moindres détails, cette structure monarchique n’a aucun cours ici. Au lieu d’une hiérarchisation régulière, du paysan jusqu’au roi, avec les honneurs et les privilèges dus à chaque rang, la seule distinction civile que l’on connaisse ici n’a aucun lien apparent ou réel avec le rang social ou le pouvoir.
Que sa traduction soit « tête », « chef », prince » ou « roi », le titre héréditaire de « hekaiki » (* hakāìki) ne garantit aucunement les prérogatives de souveraineté à celui qui le porte ; il n’a pas plus de pouvoir qu’un seigneur écossais d’autrefois sur son clan. Aucun privilège juridictionnel ne lui est attaché, pas plus que le droit de lever des impôts ou d’exiger un quelconque service de sa population. De la sorte, l’influence de l’individu jouissant d’un titre qui ne donne pouvoir ni sur le droit de propriété ni sur le droit des personnes, le rapproche plus du citoyen aisé, respecté et populaire parmi la communauté où il réside, que du prince ou du seigneur sur ses sujets, ou sur les esclaves d’une colonie tombée dans l’anarchie.
Si un chef convoite de la nourriture ou une terre appartenant à une personne du commun, il doit l’obtenir par le biais du troc ou en persuadant le propriétaire de l’offrir de son plein gré, sans se servir de son rang ou de son titre. S’il a besoin d’aide pour une de ses entreprises, comme construire une nouvelle maison, enclore une parcelle ou récolter des fruits à pain, il ne peut parvenir à ses fins qu’en se conformant à la coutume consistant à organiser un festin, à y inviter la population et à y faire part de son projet en espérant que tous les convives y adhéreront. (170) Tels sont l’état général de pouvoir limité et la situation de dépendance dans lesquels se trouvent les chefs.
Par voie de conséquence, puisque l’absence d’autorité lui permet de vivre sans contrainte et sans lois., la liberté du peuple est tout aussi grande. Si un homme est agressé par un autre, au lieu d’aller se plaindre au chef et de chercher réparation en conformité avec une loi quelconque du pays, il se charge immédiatement de se venger arbitrairement en utilisant la violence et la mort. Dans le cas contraire, si le pouvoir et l’autorité de l’agresseur empêchent la victime de se venger de la sorte, tout en se tenant à quelque distance, il décharge sa colère en gesticulations féroces et en une logorrhée de réclamations contre l’atteinte à ses droits.
Tel est l’état de la relation existant ici entre les chefs et le peuple : elle confère au premier une influence et une autorité réduites, et n’exige du dernier que des marques de respect et de bonne volonté.
Je suis absolument incapable de classer cette forme de gouvernance. Bien qu’elle soit simple et primitive par certains de ses aspects, y associer la barbarie qui caractérise cette race nuirait à la représentation magnifique que nous nous faisons d’un état patriarcal vénéré. De fait, avec toute la déférence que je dois à la dignité de notre bienheureux gouvernement, je suis très tenté de le qualifier de (Me pardonnerez-vous ?) république « à la sauvage », au sein de laquelle tout homme est seul représentant de ses propres droits et seul légiste, libre à tout moment d’exercer le pouvoir exécutif après s’être acquitté avantageusement de la fonction de juge !
Le titre militaire de Toa, ou Chef des Guerriers, est distinct de celui de Hakāìki, ou chef civil, bien qu’ils soient souvent une seule et même personne. (171) Tout comme pour ce dernier, le titre n’est que nominal, et ne procure à son possesseur aucun droit de commandement ou de contrôle sur les autres. Même en temps de guerre, un Toa n’a d’autre autorité que son exemple qui incite ses camarades de combat à avancer sur le champ de bataille, ou par lequel il leur indique les mouvements à exécuter après le début des hostilités ; mais chacun se bat ou fait retraite à sa convenance.
Bien que la population soit ainsi libre de toute contrainte civile ou militaire, elle subit néanmoins le joug d’une tyrannie de fer, la tyrannie que la superstition fait peser sur ces cœurs et ces esprits perdus dans les ténèbres de l’ignorance et du péché ; c’est dans leur doctrine idolâtre que résident l’origine et les instruments de leurs commandements les plus visibles et les plus influents.
J’ai déjà exposé la division générale de la population entre la classe tapu et la classe commune ; j’ai aussi déjà indiqué les restrictions les plus remarquables imposées aux femmes et aux personnes de leur cercle. Mes remarques vont maintenant se tourner vers la classe tapu.
Celle-ci comporte des subdivisions qui sont fermement définies, dans leurs superstitions, par les degrés de vénération et de pouvoir attachés aux personnes qui en font partie.
Les quatre niveaux les plus élevés de la classe tapu sont ceux des Atua (* Etua : divinité ; Dieu), des Taua (* Tāuà : grand-prêtre, prophète), des Tahuna (* Tuhuka : chantres et maîtres en tout genre) et des Uu (* Ùu : les serviteurs des prêtres-tāuà) ; ce sont les dieux, les prophètes ou sorciers, les prêtres et leurs serviteurs lors des sacrifices humains (* En italique dans le texte original). Tous les autres hommes, en dehors de ceux que différentes causes énumérées précédemment ont réduit à la caste commune, constituent une classe générale inférieure.
Le mot « Atua » (* Etua), qui désigne le degré le plus élevé, est le terme rencontré, sans modification majeure, dans tous les dialectes polynésiens, pour désigner les êtres supérieurs vénérés comme divinités au sein du système polythéiste de ces peuples. (172) Aux îles Washington (* Le groupe nord-ouest), les Atua ou faux-dieux des habitants sont légion et sont dotés de pouvoirs et de caractères variables. Outre ceux qui commandent respectivement aux éléments et à leurs manifestations les plus marquantes, on trouve les Atua de la montagne et de la forêt ; du bord de mer et de l’intérieur des terres ; les Atua de la paix et de la guerre ; des chants et des danses ; et de toutes les occupations et divertissements fournis par la vie.
Les insulaires croient aussi que l’esprit des défunts devient Atua, ce qui provoque une multiplicité de dieux qui se manifestent dans presque tous les bruits de la nature ; du hurlement de la tempête dans la montagne et du grondement du tonnerre dans les nuages jusqu’au soupir de la brise dans la cime des cocotiers et aux bruissements d’un insecte dans l’herbe ou dans le chaume de leur cabane, tout est considéré comme la manifestation d’un dieu.
Mais le terme de Atua employé dans la classe tapu ne se réfère à aucun de ces être imaginaires ; il est revendiqué par des hommes de chair et d’os qui se réclament du titre et des attributs divins ; ils ne se prétendent pas inspirés ou possédés par une force et une influence supérieures ; non, ils sont divinisés de plein droit, tout comme les déités qui contrôlent les éléments, qui répandent la fertilité sur les terres ou qui les accablent de désolation et de sécheresse, et qui exercent leurs prérogatives divine en répandant la maladie et en brandissant les spectres de la mort. Ils sont peu nombreux, pas plus d’un ou deux par île, et ils vivent reclus en mystiques à l’unisson de leurs prétentions blasphématoires. Il n’y en a pas en ce moment à Taiohae ou dans ses environs bien qu’on nous ait désigné du doigt la demeure de l’un d’entre eux, au pied d’une falaise abrupte dans la montagne.
Le Révérend Crook dresse le portrait d’un Atua de l’île de Tahuata dans les îles Marquises ou Îles du Vent, lors du séjour temporaire (173) qu’il y fit en 1797 en sa qualité de missionnaire au service de la Société Missionnaire de Londres : « Il est maintenant fort avancé en âge et il vit depuis son enfance à Hanatetena, dans une grande maison entourée d’une clôture appelée « A » (* « A/À/Â », lieu sacré ; Dordillon 1903, p. 103). À l’intérieur de l’habitation se trouve un autel et, suspendues aux poutres à l’intérieur, et à tous les arbres à l’entour, des carcasses humaines pendent la tête en bas, le crâne scalpé. Nul autre que son serviteur n’est autorisé sur les lieux en dehors des cérémonies où des humains sont offerts en sacrifice. Il reçoit plus d’offrandes humaines que tous les autres dieux. On le voit souvent sur le pas de porte, assis sur un treillis de branchages surélevé, qui réclame deux ou trois victimes d’un coup. On le vénère dans toutes les parties de l’île et, de partout, on lui fait des offrandes qui sont apportées à Hanatetena. »
Bien que cela soit parfois le cas, il ne semble pas que les honneurs et les pouvoirs de cette classe soient toujours héréditaires. Sa perpétuation dépend principalement de la détermination de ceux qui ambitionnent d’en faire partie, ainsi que du talent et de l’art qu’ils manifesteront à s’imposer face à la crédulité de leurs congénères.
Dans l’ordre d’influence, immédiatement en-dessous de ces prétendues divinités, les Taua forment un groupe beaucoup plus nombreux et plus accessible. C’est l’un d’entre eux qui est monté à bord, il y a deux jours, en compagnie de Haape et Piaroro lors de leur première visite d’état, et que j’avais qualifié de personne distinguée de la tribu des Taioa. Il se nomme Tauahania et, c’est à son invitation que le groupe des officiers s’est déplacé dans cette vallée aujourd’hui. (* C’est avec ce même Tauahania que Camille de Roquefeuil, capitaine du Bordelais, échangea son nom (Roki) lors de son escale à Nuku Hiva de décembre 1817 à février 1818). Ayant fait la connaissance d’un des membres de cette classe, je me sens qualifié pour en parler d’une manière à la fois plus extensive et plus intelligible.
La charge et la réputation des Taua paraissent les lier étroitement aux Atua. En effet, bien qu’ils ne se prétendent pas dieux, ils se croient détenteurs d’un don héréditaire d’inspiration divine et du pouvoir d’être habités par les dieux. Et ce sont principalement (174) des individus de cette classe qui s’aventurent à usurper le nom et la dignité des Atua.
Leur nature est une combinaison du sorcier et du prophète. Souvent, la nuit, interrogeant d’une voix aigüe, vociférant d’une manière sauvage et incohérente, puis donnant des réponses d’une voix normale, ils prétendent faire la conversation avec un dieu intérieur. Ou bien, froissant des feuilles entre les doigts, ils disent que le dieu leur a fait miraculeusement traverser le chaume et les a ramenés par la porte. Pendant leurs crises d’inspiration, ils font des convulsions, fulminent du regard et, les mains agitées de tremblements violents, courent en tous sens et prophétisent d’une voix criarde la mort de leurs ennemis. Et parfois, ils réclament des victimes humaines pour le dieu par lequel ils sont possédés.
Bien que toutes les opérations chirurgicales soient effectuées par une caste différente, seuls les Taua peuvent agir en qualité de médecin. Ils croient que tout désordre intestinal est causé par un dieu qui, à cette fin, a pris possession de la personne concernée que l’on nomme « mate no te Atua », « maladie provenant d’un dieu » ; de par leur inspiration divine, ce sont les Taua seuls qui ont le pouvoir de traiter le mal. Lorsqu’on va les quérir pour soigner un malade, leur technique principale consiste à palper le corps de la personne afin d’y trouver le mauvais esprit qui, une fois capturé, est étouffé par les manipulations. C’est aussi de cette manière qu’ils prétendent porter la mort à tous ceux qui provoquent leur mécontentement. Pour soigner une autre maladie, ils placent le patient dans l’eau, et invoquent un dieu tout en battant l’eau de branches d’arbre et en lui en versant sur la tête.
Croyant que ses membres deviennent des dieux à leur mort, cette classe est tenue en grande révérence par l’ensemble de la population. En conséquence, la mort de l’un d’entre eux engendre toujours des sacrifices humains et, afin de capturer les victimes nécessaires, le décès d’un Taua est, en période de paix, le signal infaillible d’incursions prédatrices chez les tribus avoisinantes (175), et l’occasion de batailles féroces en temps de guerre. Bien que l’ordre des Taua constitue un des degrés les plus élevés de la classe tapu, il n’y a pas que des hommes à prétendre posséder les qualités du personnage ; et, même si elles ne sont pas aussi nombreuses et influentes, on rencontre des femmes Taua dans toutes les tribus de l’île.
En-dessous des Taua, mais appartenant, peut-être, à la même classe, on trouve les Tahuna (* Tuhuka), ou prêtres, qui forment un groupe plus nombreux, mais au caractère moins redoutable, et aux prétentions moins présomptueuses que le précédent. Contrairement aux pouvoirs supposés des Taua, leur charge n’est pas héréditaire mais conférée par l’ordination de ceux qui exercent cette fonction, et qui initient les novices à l’exercice de leurs obligations. Ces dernières sont nombreuses et variées, consistant principalement à offrir des sacrifices et à célébrer les cérémonies de leur religion idolâtre. De même, ils chantent les chants sacrés et battent le tambour de leurs temples, ils conduisent les rites funéraires, et réalisent quelques opérations chirurgicales telles que les soins portés aux blessures de guerre, la réduction de fractures et même, dit-on, les trépanations au moyen de dents de requin, en cas de blessure au crâne.
Les Tuhuka ont une tenue dont le couvre-chef est une sorte de casquette confectionnée dans une palme de cocotier. La tige fait de six à huit pouces de longueur (* 18cm à 24cm) ; elle est positionnée dans un axe perpendiculaire au front, et ses folioles, qui font le tour de la tête de chaque côté, sont finement attachées sur la nuque. En dehors de cet article, ils portent une cape du même matériau. La tige de celle-ci est fendue sur toute la longueur jusqu’à un pouce d’une extrémité ; elle passe ensuite de chaque côté du cou pour reposer sur les épaules, et ses extrémités sont attachées derrière ; les nervures des folioles ayant été retirées, l’ensemble pend élégamment sur la poitrine et dans le dos. Ces tenues (176) se portent habituellement lors de cérémonies ordinaires ; elles sont toujours de mise au cours des célébrations en relation avec leur charge.
Les offrandes faites à leurs dieux varient selon les circonstances ; des gerbes de fleurs, des noix de coco, des bananes, des fruit-à-pain, du poisson et de la volaille, des chiens, des porcs domestiques ou sauvages, des victimes humaines sont déposés au pied des idoles ou suspendus à des perches devant elles, tandis que retentissent des incantations.
De même, à chaque repas, avant que quiconque n’y porte la main, une portion de nourriture est jetée contre le faîtage, accompagnée de l’exclamation désinvolte adressée à un dieu : « En voilà un peu pour toi ! ». Qu’elle trouve son origine, ou pas, dans une vague notion de dépendance à la bonté et à la générosité d’une force surnaturelle, cette formule ne serait pas du gout de ceux qui, tout en bénéficiant de la lumière révélée, profitent jour après jour de tables garnies des riches présents de Dieu sans jamais exprimer la moindre reconnaissance ou gratitude.
L’essentiel de leur religion se manifeste principalement par des chants accompagnés de battements de tambour et des mains. Leurs chants sacrés sont pléthoriques, et la signification de nombre d’entre eux n’est connue que des prêtres. Selon le récit de M. Crook, l’un de ces chants est : « Une sorte de litanie chantée par le Tuhuka accompagné du grand tambour du temple (* Meàe) ; à son terme, elle est répétée par un autre Tuhuka selon la même tonalité. La voix traîne sur les notes et, en fin de mélodie, elle est prise de modulations saccadées et rauques. Une autre sorte de chant est un récitatif, déclamé d’une voix très violente par un prêtre impétueux ; il se termine en un son féroce, ressemblant à un aboiement, dirigé vers les spectateurs qui lui renvoient la réponse appropriée.
Toutes leurs traditions se manifestent dans leurs chants sacrés : l’origine fabuleuse de leurs îles, le nom des autres îles qui leur sont connues, (177) la généalogie de leurs chefs depuis leur origine, les festins donnés en mémoire de leurs héros, les histoires de leurs guerres et tout autre évènement dont ils ont le souvenir ou la connaissance.
Ils racontent qu’à l’origine, la terre formant leurs îles se trouvait à « Havaiki », ou région en-dessous, résidence des esprits des disparus, et qu’un dieu puissant les avait soulevées et placées là où elles se trouvent désormais. Ils disent qu’à cette période-là, la mer n’existait pas mais qu’elle fut enfantée plus tard par une femme en même temps que la faune et la flore. Ils disent aussi qu’à l’origine, hommes et poissons étaient prisonniers de grottes au fin fond de la terre, qu’elle s’est ouverte dans une grande explosion laissant les hommes à la surface et jetant les poissons dans la mer.
Dans leurs chants, ils énumèrent le nom de quarante-quatre îles en dehors des leurs. On y trouve, bien sûr, certaines des îles Georgiennes (* Îles sous le Vent) et de la Société, ainsi que la description d’un atoll qui n’a aucune ressemblance avec les leurs.
À propos de ces îles étrangères, une de leurs légendes explique l’introduction de la noix de coco chez eux. Elle raconte qu’un dieu venu d’une île qu’ils appellent « Oatamaaua », les trouvant fort dépourvus de cet arbre majeur, repartit en pirogue de pierre en chercher un, l’épisode étant raconté d’une manière tout aussi détaillée qu’incroyable. Ils possèdent aussi des récits de dieux venus d’autres îles et, dans leurs traditions, on apprend la raison pour laquelle ils appelaient « Atua/dieux » les premiers visiteurs venus d’Amérique et d’Europe, nom qu’ils continuent à donner à tous les étrangers. (* Les trois dieux tutélaires marquisiens qu’on ne voit jamais – Teuutoka, Teuuhua et Tehitikaupeka/Tehitikopeka – étaient « blancs » parce qu’ils n’étaient pas tatoués ; grâce à leurs pouvoirs surnaturels, ils n’avaient pas besoin de la protection du tatouage. Quand les premiers occidentaux sont arrivés dans l’archipel, les Marquisiens les ont appelés « ètua/dieux » parce qu’ils étaient blancs et non-tatoués. cf. Delmas, Op. Cit. P. 19)
Revenons aux Tuhuka, ou prêtres, et à leurs cérémonies. Parfois, ces derniers soulèvent délicatement un paquet appelé « dieu vêtu » (* ètua vāhī), formé d’une bûchette de bois enveloppée dans de l’étoffe, et à laquelle sont fixées quatre conques marines ; pendant cette élévation, (178) l’assemblée est debout et profère un jargon inintelligible. Parfois, un crâne humain dans une urne étrangement façonnée et ornée de fleurs, est soulevé de manière identique. De même, une palme de cocotier, tressée en forme de figure humaine et fixée à une longue perche, est transportée sur les épaules de deux hommes. Un grand-prêtre vocifère alors ce qui ressemble à une question et toute l’assemblée répond par un cri. Ils s’adonnent aussi à ces vociférations lorsqu’ils se trouvent en mer, sur leurs pirogues.
Au cours de ces cérémonies, apparaît fréquemment un morceau de bois au sommet duquel en est fixé un autre ; et aussi une petite pirogue ornée de cheveux humains. À d’autres reprises, c’est un hami ou pagne, ou tout autre article, qui est soulevé et gratifié d’une invocation fière et tonitruante. Au moment d’exécuter une opération chirurgicale, on élève de la même manière le fruste instrument d’ivoire ou d’os en direction d’une puissance imaginaire afin de bien associer au surnaturel le succès du chirurgien.
Les tambours sacrés sont de deux sortes : certains sont petits, et d’autres sont de grande taille. Les premiers, dont j’ai déjà donné la description, sont en tous points semblables à ceux utilisés lors des fêtes koìka. Les seconds sont beaucoup plus grands, de cinq à six pieds de hauteur (* 1.50m à 1.80m), et de quinze à vingt pouces de diamètre (* de 38cm à 50cm). Ils sont confectionnés de la même manière et avec le même matériau que les plus petits, à l’exception des couronnes qui sont recouvertes de peau de raie manta et non de peau de requin. On les bat aussi de la main et des doigts mais suivant un rythme solennel, parfois régulier, parfois composé de deux ou trois battements successifs entrecoupés d’une pause ; les tambours plus petits sont frappés de manière ininterrompue, sur un rythme très régulier dont le tempo vient combler les intervalles de silence des grands tambours.
Les battements de main accompagnant les chants et les tambours varient en tonalité et en rythme, un peu comme pour les grands (179) et les petits tambours. Les coups les plus lents et les plus forts se donnent avec la main en forme de coupelle et les doigts partiellement croisés ; les battements intermédiaires sont produits en frappant énergiquement les mains à plat l’une contre l’autre.
En temps de guerre, de nombreux jours avant une bataille, les prêtres se lancent dans des célébrations variées ; après les affrontements, si des ennemis ont été capturés, ils sont alors l’objet de rituels avant d’être offerts en sacrifice. Seuls les prêtres ont le privilège de consommer les offrandes faites aux dieux.
Le dernier ordre d’importance de la classe tapu générale est celui des « Uu », ou adjoints des prêtres lors des sacrifices humains. Seuls sont admis dans cet ordre ceux qui ont tué un ennemi au combat à l’aide de la courte massue ou masse d’armes appelée « uu » (* Ùu) qui est à l’origine de leur appellation particulière. Les prêtres ne sont pas nombreux mais leurs obligations sacerdotales étant multiples, il semble que la charge principale des « Uu » soit de leur prêter main forte lors des parties les plus laborieuses de l’horrible processus d’immolation d’un être humain. Les « Uu » ont le droit de festoyer avec les Taua et les Tuhuka, privilège qui n’est accordé à aucun autres des grades inférieurs.
En dehors de ces distinctions fondées sur leur idolâtrie et soutenues par les superstitions qu’elle renferme, il y a la classe des ouvriers spécialisés, qui représente la grande majorité du reste de la population. Quiconque possède une aptitude reconnue à la confection d’ornements ou d’armes de guerre, la taille de pirogues et l’agencement des intérieurs de maison, est gratifié d’un titre honorifique lui permettant d’être hébergé et nourri avec la plus grande des hospitalités par ceux qui l’emploient. C’est aussi le cas des pêcheurs expérimentés auxquels les personnes fortunées fournissent un lieu de résidence et des pirogues afin de bénéficier de leurs services.
Quant à la terre et tout ce qui pousse dessus, elle est propriété héréditaire des classes supérieures, civiles et religieuses, des guerriers, des prophètes, des prêtres et de leurs adjoints ; les limites des domaines respectifs sont bien définies et connues de tous. Les insulaires qui gardent les plantations et font les récoltes, et ceux qui sont au service des propriétaires et de leur maisonnée, forment la totalité de la population.
Bien que parfois lassant, je suis certain que ce descriptif des différentes classes de personnes que je serai amené à rencontrer, vous permettra, mon cher H____, de mieux comprendre les rapides esquisses de ces quelques jours d’observation qu’il me reste encore à conduire à Nuku Hiva, et que je vous transmettrai dès que possible.
LETTRE XXIX
UNE JOURNÉE DANS LA VALLÉE DE TAIÒA
Baie de Taiohae à Nuku Hiva,
Le 31 juillet 1829
Le Capitaine Finch était si ravi de sa visite dans la Vallée de Taiòa hier (* Hakaui/Hakauì) qu’il m’exhorta à refaire la même excursion en compagnie de quelques-uns de mes amis officiers. Dès ce matin, nous rassemblèrent donc rapidement un groupe afin de nous rendre sur place.
Comme il n’est pas recommandé d’envoyer un canot tout seul si loin d’un navire, nous en armâmes deux. Ayant constaté que le goulet entre la « Sentinelle de l’Ouest » et la terre ferme était assez large pour laisser passer un canot, conformément aux recommandations de l’interprète et du Taua, nous affalâmes la voile et traversâmes à la rame, faisant d’une pierre deux coup en satisfaisant notre curiosité et en raccourcissant le trajet. Néanmoins, comme c’était marée basse, nous trouvâmes l’expérience dangereuse. Un très fort courant nous poussait vers l’ouest, nous portant en avant avec une extrême vélocité tandis que de forts brisants (181) écumaient sur les blocs de rochers à moins d’une longueur d’aviron de chaque côté ; des remous tourbillonnants à gauche et à droite menaçaient à chaque instant d’entraîner irrésistiblement le canot dans leurs vortex rugissants. Sans les promptes indications et conseils de pilotage du vieux sorcier, ou quel que soit le nom qu’on veuille lui donner, nous aurions couru d’énormes risques. Dans le canot qui nous suivait, il n’y avait personne pour indiquer les manœuvres, si bien qu’une fois hors de danger, nous fîmes des signaux à l’équipage lui indiquant de contourner l’îlot ; heureusement, ceux-ci furent compris avant que le canot ne se soit trop approché du danger pour pouvoir changer de direction.
La face occidentale de la Sentinelle présente un aspect singulier. Elle est entièrement aride et marquée de traces de fusion, témoins les plus indubitables de son passé volcanique. De la base au sommet, elle s’élève sur une bonne centaine de pieds (* 30m), et il n’est pas besoin de faire intervenir son imagination pour voir dans sa configuration externe la succession de coulées de lave formant des arches qui attestent de son état fluide au moment où, ruisselantes, elles se refroidirent au jaillir d’un réservoir en fusion.
Quelques arbres-de-fer rabougris (casuarina), qu’on appelle ici koa (* toa), couronnent son sommet et parsèment sa face sud ; mais tout le reste de sa surface est aride, et offre résidence aux innombrables mouettes blanches qui la survolent et volètent parmi ses crevasses où elles construisent leur nid en toute sécurité. En dépit du fort ressac et du tranchant omniprésent des rochers, un Naturel avait traversé le chenal à la nage et, une petite calebasse à la main, il explorait les anfractuosités et les rebords se trouvant près de sa base afin de récolter des coquillages et autres fruits de mer.
Ce sont les observations que je fis tandis qu’après avoir lâché les avirons, nous attendions l’arrivée du second canot. Il apparut bientôt et, bordant à nouveau les voiles, nous nous laissâmes porter vent-arrière par l’alizé, et filâmes prestement (182) le long de la côte jusqu’à notre destination distante de quatre ou cinq miles (* 6.5km à 8km). En moins d’une heure, nos yeux découvraient la petite vallée. Cette côte que nous avions longée est très élevée et composée presque exclusivement de falaises abruptes ; elle ne prépare pas au violent choc visuel qui vous frappe de toute sa richesse et magnificence au moment où vous contournez le promontoire rocheux qui protège la vallée de ouragans et des assauts de la mer.
Immédiatement devant nous, s’étalaient deux petites anses formant un port intérieur et un port extérieur ne mesurant pas plus d’un demi mille de diamètre (* 800m). Le plus proche en arrivant est entouré de petites collines herbeuses piquetées de buissons ici et là ; il offre un joli mouillage. Le second, juste au-delà du premier, donne accès aux parties habitées en traversant une plage sablonneuse circulaire frangée d’épais bosquets de cocotiers et d’arbres à pain, de pandanus, de lataniers et d’hibiscus en fleurs.
Du côté gauche de la vallée, une prodigieuse chaine de falaises s’élève à plus de deux cents pieds (* 60m) à la verticale de la plage ; cette formation est si sauvage et si singulière qu’on dirait plus un décor fantastique réalisé pour une pièce de théâtre romanesque qu’une scène de la Nature. Depuis le pic au premier plan jusqu’au plus éloigné, en limite de perspective, l’ensemble fait l’effet d’une succession d’obélisques richement ouvragés, couverts de mousses, serrés étroitement les uns contre les autres, et d’un effet si nouveau qu’ils apparaissent tels des stalactites géantes, retournées sens dessus dessous après leur formation, et plantées là, offerts à l’admiration éternelle de ceux qui auront le privilège de les contempler.
Complètement en face, à droite, sur l’autre versant, à moins d’un demi mille de distance (* 800m), la Nature se présente sous une forme totalement différente ; des collines herbeuses ondulent gracieusement et sourient au soleil du matin dans une explosion de verdure digne des pelouses de juin. Elles s’élèvent les unes à la suite des autres (183) jusqu’à atteindre l’altitude de cinq ou six cents pieds (150m à 180m), et terminent brusquement leur course au pied d’une falaise basaltique qui, telle une couronne, surplombe leur point de convergence. L’ensemble offre un magnifique premier plan à la végétation luxuriante et au tracé sauvage du paysage jusqu’à l’endroit où la gorge s’incurve et se dérobe au regard.
Par le passé, dans diverses parties du monde, et sous les formes les plus variées, il m’a été donné de poser le regard sur des paysages magnifiques, mais je suis obligé de proclamer, sans la moindre hésitation, que la vallée de Taioa l’emporte triomphalement sur tous les spectacles de la Nature jamais admirés. Les mots sont impuissants à décrire une scène qui présente ainsi, tout à la fois, des contrastes de sublime et de beauté si imposants et si manifestes que l’esprit en est irrésistiblement élevé et charmé.
À l’approche de la grève, le son de notre clairon et de la corne de brume emplit de son écho les falaises occidentales ; émerveillés par cette sonorité nouvelle, les habitants descendirent sur la plage en groupes successifs. Cela n’eut certainement pas été le cas, néanmoins, si notre visite de la veille ne leur avait pas fait comprendre l’amitié de nos sentiments ; en d’autres circonstances, ils se seraient mis à l’abri ou bien, ils se seraient regroupés afin de se défendre. En effet, le jour précédent, lorsque le capitaine et ses officiers entrèrent dans la baie, et que leurs canots furent en vue de la plage, le vieux Taua et ses compagnons s’allongèrent au fond des embarcations. Dès que les insulaires de la vallée repérèrent les canots remplis d’étrangers, ils furent pris de terreur et se lancèrent dans une fuite éperdue, attrapant leurs enfants par le bras ou les portant sur le dos. Dès qu’il constata le résultat manifeste de sa plaisanterie, le vieux patriarche se redressa en riant et agita son éventail afin d’être reconnu ; les insulaires revinrent sur leurs pas aussi rapidement qu’ils avaient fui, et se joignirent joyeusement à l’hilarité que leur fuite éperdue avait provoquée.
Après avoir débarqué, notre hôte nous conduisit vers l’une (184) de ses maisons dans un bosquet à proximité de la plage. Son tout premier geste fut de m’offrir un éventail de fibres tressées de forme semi-circulaire, blanchi à la chaux et muni d’un manche de bois foncé très dur et parfaitement poli. Ce geste était motivé en partie par respect pour ma charge ; il me considérait, en effet, comme un confrère chamane puisque son propre titre de Taua était celui par lequel j’étais désormais connu, et que l’on utilisait pour s’adresser à moi. Les raisons de son geste étaient aussi pour lui une manière de me manifester sa reconnaissance des quelques menus cadeaux que je lui avais offerts avant de quitter le navire. Les autres officiers bénéficièrent aussi de sa générosité sous diverses formes.
Dans sa maison, la curiosité qui avaient motivé notre déplacement jusque dans cette vallée se trouva abondamment récompensée. Bien que plus vaste, l’habitation elle-même différait peu de celle de Haape, mais les articles qu’elle contenait étaient dignes d’un intérêt bien plus grand que ceux observés à Taiohae. Le plus remarquable d’entre eux était un cercueil, un peu en forme de pirogue et muni d’un couvercle remarquablement ouvragé ; l’ensemble était enveloppé de plusieurs épaisseurs d’étoffe indigène et contenait les restes d’un des fils du Taua décédé de nombreuses années auparavant. Il était surélevé à deux ou trois pieds au-dessus du sol et reposait sur une sorte de catafalque en plein centre de l’habitation. Les cadavres des personnes de haut rang sont ainsi conservés dans les maisons pendant de longues périodes.
En outre, nous y observâmes pour la première fois deux ou trois grands tambours destinés au temple (* meàe) ; il y avait aussi une belle sculpture d’un dieu de la guerre qu’ils transportent sur leur pirogue en cas d’affrontement en mer ; une conque marine de guerre décorée de touffes de cheveux humains ; des lances et des massues, une herminette et d’autres ustensiles et ornements plus frustres.
En quête de nouvelles découvertes, nous commençâmes à explorer les recoins du village, et nous fûmes étonnés des nombreuses preuves de sens artistique et de civilisation que nous découvrîmes. Une route remonte la vallée le long d’un large cours d’eau qui se jette dans la mer (185) ; en maints endroits, elle apparaît aussi large et propre que dans un village florissant de notre pays, mais beaucoup plus sylvestre et pittoresque. Les maisons, quant à elles, sont aussi confortables, considérant le climat, que les cottages des classes laborieuses d’Amérique ou d’Angleterre ; elles possèdent toutes un large enclos entouré de murets de pierre et reflètent de tous côtés un labeur et une habileté inattendus chez une telle population.
À peine avions-nous fait quelques pas que nous arrivâmes face à une maison qui affichait les symboles de l’idolâtrie. Elle était érigée sur une plateforme beaucoup plus haute que les autres et, tout contre un de ses flancs, était inclinée une grande sculpture très fruste, taillée dans une pièce de bois, dont le pied sombrait sous les débris de noix de coco, de fruit à pain et d’autres articles. À moins d’un jet de pierre, se trouvait un autre endroit tapu, un site funéraire, dont je fis un dessin. Il se tient au beau milieu d’un joli bosquet et se compose d’une solide plateforme de pierres faisant un peu plus de vingt pieds carrés (* 6m²) et d’une hauteur de quatre ou cinq pieds (* 1.20 à 1.50m) ; en son centre, elle est surmontée de huit ou dix poteaux formant tombeau et supportant, à une hauteur de six ou sept pieds (* 1.80 à 2.10m), un long toit de chaume étroit. Juste en-dessous, se trouvait un cercueil renfermant des restes humains, comme celui observé chez le Taua. À proximité, nous rejoignîmes une autre habitation appartenant à notre ami qui donna l’ordre de nous servir des rafraîchissements d’eau de coco tandis que nous attendions l’arrivée du chef civil de la vallée qui, nous avait-on dit, descendait à notre rencontre. Il arriva bientôt ; c’est l’insulaire le plus grand que nous ayons rencontré, tout à fait semblable à ses compères de Hawaii ; sa corpulence était telle qu’elle l’empêchait presque de marcher, et il était tatoué de la tête aux pieds, ce qui le rendait aussi noir qu’un Africain du Congo. (* La grande taille d’un chef des Taioa avait été relevée dans le passé par Crook, Krusenstern et Porter ; il s’agit peut-être de Pautini, beau-frère de Kiatonui, déjà mentionné par Crook en 1798-1799)
Depuis cet endroit-là, la vue qui s’ouvrait sur le haut de la vallée, nous apparaissait si prometteuse que nous étions impatients d’en contempler les richesses ; après avoir échangé (186) quelques civilités avec le chef, qui nous parut réservé et réfléchi, nous reprîmes notre excursion.
Le chemin que nous empruntâmes était dégagé et recouvert d’un gazon bien entretenu ; en son milieu courait un large sentier bordé d’une avenue d’arbres qui s’avançait devant nous en une longue perspective si dense que les rayons du soleil peinaient à traverser. Dans l’ombre profonde, de jolis cottages enclos de murets de pierres bien ordonnés étaient éparpillés de proche en proche. Dans la simplicité de leurs vêtements légers et gracieux, leurs occupants sortaient se rassembler autour de nous avec une timidité et une civilité qui contrastaient profondément avec la grossièreté vulgaire et offensante de ceux que nous avions rencontrés par le passé, et qui étaient plus accoutumés que ceux-ci à la présence de visiteurs étrangers, et aussi plus corrompus par leurs vices.
En plein midi, l’éclat du soleil tropical se teinte d’une douceur apaisante alors qu’il traverse l’épaisseur du sombre feuillage de la canopée pour finir sa chute sur un spectacle qu’il pare doublement de beauté et de richesse. Et, tandis que nous avancions aux notes variées du clairon et de la corne de brume à travers un paysage baigné d’ombre, parmi des objets emprunts de douceur sylvestre, si uniques et si sauvages, entourés d’un peuple dont les silhouettes admirablement modelées et les membres dévêtus étaient strictement à l’unisson de l’ensemble, je sentis monter en moi un sentiment d’admiration que la nouveauté et le romantisme des rencontres et expériences passées n’avaient jamais porté à un tel paroxysme.
La résidence du Hakāìki, ou chef, se dresse à mi-chemin. Il nous avait accompagnés et, à notre arrivée, nous invita à entrer. Néanmoins, mon attention se trouvait attirée par une maison tapu à proximité, contre laquelle étaient appuyées trois grandes statues de bois, deux tournées face contre la toiture et l’autre, vers l’extérieur. Au moment où j’entreprenais d’en faire un dessin, un des Naturels se saisit sur le champ des deux divinités (187) nous présentant leur dos et, sans aucune autre forme de cérémonie, les retourna négligemment avec autant de familiarité que je l’aurais fait moi-même, si l’occasion m’avait été donnée de me débarrasser de ces objets de superstition. Pour le moins, ce manque de vénération envers des idoles de leur culte ne manqua pas de me surprendre. Néanmoins, j’étais bien au fait des deux traits caractérisant, d’une part, l’inconsistance dont ils font preuve lors de l’adoration grossière de leurs divinités et, d’autre part, leur manque de respect allant jusqu’aux mauvais traitements. Alors que je demeurais aux îles Sandwich, je me souviens avoir entendu parler de personnes qui, déçues de l’échec de leurs prières, non contents de blâmer et de réprimander les divinités, étaient allé jusqu’à frapper leurs statues de bois et de pierre.
La poursuite de notre déambulation fut l’occasion d’obtenir, de manière inattendue, l’explication complète des cérémonies funéraires de ce peuple, qui nous fut fournie à notre arrivée près d’une maison dont les abords étaient jonchés des restes d’un festin donné en cette occasion tandis qu’allaient bon train les préparatifs d’exposition du corps, encore gisant dans une case ouverte, à quelque distance de l’endroit où le banquet avait été servi.
Lorsqu’une personne est gravement malade, la maison où elle est alitée est bondée de pleureuses qui gémissent lugubrement à la manière habituelle des Polynésiens endeuillés. Pendant ce temps-là, les Taua exercent leur art de la sorcellerie pour contenir la maladie ; quand ils échouent et que la mort est proche, les femmes dansent autour de la natte du mourant, se lacérant le corps, jusqu’à la frénésie, à l’aide de cailloux tranchants. Bien que la sincérité de leur désespoir ne soit souvent qu’apparente, elles profèrent des lamentations stridentes qui s’unissent en un long hurlement des plus terribles au dernier souffle du défunt.
Alors, généralement, dans une petite case à proximité de l’habitation de ce dernier, on construit une sorte de catafalque, composée de faisceaux de lances et autres armes de guerre entrelacées (188), recouverte de nattes sur lesquelles on allonge le corps bien enveloppé de vêtements d’étoffe neuve ; il y sera veillé pendant plusieurs jours, à la lumière des torches la nuit, tandis que les prêtres présents chantent leurs élégies funèbres.
Désormais, tous s’affairent à la préparation de la nourriture dont la profusion est proportionnée à la richesse et à la dignité de la famille. Tandis que les victuailles cuisent au four, un notable de la vallée, paré de ses plus beaux atours et ornements, agitant un éventail, passe de case en case pour inviter les chefs et les personnalités de premier rang ; il les interpelle en s’exclamant : « Tou kee » (* To kai), c’est-à-dire « Voici votre invitation » (* Ta nourriture). Mes amis officiers du navire furent témoins de cette scène hier.
Ce messager était vêtu d’une grande quantité d’étoffe blanche ; sur la tête, il portait un bandeau blanc noué surmonté d’un couvre-chef, à la manière d’une mitre, formé d’une jeune feuille de bananier vert cru. Outre son éventail, il portait à l’épaule une longue perche à laquelle sept foulards blancs étaient noués, un peu comme chez nous. Nos amis purent aussi assister à la mise au four de cinq cochons de belle taille ainsi qu’à la cueillette des fruits à pain, des noix de coco et de bananes ; ils durent néanmoins partir avant le début des festivités.
Les hommes qui ont été conviés se rassemblent en une maison tapu du voisinage, tandis que les femmes, parées avec gout de leurs plus beaux atours et ornements, se réunissent dehors, simples spectatrices. Du moment de la mort jusqu’à ce que le prêtre ait achevé les incantations de circonstance, le jeûne est de mise pour tous, et l’on n’a pas le droit d’allumer un feu dans le voisinage.
Une fois les psalmodies du prêtre terminées, on sort la nourriture des fours, la plupart du temps à peine cuite (189) ; le chef de famille, agissant en qualité de maître de cérémonie, découpe les porcs avec une lame de bambou et sépare la viande des os avec un caillou tranchant. La tête est toujours réservée au grand-prêtre ; elle est mise de côté à son intention afin d’être consommée plus tard, mais il peut se choisir le morceau qu’il désire pour s’en régaler sur le champ. Les jarrets sont partagés entre les chefs qui invitent leurs amis à se joindre à eux. En plus de la viande, chacun reçoit sa part de préparations de fruit à pain, de noix de coco et de bananes servies dans de grandes jattes de bois.
Après avoir mangé à sa convenance, chacun met ses restes de côté puis prend part aux conversations ou bien s’éloigne pour revenir se servir à nouveau jusqu’à ce que tout soit consommé, ce qui est rarement le cas avant la fin de la deuxième ou de la troisième journée.
La maison où le banquet s’était déroulé se trouvait dans un état lamentable et dégoutant en raison des morceaux de viande à moitié cuite éparpillés çà et là, et d’autres suspendus aux poteaux de la clôture sur la plateforme. Près d’’un des côtés de la porte, on pouvait voir deux immenses auges de bois, presqu’aussi grandes que des pirogues, à moitié pleines de poke, préparation qui a l’aspect et la consistance de la colle des relieurs, tandis que de l’autre côté, sur un lit de verdure, reposait un porc entier, pesant une centaine de livres, pas encore découpé, grouillant comme une ruche de milliers de mouches attirées par les exhalaisons et les odeurs des festivités.
L’extrémité et le milieu du faite de la toiture étaient ornés de banderoles blanches fixées au sommet de courts poteaux décorés, avec fantaisie, de verdure et de nœuds d’étoffe blanche.
Immédiatement à côté de la maison, se tenait une structure singulière, de construction récente, qui attirait toute l’attention. Il s’agissait d’une petite plateforme entourée d’un muret de pierres, à chaque angle duquel on avait dressé un certain nombre de longs bambous élancés (190), formant carré, liés les uns aux autres, à intervalles réguliers, par des rubans d’étoffe blanche. À l’intérieur de ce carré, entourant un catafalque couvert d’un linceul blanc, se trouvait un certain nombre de cônes de six ou huit pieds de haut (* 1.80 à 2.40m), tressés dans des palmes de cocotier, et dont le sommet était maintenu par des rubans d’étoffe blanche. Le catafalque se trouvait ainsi prêt à recevoir le défunt après qu’on eût déposé son corps dans le cercueil. Ces cônes en palme de cocotier étaient des petits sanctuaires confectionnés par les prêtres, et destinés à recevoir les offrandes de nourriture et de boisson à l’intention du défunt, auquel était aussi offert de l’encens élaboré en plaçant des pierres brûlantes dans des récipients emplis d’huile de coco. Nous fûmes à même de voir le corps dans une hutte avoisinante ; il était présenté avec décence et recouvert d’un drap d’étoffe indigène. Une femme seule, assise à sa tête, enveloppée d’une grande cape et baignée de larmes, semblait remplir la charge de veilleuse et de pleureuse.
En continuant notre avancée, les preuves de l’idolâtrie ambiante se firent de plus en plus prégnantes et nombreuses. Nous dépassâmes plusieurs temples abritant des statues encore plus hideuses que celles aperçues auparavant puis, de loin en loin, des terrasses funéraires entourées de cônes tressés contenant de la nourriture périssable pour des âmes immortelles. Les temples ne sont pas différents des maisons habitées plus vastes, sauf que leur façade est toujours ouverte. Tous ceux que nous avons vus contenaient trois statues : une à chaque extrémité et se faisant face, la troisième au centre, appuyée contre la toiture. Une autre statue, singulièrement disproportionnée, se dressait solitaire au milieu d’un épais bosquet, au sommet d’une plateforme de pierres massive et très élevée ; elle grimaçait, penchée sur une immense auge en bois emplie d’offrandes variées.
Et là, à nouveau, notre cheminement se trouva empreint d’un délice inhabituel, conduisant nos pas tout près de la berge de la rivière sur notre droite tandis que sur notre gauche se dressaient d’épais bosquets impénétrables, et que les crètes sauvages des montagnes nous surplombaient, s’avançant devant nous jusqu’au cœur de la vallée. (191)
Nous arrivâmes soudain devant une demeure dont les murs et les clôtures de pierre étaient si massifs, l’entrée si large, formée d’une ample volée de marches régulières et ouvrant sur une cour de terre battue, que nous fûmes vraiment étonnés. Les pierres, qui portaient des traces très anciennes, étaient taillées et jointes avec soin et élégance ; j’en mesurai de nombreuses qui faisaient de quatre à six pieds de longueur (* 1.20 à 1.80m), presque autant en largeur sur une épaisseur de deux pieds ou plus (* 60cm +). L’intérieur de la partie couverte de chaume était aussi propre et raffiné que les extérieurs de pierre étaient massifs et imposants. Son propriétaire devait être une personne de rang peu ordinaire à en juger par les objets exposés : des conques de guerre, des tenues de tête, des ornements variés, des paquets d’étoffe, des rouleaux de nattes, des mousquets, des lances et autres armes. Comme il n’y avait pas même un serviteur dans les parages, et qu’avec deux ou trois autres, nous avions abandonné les interprètes, les chefs, les sorciers et tout le reste loin derrière nous, notre curiosité se perdait en conjectures.
L’emplacement s’ouvrait largement sur la rivière avec, en perspective, la vallée s’enfonçant dans les montagnes, très loin en amont. Nous étions très tentés de poursuivre notre avancée mais, comme nous nous trouvions à deux ou trois milles de la plage (* 3.2 à 4.8km) et que nous avions perdu le contact avec le reste de notre groupe, nous décidâmes qu’il serait préférable de rentrer. D’abord cependant, je pris le soin de dessiner le temple et le site funéraire se trouvant juste au-dessus de nous : une idole hideuse, jetant un regard sombre sur les morts au milieu d’un enchevêtrement de pandanus et, en arrière-plan, une avancée de montagne au fond de la vallée. Je ne regrettai pas les quelques minutes passées à dessiner lorsque j’appris, plus tard, que c’était là le temple où les victimes humaines étaient le plus souvent immolées.
À l’exception de deux ou trois endroits semblables, il est clairement évident que leurs statues seront bientôt réduites en poussière. Mise encore davantage en exergue par leur difformité, leur dégradation semble déjà proclamer (192) la survenue du moment où, avec toutes les « idoles d’argent et d’or dressées à l’adoration de chaque humain », celles-ci seront également jetées « aux taupes et aux chauves-souris », et foulées aux pieds de l’abandon et du dégout perpétuels.
En venant renforcer mes premières impressions de ce que, même ici, est en train de poindre l’aube de la « Lumière de Vie » qui éparpillera les ténèbres spirituelles planant sur cette terre, cette vision de désintégration m’était d’un grand réconfort.
Nous rebroussâmes chemin avec la même admiration que celle qui nous avait conduits jusqu’ici et, à mi-chemin de la plage, nous avions rejoint notre groupe. Là, assis dans l’herbe à la marge d’un bosquet, dans le style le plus pur des pique-niques, nous nous régalâmes des victuailles débordant des paniers de Johnson, notre bon vieux steward. En de telles occasions, il sait se montrer un ami précieux et sûr, à jamais inoubliable quand, porté par un appétit de loup, chacun se saisit, « sans fourchette » (* en français dans le texte), des plus beaux morceaux de volaille rôtie, de la langue de bœuf en tranches, du jambon, du pain et du fromage qu’il a su si soigneusement mettre de côté pour une de ces occasions.
Entourés de centaines de Naturels (qui semblaient croire le moment venu de voir satisfaite leur curiosité culinaire), nous savourions tous les honneurs du « déjeuner en public » de la famille de Bourbon.
Assis parmi nous, les dignitaires de la vallée grignotaient et sirotaient avec soin et politesse les plats étranges qui leur étaient présentés ; un gâteau de pain-perdu proposé aux spectateurs du voisinage se vit soudain émietté en centaines de morceaux, lancés de tous côtés aux quémandeurs bruyants qui manifestaient leur régal d’un éclat de rire et de grimaces enjouées.
Les membres d’équipage à notre service se réjouissaient, eux aussi, de rompre leur jeûne sans attendre que « le couvert soit enlevé », en profitant du privilège d’un en-cas aimablement glissé entre leurs mains par un ami du cercle privé, (193) changeant ainsi ce repas en saturnale, ce qui nous parut tout à fait acceptable en ces temps de restriction.
Sur le chemin du retour, nous rencontrâmes des femmes vêtues de tenues propres et gracieuses, la tête enturbannée avec fantaisie ; elles étaient assises en cercle dans chaque bosquet où elles chantaient des comptines monotones, s’accompagnant de battements de main entrecoupés de claquements gutturaux de la langue ressemblant au gloussement d’une poule rassemblant ses poussins sous ses ailes.
Toute la population de la vallée envahit la grève au moment de notre départ ; parmi cette foule, nombreux furent ceux qui, après nous avoir prêté la main pour embarquer dans nos canots les volailles, noix de coco, porcs, canne à sucre, bananes, &c. que nous avions troqués, nous firent traverser le ressac en nous portant sur le dos car, à marée basse, la mer se retire trop loin pour permettre à une grande embarcation de s’approcher de la plage. Une fois dans les canots, avec notre ami le Taua qui rentrait avec nous, nous donnâmes quelques coups d’aviron puis fîmes une pause afin de laisser le clairon et la trompe sonner le chant du départ.
L’ombre vespérale tombait déjà des falaises de l’ouest sur la vallée, et l’obscurité des bosquets en arrière-plan mettait la foule des Naturels en relief si contrasté qu’elle faisait pleinement ressortir la finesse de leurs formes et le drapé classique dont ils étaient partiellement enveloppés.
On n’entendait aucun cri, aucun réjouissement vulgaire ne se manifestait ; leur rêverie silencieuse nous laissait accroire leur regret de nous voir partir. Au moment où le clairon et la trompe achevèrent leur « finale », et où nous prîmes la direction du navire, nos derniers regards s’accompagnant de nos prières et de nos vœux les meilleurs, les insulaires commencèrent lentement à se séparer et à se disperser parmi leur nature sauvage.
Mon cœur soupirait de n’avoir pu entamer avec eux mon enseignement missionnaire et, tout au long de notre retour, mon esprit fourmillait d’idées pour faire en sorte que la lumière vienne rapidement éclairer leurs ténèbres, et que leur soit proclamée la « Bonne nouvelle » qui, une fois entendue et acceptée, ferait de leur bercail, non seulement ce que la Nature en fait déjà (194), un des lieux les plus romantiques du globe, mais moralement et spirituellement, « La Vallée heureuse ».
__________
LETTRE XXX
CRUAUTÉ ET INJUSTICE DES ÉTRANGERS
ENVERS LES INSULAIRES
Baie de Taiohae à Nuku Hiva
Le 3 août 1829
À la tombée de la nuit, à notre retour de la vallée de Taioa, au moment où nous contournions la sentinelle de l’ouest, le cri de « Voile devant ! » jaillit d’une douzaine de bouches et, en entrant dans la baie, nous découvrîmes un vaisseau ancré non loin du Vincennes sur lequel flottaient les couleurs françaises.
Dès que Tauahania reconnut l’étendard blanc des Bourbons, il fut pris d’inquiétude et d’une grande agitation, priant qu’on le débarquât sur la grève plutôt que de retourner à bord, disant qu’il avait « grande frayeur ». Nous comprîmes sur le champ les raisons de ses craintes suite à un épisode qu’il nous avait narré le matin même, alors que nous entrions dans la baie de Taioa et qu’il nous indiquait le meilleur mouillage.
Quelque temps auparavant, un navire français était venu jeter l’ancre dans cette vallée-là. Il semble qu’en raison d’une grande pénurie, le commandant ait eu énormément de difficulté à se procurer autant de porcs vivants qu’il le désirait et que, se servant de l’autorité du Taua, il obligea les insulaires à lui en fournir davantage que ceux déjà acquis. Soit l’homme refusa, soit qu’il fut dans l’impossibilité de répondre aux exigences, soit encore que population refusât de lui obéir ; quoiqu’il en soit, le Français ordonna qu’on s’empare de lui tant qu’il était à bord, et qu’on le ligote autour du grand-mât, pieds et poings liés de telle manière que tout son poids tirait sur les liens ; on lui dit aussi qu’il ne serait pas relâché tant que quarante porcs ne seraient pas apportés au navire. Cette scène se déroulait en début de matinée, et ce ne fut qu’au terme de six ou huit heures (195) et de maints efforts que le nombre exigé d’animaux de toutes tailles se trouva ressemblé sur le navire ; au lieu de libérer le vieil homme, le capitaine en réclama vingt autres. Ce n’est qu’à la nuit tombante que furent livrés les derniers animaux capturés dans tous les recoins de la vallée, la dépossédant ainsi de presque toutes ses ressources sur pattes. Et c’est ainsi qu’après avoir enduré ses supplices toute la journée, lâchant d’un ton affligé les paroles « Make oa ! » « Mort ! » (* mate òa !), le prophète ferma les yeux et se laissa tomber la tête sur la poitrine : « Make oa i te eha a te pooe ! » « Mort de douleur et de faim ! » (* Les mots marquisiens ne correspondent pas à la traduction donnée…) ; on lui enleva ses liens et on le laissa retourner à terre sans aucune compensation pour les affronts et les souffrances endurés, et sans payer les porcs capturés.
Le Français avait atteint son but, mais avec quelles conséquences ?
Le lendemain matin, un canot avec à son bord des hommes en armes, prit la direction de la grève pour faire de l’eau. Sans apercevoir les Naturels cachés dans les buissons, ils s’apprêtaient à débarquer lorsqu’une volée de mousqueterie les frappa de plein fouet ; un homme tomba mort dans le ressac et deux autres furent si grièvement touchés que le canot eut du mal à retourner au navire. Constatant la mauvaise condition évidente de son équipage, le capitaine jugea prudent de lever l’ancre et de mettre les voiles immédiatement afin d’éviter toute nouvelle menace.
Tout cela après avoir été la cause directe de la mort d’un de ses propres hommes et, pour ainsi dire, du massacre de certains de ses infortunés compatriotes qui, ne suspectant aucun danger, se sont ainsi trouvés, par accident, exposés gratuitement à la merci de celui dont les circonstances avaient fait un ennemi implacable.
Je suis fermement convaincu de ce qu’il ne s’agit là que d’un exemple parmi des milliers d’autres manifestations d’oppression, d’injustice et de cruauté de ce genre (196), ou même encore plus infâme, qui formeraient la trame de l’histoire authentique des contacts de l’homme civilisé avec les insulaires du Pacifique, s’il arrivait qu’ils fussent révélés au monde. En plus de tout ce que j’ai vu et entendu personnellement sur le sujet, les récits fournis par de multiples voyageurs abondent dans ce sens. Et c’est dans des cas semblables d’agression et de barbarie chez des hommes dits civilisés et réputés chrétiens, que la moitié de la réputation de sauvagerie du monde païen trouve son origine.
Le pavillon blanc de la France n’est pas le seul à être souillé ; on ne peut, non plus, en rendre unique responsable l’étroitesse d’esprit des petits commerçants. Les navires qui sillonnent l’océan à des fins de découvertes scientifiques, et ceux envoyés par ces bastions majestueux que sont la Grande Bretagne et l’Amérique afin de patrouiller les mers en quête de pirates, de hors-la-loi, d’injustice et d’oppression, tous méritent leur part d’opprobre. Car il est des commandants qui, au lieu de poursuivre, dans leurs rapports avec les Polynésiens, la politique amicale et chrétienne d’un capitaine Byron du H.M.S Blonde et d’un capitaine Jones de l’USS Peacock, se sont fourvoyés, en certaines occasions au moins, couvrant de honte le pavillon américain, et souillant, à double couche d’ignominie, la fière bannière de la Grande Bretagne.
Mais les faits sur lesquels reposent ces affirmations finissent rarement dans l’oreille ou sous les yeux du grand public, à moins que ce ne soit sous une forme quelque peu semblable à celle, on peut l’imaginer en toute liberté, sous laquelle, dans le cas du Français mentionné plus haut, l’épisode circonstancié sera relaté avec la fraîcheur et le sentiment d’indignation légitime dès son arrivée à l’un de ses ports d’attache. « Le navire _______, commandé par _______, vient de jeter l’ancre dans notre port, après un long voyage dans l’Océan Pacifique. Nous devons malheureusement déplorer la perte de plusieurs membres d’équipage aux îles Washington, lors d’un débarquement à Nuku Hiva afin de nous ravitailler. Il semble que les insulaires (197) soient perfides et féroces : un canot envoyé à terre pour faire de l’eau fut soudain attaqué par une bande postée en embuscade, et un membre d’équipage a malheureusement péri ; ses camarades sévèrement blessés se sont échappés avec difficulté ! »
Tauahania, que Morrison qualifie de « Chef des Dieux » dans ses traductions, avait raconté les détails de cette atrocité au Capitaine Finch lors de leur visite dans la vallée.
Après avoir accompagné le vieux chef à terre conformément à sa requête, nous montâmes à bord du Vincennes où nous apprîmes que le nouveau venu se nommait « La Duchesse de Berry », Capitaine Moeté (* Moité) qui avait quitté Callao cinq jours après nous en direction de Manille.
Bien que, jour après jour, le Capitaine Finch fût importuné par les chefs et les guerriers lui réclamant mousquets et munitions en échange de la quantité de porcs qu’il annoncerait, il avait catégoriquement refusé d’accéder à leurs demandes sur le sujet, expliquant en long et en large les raisons de sa détermination, pointant du doigt les calamités provoquées par leur violence et leurs guerres. Soucieux de voir le commandant de la Duchesse de Berry adopter la même politique sur le sujet, il alla rapidement le rencontrer et l’informa de sa ligne de conduite afin qu’il se conformât à son désir.
Découvrant que les seuls articles dont disposait le Capitaine Moité pouvant servir à troquer de l’eau et des vivres étaient des mousquets, des munitions et de l’alcool, le Capitaine Finch lui fit immédiatement parvenir du calicot et de la ferraille en quantité suffisante pour les échanges, et promit de faire apporter l’eau et le bois depuis la côte sur les canots, et par les hommes du Vincennes. Il informa aussi le Capitaine Moité, qui semble être un monsieur intelligent et respectable, de la mauvaise conduite de son compatriote dont s’était plaint le Taua ; (198) il parut comprendre parfaitement le risque auquel il aurait pu s’exposer, par voie de conséquence, s’il avait fait escale à une période où il n’y aurait pas eu d’autre navire dans la baie, et qu’il aurait été parfaitement inconscient du désir de vengeance des insulaires.
Aujourd’hui, je ne suis pas allé à terre ; je me suis occupé principalement à dessiner une vue panoramique de la baie et de la vallée depuis notre mouillage, et aussi à faire un croquis des tatouages de Te Ipu, un chef guerrier de cette tribu.

TE IPU – Chef guerrier des Teii, en tenue de combat, et un relevé précis de ses tatouages.
(* Crook nous explique que Kiatonui a eu un fils, nommé Teiipo, avec sa belle-sœur, qui avait été adopté par Piueinui. Mon intuition me porte à croire que ce guerrier est, peut-être, Teiipo dont le nom a été déformé par une oreille anglophone, d’autant plus que page (205), Stewart écrit qu’il représente à la fois les Teii et les Taioa auprès des Taipi, et que sa mère naturelle, Uuhei, est fille de Katohomo, un des chefs Taioa)
Le Capitaine Finch a donné une conférence longue et intéressante aux chefs, aux prêtres et aux guerriers afin de les dissuader de continuer leurs guerres avec les tribus voisines, pointant du doigt les avantages et les bienfaits qu’ils tireraient d’une paix réciproque, et mettant en avant l’intérêt général qu’ils trouveraient à n’être plus qu’un seul et même peuple, lié par une alliance offensive et défensive contre les ennemis et les envahisseurs étrangers uniquement.
Leurs guerres ont des caractéristiques et des causes variées. Parfois, elles sont provoquées par un vol banal, une insulte ou une injure lancée à une simple personne, et qui engendre une rancœur mobilisant toute la tribu de l’offensé. Il n’est pas rare qu’un groupe d’amis en visite depuis une tribu voisine soit impliqué contre son gré ; il en résulte alors de féroces altercations au sein de deux tribus alors que les victimes des insultes ou du meurtre sont peut-être les agresseurs en personne. Une ambition excessive, la détermination d’un chef à s’emparer des biens et propriétés d’un autre, aboutissent souvent au même résultat ; mais la cause de guerre la plus ordinaire est la capture d’habitants d’une vallée par ceux d’une autre afin de fournir des victimes humaines à leurs dieux.
En plus du vol d’une conque de guerre (199) chez les Hapaa, ce dernier élément est le mobile de la guerre actuelle entre les Teii et les Taipi. Peu de temps auparavant, au cœur de la nuit, une bande de Taipi s’était infiltrée dans la baie où nous avons jeté l’ancre et, à pas de loup, avaient pénétré une maison pour s’emparer de sept malheureux, trois hommes, trois femmes et un enfant qui y dormaient ; avant que l’alarme ne fût donnée par les voisins, ils les avaient emportés triomphalement afin de les sacrifier aux mânes d’un grand chef. Prétextant cet acte de violence pour justifier la guerre, les chefs et les guerriers exhortaient le capitaine à se joindre à leur expédition punitive ou, pour le moins, à leur fournir armes et munitions.
Tout en admettant l’atrocité du crime perpétré, il leur recommanda, néanmoins, de rechercher la paix avec les autres tribus, et de la maintenir, leur confirmant que ni son navire, ni aucun des « navires de Porter » ne leur apporterait de soutien dans leurs conflits.
Après la soumission des Taipi par le Commodore Porter en 1814, il apparait que Keatanui (* Kiatonui), alors chef des Teii de Taiohae, ait été reconnu concrètement roi de toute l’île de Nuku Hiva, et qu’à sa mort, ce titre ait été transmis à son successeur, son fils Moana, père du présent prince Moana (* Temoana). Toutes les tribus reconnaissent, partiellement du moins, le jeune prince comme héritier légitime du titre, jusqu’aux Taipi, la grand-mère maternelle du garçon étant une princesse de leur clan et demeurant dans leur vallée principale. Le Capitaine Finch les encouragea vivement à réunir un grand conseil qui, au terme d’une cérémonie de réconciliation, proclamerait formellement Moana roi de toute l’île, auquel tous viendraient faire serment d’honneur et d’allégeance.
(* Ce paragraphe jette une lumière nouvelle sur la généalogie du jeune Moana, connu plus tard sous le nom de Temoana. Crook nous apprend que Moana, le père dont parle Stewart, avait environ six ans en 1799, et qu’il était fils illégitime de Kiatonui, mais qu’il vivait dans sa maison. Or, la tradition orale dit que le père de Temoana est le premier fils de Kiatonui, Tuitoua, douze ans en 1799, dont l’épouse est Tahiateiani, une femme d’âge mûr de la tribu de Hooumi, les Teavaani, dernier détail qui est conforme à ce qu’écrit Stewart. Pourquoi n’est-il pas fait allusion à Tuitoua dans le récit de Stewart ? Différents récits, dont celui-ci, nous permettent de croire que Temoana était né en 1820 ou 1821, période coïncidant avec celle de la mort de Kiatonui. Y a-t-il eu des conflits à la mort de ce dernier ? Moana est-il mort à ce moment-là entraînant une période de régence par Haape et une instabilité menant à une attaque et une victoire Hapaa vers la fin des années 1820, comme l’état de délabrement de la vallée et le pouvoir apparent de Piaroro semblent l’indiquer page (149) ? Peut-être est-ce cet état de faiblesse permanent qui a conduit Temoana à s’absenter de son île pendant cinq ans en 1834, âgé d’à peine 14 ans ? Peut-être la présence des Hapaa dans l’est de Taiohae a-t-elle perduré pendant la période concernée, provoquant l’hostilité de Temoana contre Pakoko à son retour à Taiohae en 1839 ? En janvier 1845, après l’assassinat des cinq marins français à Taiohae, il ne faut pas oublier que c’est chez ces Hapaa que Pakoko est allé se réfugier. De nombreuses questions restent en suspens…)
Le Capitaine Finch illustra les nécessités et les avantages d’un tel accord politique en expliquant (200) les caractéristiques générales de notre propre mode de gouvernement au sein duquel vingt-quatre états différents forment une alliance offensive et défensive, sous la direction d’un seul chef d’état, travaillant tous ensemble en paix, n’entrant en guerre que contre un ennemi de l’extérieur, tandis que tous nos différents se règlent au sein de conseils amicaux.
Il est aussi revenu sur l’objet de notre visite, expliquant que nous n’étions là ni pour faire la guerre ni pour commercer, que tout ce que nous leur donnions était l’expression gratuite de la bonne disposition d’esprit des États-Unis à leur égard, et que nous n’accepterions pas de contrepartie. Il déclara aussi que notre nation envoyait de par le monde des vaisseaux de guerre pour garantir la paix, pour protéger les navires dépourvus d’armement, et s’attaquer seulement à ceux qui s’en prenaient aux navires de commerce sans défense de notre pays. Tant que les habitants de Nuku Hiva, ajouta-t-il, ne porteraient le fer contre les navires faisant escale dans l’île pour faire de l’eau et des vivres, tous les vaisseaux de guerre qui leur rendraient visite viendraient dans un esprit de paix et d’amitié. Il mit un terme à ses recommandations en leur annonçant qu’en dépit de la gêne et des inconvénients que cela pouvait entrainer, il était déterminé à rendre visite aux Taipi à bord du Vincennes afin qu’ils constatent, eux aussi, que nous n’étions les alliés d’aucun des deux camps, mais bien les amis de chacun des deux. De la sorte, nous serions en mesure de leur manifester notre bonne disposition d’esprit de la même manière que l’avions fait avec les Teii, les Taioa et les Hapaa ; nous serions ainsi à même de leur prodiguer les mêmes conseils et de jouer de notre influence pour aboutir à une paix durable, et à la reconnaissance de l’autorité royale de Moana. Ils parurent particulièrement satisfaits de la conférence et approuvèrent joyeusement toutes les recommandations.
Le samedi, le Capitaine Finch informa les chefs que, le lendemain, nous fêterions le sabbat, notre jour de célébration religieuse publique. Il souhaitait qu’ils informent la population de l’interdiction de s’approcher du navire, que ce soit pour se divertir (201) ou pour faire du troc ; il en profita pour inviter les chefs à participer au service religieux. C’est ce qu’ils firent, se comportant avec une grande bienséance aussi bien pendant les prières qu’au cours du prêche ; c’est au moyen de l’exclamation usuelle et mélodieuse « Motaki ! » « Bien ! » qu’ils exprimèrent leur grand intérêt.
J’avais formé le dessein de passer une partie de l’après-midi à converser avec eux sur le sujet de notre religion et la possibilité de faire venir des missionnaires chez eux mais, le capitaine du navire français les ayant invités à son bord pour leur remettre des petits cadeaux, je remis la conversation au lendemain, lundi.
Le jour dit, connaissant mes intentions, Haape, Piaroro des Hapaa, le prince Moana et Tauahania de Taioa s’étaient rassemblés sur la grève pour m’accueillir. L’entrevue fut longue et intéressante.
Je leur expliquai quelques-uns des principes fondamentaux de la religion chrétienne, la nature des missions, ainsi que la fonction et le rôle des missionnaires ; que c’était des hommes et des femmes venant de nations puissantes et éclairées ayant laissé leur père, leur mère, leurs sœurs et leurs frères derrière eux, abandonnant les plaisirs et avantages de la vie au pays natal pour vivre avec des peuples tels qu’eux-mêmes dans le but de les éveiller aux arts de la civilisation, de leur apporter des livres et de leur apprendre à les lire et, par-dessus tout, de leur ouvrir la connaissance du vrai Dieu et la rédemption de l’âme dans le monde spirituel, portée par la mort de Jésus Christ, le seul Sauveur des pécheurs. Je leur expliquai que de nombreuses personnes aux États-Unis se souciaient ardemment de leur bien-être et de leur bonheur, et qu’ils avaient l’intention de leur envoyer des prédicateurs ; lorsque je leur demandai s’ils les recevraient les bras ouverts, avec amitié, les « Ae ! Ae ! » « Ah oui, ah oui ! » fusèrent de partout avec entrain, suivis de « Motaki, motaki », « Bien, bien. »
Alors Haape dit : « Cela dépend du roi Moana. », ce à quoi le petit bonhomme répondit sans attendre : « Qu’il en soit ainsi ; c’est bien, c’est très bien. » Tauahania ajouta : « Quand ils arriveront, certains d’entre eux doivent venir vivre avec moi à Taioa ; je leur donnerai des terres et je leur construirai une grande maison ». Je lui dis qu’ils seraient heureux de vivre dans sa vallée si lui et sa tribu abandonnaient leurs idoles pour se tourner vers Jéhovah, le seul vrai Dieu, avoir foi en lui et le vénérer. Ce à quoi il répondit : « Je sais que Jéhovah est un Dieu puissant. J’ai entendu dire qu’à Tahiti les gens avaient brûlé leurs idoles et l’avaient pris comme Dieu ; cela pourrait nous être bénéfique de faire de même », ajoutant « Jéhovah est plus puissant que n’importe lequel de nos Dieux car il commande au tonnerre et à la foudre » ; je découvris alors que cette remarque émanait de l’effet produit par l’éclair et la détonation du canon qu’ils considéraient comme étant la foudre et le tonnerre. « Quand le tonnerre gronde sur l’île, ajouta-t-il, nous sommes sûrs qu’un navire approche de l’île et que Jéhovah fait gronder le tonnerre pour nous en informer. »
Il fit aussi remarquer qu’ils avaient déjà une grande quantité de dieux, qu’il ne pouvait pas dire combien, que leur nombre ne cessait de s’accroître car chaque fois que meurt un Taua, un chef ou un prêtre, il devient dieu, qu’il en serait toujours ainsi et que lui-même, à sa mort, deviendrait dieu. Je lui répondis que tous leurs dieux, leur religion et leurs sacrifices étaient « Mea wahahe wale no » (* ???) « Complètement dans l’erreur » et sans valeur ; ce qu’il sembla prendre du bon côté puis, évoquant à nouveau Jéhovah et Jésus Christ comme étant le seul et vrai Dieu et Rédempteur, il s’exclama encore une fois : « Motaki ! Motaki ! Jehova te Atua no matou », « Bien ! Bien ! Jéhovah est, ou sera, notre Dieu ! »
Je fus surpris de constater qu’ils étaient bien plus intéressés par le sujet, et aussi bien plus attentifs, que ce à quoi je m’attendais. Au terme de la conversation, comme le Capitaine Finch et moi-même (203) les avions informés de ma présence antérieure au sein de la Mission des îles Sandwich, ils demandèrent combien cela prendrait de temps aux prédicateurs pour venir, et si je serais à leurs côtés. J’ose espérer que la présentation du sujet ne tombera pas totalement dans l’oreille d’un sourd et que, par rapport aux conseils du Capitaine Finch, elle puisse ouvrir la voie de l’accueil et de la réception amicale de tous ceux qui, heureux messagers des hommes et des femmes aspirant au salut du monde, seront envoyés pour les conduire sur le droit chemin de la vérité.
Le même jour, en fin de soirée, le Lieutenant Stribling et moi-même allâmes faire une promenade sur le terrain occupé par le camp du Commodore Porter. Il s’étend juste en face de notre navire, sur la grève orientale (* Hakapehi) ; c’est une petite plaine, hérissée et bordée de buissons d’hibiscus, baignée par une joie plage de sable, protégée, du côté allant vers l’océan, par un promontoire rocheux se terminant par la Sentinelle de l’est et, à l’arrière, par de profondes déclivités boisées. L’ensemble est séparé des parties habitées de la vallée par un éperon rocheux surmontant une colline arrondie faisant saillie dans la baie, et sur laquelle étaient installés un parapet et une batterie de canons permettant de contrôler l’approche du camp. De nos jours, il ne reste aucune trace de cette occupation.
En général, il semble que cette tribu ait gardé un souvenir très amical du Commodore Porter ; les chefs et les habitants les plus âgés nous demandent souvent ce qu’il est advenu de lui, où il se trouve et comment il va, et s’il reviendra les voir un jour. En parlant du capitaine, les plus jeunes veulent savoir « Si ce chef est Pota ? ».
Nous avons trouvé une sorte de concombre sauvage poussant en grande quantité aux alentours, et nous avons d’abord supposé qu’il avait été introduit par Porter, mais nous avons appris depuis qu’il s’agissait d’une plante endémique qui pouvait aisément être transformée en un excellent condiment mariné.
Au crépuscule, la Duchesse de Berry se mit en branle dans l’intention de continuer sa traversée (204) mais le vent était léger et changeant, avec de fortes rafales, si bien qu’à la tombée de la nuit, elle se trouva en très mauvaise posture, non loin d’un éperon rocheux et d’une échancrure de falaise. Un tir de mousquet donna le premier signal de détresse, suivi d’une salve de canon. Depuis le Vincennes, on envoya immédiatement trois canots sous le commandement du Lieutenant Dornin, suivis de la chaloupe chargée d’une ancre de jet et de haussières. Ils arrivèrent juste à temps pour lui éviter de heurter les rochers contre lesquels l’avaient portée le ressac, ce qui aurait causé son naufrage et une perte totale car, considérant la situation défavorable dans laquelle elle se trouvait, il est fort possible que l’équipage entier ait péri avec elle.
Néanmoins, après une heure d’efforts dispensés par nos hommes et nos officiers, elle fut remorquée, mise en sécurité, après quoi elle se faufila entre les Sentinelles et parvint à gagner le large, saine et sauve.
___________
LETTRE XXXI
DÉPLACEMENT DU VINCENNES CHEZ LES TAIPI
Baie de Oomi (*Hooumi) à Nuku Hiva
Le 6 août 1829
(* L’alliance Taipi incluait toutes les tribus vivant à l’est des vallées Hapaa ; la vallée de Hooumi en faisait partie ? mais la tribu résidente se nommait « Teavaàki », « La voute céleste »)
Afin de m’excuser en partie de la tristesse particulière que la date de ce jour peut nous rappeler (* ?), il me faut commencer le compte-rendu de cette journée en vous informant, mon cher H______, du grand désarroi qui m’afflige en ce moment, et de ma profonde lassitude face aux vilenies des Nukuhiviens. Bien que mon cœur se soit endurcit au vu des scènes dont je suis le témoin impuissant, je suis de plus en plus dégoûté de la barbarie et autres manifestations de paganismes que nos regards croisent à chaque détour.
Afin qu’il ne vienne jamais à l’idée des Taipi que notre amitié n’est destinée qu’aux tribus en guerre contre eux, (205) il y a quelques jours, le Capitaine Finch a pris la décision de déplacer le Vincennes dans leurs eaux ; et ce, dans le but de leur prouver notre entière neutralité, d’avoir les mêmes rapports humains et de leur offrir les mêmes cadeaux qu’aux Teii, Taioa et Hapaa. Et aussi afin de manifester son influence auprès d’eux en réglant à l’amiable les hostilités.
Comme je l’avais précisé dans ma dernière lettre, il informa les chefs de son projet samedi dernier, et leur offrit d’envoyer une délégation des chefs principaux à bord du navire afin de siéger en conférence sous sa protection, selon les lois des Taipi, afin de parvenir, si possible, à une paix immédiate.
Ils acceptèrent sur le champ, et nommèrent le jeune prince Moana et Te Ipu, un chef guerrier représentant les Teii et les Taioa, ainsi que Piaroro pour les Hapaa. Bien que la puissance des membres présents de sa famille rassurât Haape sur la sécurité personnelle du jeune prince parmi les Taipi, en qualité de tuteur du garçonnet, il mit un point d’honneur à nous accompagner afin de pouvoir poser le pied à terre aux côtés du capitaine sans craindre d’être amicalement retenu et de subir une captivité même honorable.
Nous avions l’intention de quitter Taiohae le quatre courant mais, après avoir relevé nos ancres après le petit-déjeuner, et tenté pendant une heure de sortir de la baie sous des rafales de vents, nous dûmes rejoindre notre mouillage et attendre la brise de terre du lendemain matin. En conséquence, tout l’équipage se trouva sur le pont hier à quatre heures du matin et, en un rien de temps, nous sortîmes de la baie sans encombre.
Évidemment, pour parcourir les six ou sept milles (* 11 ou 13 km) qui séparent Taiohae de Oomi (* Hooumi), nous dûmes affronter les alizés d’est, ce qui nous obligea à louvoyer et, de la sorte, à tirer des bords par deux fois entre Nuku Hiva et Uapou qui se trouve à vingt-cinq ou trente milles vers le sud (* 30 ou 35 km ; en réalité, presque 50km), nous donnant ainsi l’occasion d’admirer les deux îles de loin. La silhouette de Uapou est de loin la plus romantique, singulièrement caractérisée par deux ou trois pics élevés (206) et sauvages dressés en son centre ; un d’entre eux s’élève tel une flèche de cathédrale, légèrement incliné d’un côté, finissant en une pointe parfaite et dominant les autres montagnes d’au moins mille pieds (* 300 m).
Aux environs de midi, nous étions proches de la « Tour du Roc » dont les jeux de lumière et d’ombre faisaient une masse magnifique, à peine imaginable. Ce n’est évidemment qu’un agglomérat de lave sombre, mais la morosité de ce bloc se trouvait tellement tempérée par le vert de la mousse délicate, par les buissons comblant ses crevasses, et par les lianes masquant ses irrégularités, que la beauté resplendissait de ce qu’on aurait autrement pu considérer difforme et monotone. Face à la tour, comme nous la nommons, face aux rochers crénelés à l’entour, nous étions comme transportés en une contrée où se dressent encore les vestiges du pouvoir féodal et de sa grandeur ; on ne forcerait pas son imagination en déclarant, même en étant tout près, qu’il s’agit là des ruines majestueuses d’un château-fort.
À un demi mille du promontoire (* 800m), se dresse un rocher solitaire, tel un fût de colonne arrondi à son extrémité, dominant l’eau du haut de ses huit ou dix pieds. C’est un bon repère marquant l’entrée orientale de la baie qui communique avec l’Océan par un passage d’environ deux milles de large (* 3km), parfois nommé la Baie du Contrôleur (* C’est le capitaine Richard Hergest du H.M.S Daedalus, premier navire à faire escale à Nuku Hiva en 1792, qui donna à la grande baie le nom de Comptroller’s Bay, et Port Anna-Maria à la baie de Taiohae). Nous passâmes non loin ; on dit que des navires sont passés de justesse entre ce rocher et la falaise. Le vent nous porta jusqu’à l’intérieur et à notre mouillage actuel. La baie est très étroite, bordée de chaque côté de hautes collines dont le pied plonge à pic dans la mer. Sur les conseils de Morrison, nous nous étions tellement avancés que nous risquions de manquer d’espace en cas de problème avec notre ancre ou un câble, et nous jetâmes l’ancre par quatorze brasses (*25m) de fond, peu satisfaits de notre mouillage.
Les collines pentues de chaque côté, à deux ou trois encâblures seulement, sont rocailleuses et couvertes d’herbes rase. À environ un mille au nord, (207) qui est la direction dans laquelle elles sont orientées, les deux lignes se rejoignent sur une courte plage de sable sur laquelle débouche une étroite vallée débordant de végétation luxuriante. En arrière-plan, des montagnes, richement boisées jusqu’au sommet, parsemées de cottages, s’élèvent brutalement jusqu’à se perdre dans les nuages balayés par le vif alizé. Rien de particulièrement attrayant, néanmoins, dans ce spectacle, surtout après avoir visité la sauvage et magnifique vallée de Taioa, et admiré depuis une semaine la beauté pittoresque et variée de l’amphithéâtre de Taiohae.
L’arrivée de notre navire dans la baie fut évidemment considérée avec méfiance par les rares Naturels qui se trouvaient à distance respectable. Cela ne nous surprit pas, pas plus que d’entendre dire, un peu plus tard, que nous venions pour faire la guerre.
Dans cet archipel, il est une règle bien établie, qui permet à tout membre d’une tribu, ayant des liens de sang ou matrimoniaux avec les membres d’une autre, de passer sans risques et en toute amitié d’un territoire à l’autre. Bien au fait de la situation, nous avions requis la présence avec nous d’un Taipi qui avait épousé une femme de Taiohae où il résidait ; tandis que nous hissions un drapeau blanc au sommet du mât de misaine, nous le fîmes débarquer sur les rochers devant le navire en qualité de messager de paix. Morrison, notre interprète, rejoignit aussi la plage en canot afin d’assurer les dignitaires de nos intentions pacifiques, et de les inviter à rencontrer le capitaine. Cette démonstration de nos bonnes dispositions encouragea bientôt une ou deux pirogues à venir se ranger le long de la coque dans l’espoir de troquer des noix de coco. En moins d’une heure, le pont était couvert de jeunes garçons et d’hommes venus à la nage.
Au cours de l’après-midi, des trombes d’eau s’abattirent sur la baie pendant deux ou trois heures, mais cessèrent juste à temps pour permettre au « chef des dieux », de la classe des Taua, comme le dit Morrison, et à son compère laïc, (208) de monter à bord avant la nuit. Leur apparence personnelle en imposait beaucoup moins que celle des dignitaires des classes supérieures déjà rencontrés sans, pour autant, que leur allure ou leur discours différent de ceux de leurs compatriotes du commun. Aucun des deux n’avait pris le soin de se présenter avec ses ornements ou une tenue de parade ; seule une large houppette de plumes rouges et blanches alternées et défraîchies empanachait le front et les tempes du Taua.
Cela nous amusa bien de les entendre exprimer leurs craintes à la vue du navire ; ils croyaient fermement, dirent-ils, que « Comme Pota, nous venions leur faire la guerre. » Un « ruse de guerre » (* en français dans le texte) pratiquée par les Hapaa à leur encontre avait renforcé leur conviction. Ayant appris du Capitaine Finch qu’il avait l’intention de se déplacer pacifiquement à Hooumi, les Hapaa avait envoyé un messager aux Taipi afin de provoquer la panique dans leurs rangs en répandant la nouvelle que le navire de Porter arrivait pour les attaquer par mer tandis qu’eux et les Teii les affronteraient sur terre. Suite à cette rumeur, ils s’étaient lancés sur le champ dans la construction d’une muraille de pierres en travers de leur vallée sur laquelle ils comptaient pour en défendre l’entrée au moment de notre invasion. Après avoir expliqué leurs craintes au capitaine et lui avoir manifesté la joie de les voir sans fondements, ils dirent : « Tout va bien, alors ; vous êtes venus en paix, et Moana, notre roi, est venu avec vous. Notre vallée est votre vallée, avec tout ce qu’elle contient ; vous pouvez débarquer avec vos hommes à votre guise, en toute sécurité, et prendre ce qui vous convient. »
Le Capitaine Finch leur confia alors ses intentions, tout comme il l’avait fait avec les autres chefs ; il insista sur l’importance de suivre ses conseils au lieu de continuer à verser le sang de leurs frères, et de dévaster leurs vallées. Après chaque phrase, enthousiastes (209) et visiblement ravis, ils s’exclamaient : « Motaki ! Motaki ! », « C’est bien, c’est juste », ajoutant : « Mais tu es le seul chef à nous avoir parlé de la sorte et à nous avoir donné de tels conseils ; ton navire est le tout premier à nous faire comprendre que la guerre, c’est mal. Avec Pota, guerre, guerre, toujours guerre ! »
Le capitaine expliqua que la guerre comptait parmi le pire des maux, quelles qu’aient été, par le passé, les motivations et les obligations des autres navires. Il désigna alors du doigt les canons, les mousquets, les sabres et les épieux d’abordage composant l’armement du navire, et leur assura qu’ils n’étaient pas destinés à répandre le sang mais à nous permettre de naviguer en paix chez nous et sur l’océan.
J’étais enthousiasmé de voir le degré d’intérêt et de compréhension qu’ils portaient au sujet ; au fil des arguments proposés avec une pénétration qui capturait leur attention, et un désintéressement d’une telle sincérité, que j’étais moi-même pris au jeu. La scène avait un caractère hors du commun : le capitaine d’un navire de guerre, dans sa cabine personnelle, entouré de chefs et de guerriers les mains souillées du sang de l’un et de l’autre, développant la liste des maux provoqués par la violence et la guerre, et se mobilisant pour les transformer en amitié et en paix durable. Ils étaient suspendus à ses lèvres, exactement comme des enfants découvrant un nouveau conte. Ce dont j’étais le témoin n’était pas le fruit de mon imagination mais bien la réalisation patente de la prophétie qui déclare : « Le temps viendra où les nations de la terre feront de leurs épées de lames de charrue, et de leurs épieux des cueilloirs à fruits, et qu’ayant oublié l’art de la guerre, ils ne porteront plus le fer l’un contre l’autre. »
Les Taipi étaient si satisfaits, leur confiance en nous étant désormais tellement totale, qu’ils proposèrent d’eux-mêmes (210) de passer la nuit à bord du Vincennes afin d’être prêts à nous escorter à terre dès le matin, et à nous être le plus agréable possible. Après le dîner, je passai la soirée avec eux dans la cabine du capitaine à converser longuement sur la possibilité d’installation d’une mission chrétienne chez eux. Ils prêtèrent une attention enjouée à tous mes propos, m’assurant à plusieurs reprises d’accueillir avec gentillesse et ouverture d’esprit tous les missionnaires qui viendraient résider dans leur vallée.
À dix heures le lendemain matin, nous descendîmes à terre : Taua-kebua (* Tauàtepua), le chef laïc Taua-iea (* ?), le prince Moana et moi-même accompagnâmes le capitaine dans sa yole.
À chaque observation d’un nouveau trait du caractère de cette race sauvage, je suis de plus en plus profondément persuadé de ce que les débordements féroces et vindicatifs rapportés par des étrangers qui en furent les victimes, trouvent leur origine, tout au moins dans la majorité des cas, dans les mauvais traitements infligés par des visiteurs antérieurs ; ces comportements sont aussi le résultat direct de conduites imprudentes, maladroites ou violentes de ces mêmes personnes qui publient la férocité des insulaires à la face du monde.
Que les Nukuhiviens et leurs voisins des Marquises (* Les trois îles du sud) se soient parfois montrés perfides et sanguinaires dans leurs relations avec des visiteurs, nul ne remet cela en cause ; à mon avis, néanmoins, il faut en chercher le fondement dans le ressentiment provoqué par des affronts réels ou supposés venant d’hommes civilisés. Rares sont les étrangers qui se comportent ici de manière à attirer les bonnes grâces des Naturels qu’ils considèrent comme des moins que rien, incapables de faire la distinction entre le bien et le mal, les traitant avec le plus profond des mépris, sauf lorsque l’appel du profit leur dicte le contraire. D’ailleurs, dans leurs rapports avec eux, ces mêmes étrangers ne s’encombrent pas de principes de moralité (211) ou des considérations les plus simples de justice et d’honnêteté. Ils n’ont que faire de leur réputation, et n’ont aucune idée des inconvénients et des tracas que leur mauvaise conduite pourra entrainer chez ceux qui viendront après eux.
Bien au fait de cette situation, et dans la mesure du possible, le Capitaine Finch aspire à mettre un terme à ses conséquences désastreuses, et à effacer toutes les mauvaises impressions du passé en offrant aux chefs, maîtres d’un peuple souverain, toutes les marques de respect dont il dispose.
Nous avions d’ailleurs eu la preuve directe de la sagesse de sa détermination, et de la capacité de ces chefs sauvages à apprécier le style de vêtements et l’étiquette d’une cérémonie protocolaire comparée à une visite impromptue et informelle, en constatant la déception et l’embarras manifestes et publics du Taua de Taioa découvrant, à notre arrivée dans sa vallée, la nudité de ses compatriotes qui contrastait avec la pompe de notre première rencontre à Taiohae.
Revenons à nos moutons ! Il n’y avait pas foule sur la plage lorsque nous débarquâmes car une grande quantité d’hommes se trouvaient sur le Vincennes dans le but de troquer des noix de coco et autres articles ; quant aux nombreuses femmes qui se tenaient sur les rochers en face du navire, elles n’eurent pas le temps de rejoindre la plage avant notre arrivée. Le Taua nous conduisit chez lui, à une centaine de mètres derrière un mur de pierres qui barre l’entrée de la vallée ; sa maison est une grande habitation conforme à celles observées précédemment, plongée dans l’ombre épaisse des bosquets qui la surplombent, et de la végétation luxuriante qui s’épanouit à l’intérieur des enclos.
Et c’est ce moment-là, sur leur propre territoire, à l’intérieur d’une de leurs propres demeures, entourés de leurs épouses et de leurs enfants, et en présence des officiers de notre groupe, que choisit à nouveau le Capitaine Finch pour leur réitérer les conseils déjà prodigués avant de distribuer l’étoffe, le calicot, les outils de fer, &c. que nous avions apportés. Ils lui renouvelèrent l’approbation cordiale de ses intentions, ajoutant qu’elles étaient bonnes (212), et que jamais personne auparavant ne leur avait mis de telles idées nouvelles en tête ; qu’ils seraient heureux de faire la paix avec les autres tribus afin de jouir, dans le futur, d’une vie d’amitié et d’harmonie.
Tout en admettant l’enlèvement de membres d’autres tribus afin de les offrir en sacrifice, ils se justifiaient en expliquant que les Hapaa et les Teii étaient coupables des mêmes agissements envers eux. Désireux de savoir s’ils consommaient vraiment le corps de leurs ennemis ou les prisonniers faits lors des combats, nous leur posâmes la question sans ambages et, après une courte hésitation, ils répondirent à plusieurs reprises par l’affirmative. Devant nos manifestations d’horreur face à une telle abomination, ils affirmèrent qu’ils ne recommenceraient plus ; le Taua ajouta qu’il interdirait les sacrifices humains à l’occasion de sa mort afin qu’il n’y ait plus besoin de partir en quête de victimes humaines dans le futur.
Apprenant qu’il y avait un meàe ou temple dans le voisinage immédiat, nous en prîmes la direction après la conversation. Le bâtiment principal était vide mais jonché de débris d’offrandes végétales variées ; dans une cabane contigüe plus petite, se trouvaient trois idoles grossièrement sculptées semblables à toutes celles déjà observées, sauf une qui était un Janus Bifrons. C’était la première divinité biface que je voyais.
L’épaisseur des bosquets d’arbres à pain dominés par les cocotiers élevés, ainsi que la densité du sous-bois, bloquaient complètement la circulation de l’air marin. Lassés de la pesante humidité qui alourdissait nos pas et la chaleur oppressante, nous convînmes de rejoindre nos embarcations.
À la sortie des broussailles, l’atmosphère chaude et humide de l’intérieur des terres se changea en une brise marine légère et délicieuse qui nous réconforta tellement que nous restâmes à en profiter une demi-heure sur la plage, à l’ombre bienfaisante d’un bosquet d’hibiscus. Nous eûmes bientôt une autre scène à contempler : une foule de tous sexes et de tous âges (213) qui nous encercla de sa rusticité afin de nous observer, de nous admirer et de nous manifester son amitié par de joyeuses exclamations.
Notre départ fut l’occasion d’un autre spectacle intéressant. Après avoir dépassé le ressac, nous lâchâmes nos avirons et, tout en attendant que notre groupe se fût embarqué sans encombre, nous pûmes jouir de la splendide vue d’ensemble de cette plage en croissant de lune qui s’étale en bas d’une vallée richement boisée et surplombées de montagnes. Des centaines d’insulaires s’agglutinaient sur la grève, formant une seule masse, depuis les enfants accrochés au cou de leurs mères jusqu’aux vieilles dames décaties, plus que septuagénaires, et aux vieux guerriers aux cheveux blanchis et à la barbe frisée dont les lances semblaient plus leur servir à soutenir la décrépitude de leur carcasse chancelante que d’armes défensives contre un éventuel ennemi. Chez certains de ces hommes, on remarquait les boutons dorés, les épaulettes et le couvre-chef d’un officier, ou l’uniforme moins coûteux mais plus joyeux d’un marine qui contrastaient fortement sur ces insulaires farouches, leur peau tatouée et leurs ornements sauvages.
Ce fut là une des scènes les plus marquantes et originales qu’il nous fut donné d’observer sur cette île, et qui monopolisa notre regard jusqu’à ce que nous ayons atteint le navire.
Au cours de l’après-midi, je retournai à terre avec l’intention de passer une heure à faire quelques dessins, mais un charmant Naturel, que j’avais vu au service d’un chef le matin, me pressa de l’accompagner dans la vallée pour voir, selon ses propres mots : « Le pays du jeune roi Moana » ; en dépit des terribles descriptions qu’on nous avait faites des Taipi, j’acceptai de le suivre et nous nous enfonçâmes jusqu’à une distance d’un mille et demi ou deux milles à l’intérieur des terres (*environ 3km). La vallée est arrosée par un vif cours d’eau claire qui court sur toute sa longueur ; on y retrouve partout la même richesse du sol, et la végétation dense observée près de la plage. À en juger par le nombre d’habitations, elle doit être très peuplée bien que, (214) depuis le navire, ses confins montagneux la fassent paraître resserrée sur elle-même.
Je n’ai remarqué que deux cases ayant un caractère religieux. La première, un site funéraire comportant les petits sanctuaires et le catafalque du défunt, était contigüe à une autre construction, contenant, comme d’habitude, trois idoles ; la seconde était la maison tapu d’une personne de haut rang, située sur une plateforme surélevée dont deux des coins étaient ornés d’une statue de pierre que la mousse avait recouvert de sa verdure au fil du temps.
Le tahua (* tohua) ou aire de danse s’étend à un mille de la côte (* 1600m) ; il est de belle facture, aussi bien construit que celui observé dans la vallée supérieure des Hapaa. Une des maisons d’habitation à proximité est la plus vaste, la mieux construite et plus décorée de tous celles que nous ayons visitées à Taiohae ou Taioa. Je pris le temps d’en dessiner une esquisse, au plus grand étonnement des nombreux badauds qui furent saisis d’admiration quand je la leur montrai, et qu’ils comprirent, peut-être, les raisons de ma démarche.
Une vieille femme gisait, malade, dans un coin. Je m’approchai afin de tenter de découvrir les raisons de son mal, mais elle se montra plutôt revêche, et tout ce que je pus obtenir d’elle tenait en ces mots : « Mai iau », « Je suis malade. » (* Cela ne correspond pas). C’était la première fois que je voyais un malade mis à l’écart à cause de sa maladie ; d’autant que, désormais, nous savons leurs maladies rares et peu nombreuses. Outre les affections pulmonaires et les maladies de foie, on trouve l’hydropisie et ses œdèmes qu’ils attribuent à la consommation de fruits sur lesquels un tapu avait été imposé par une cérémonie spéciale. Ils sont aussi sujets aux rhumatismes qui sont parfois très sévères, et provoquent des contractions des doigts et des orteils, les obligeant à marcher voutés. Ils attribuent aussi aux superstitions la cause de ces maux. On dit qu’une sorte de lèpre existe aussi ici, couvrant la peau de squames, et affectant l’usage des membres en recroquevillant les doigts et les orteils.
Les maladies des yeux ne sont pas rares, allant jusqu’à provoquer la cécité totale ; on les appelle alors « mate kaha », « la maladie causée par un maléfice » dont quelques personnes seulement possèdent la maîtrise. Afin de jeter un sort, on dit que ces ensorceleurs se procurent de la salive de leur future victime et, qu’après l’avoir enveloppée dans un paquet confectionné d’une manière particulière, ils enterrent le tout. En se décomposant, ils croient que le charme entraine la cécité progressive de leur pauvre victime qui s’affaiblit et meurt. Il n’y a d’autre remède que de tenter de découvrir le kaha caché.
Les furoncles, les abcès et les maladies de peau sont très répandus ; il y en a encore d’autres affections parmi lesquelles celle qui, dans notre pays, touche les écoliers dissipés et parfois quelques adultes. (* ?) Malgré tout, dans sa grande majorité, la population se caractérise par un meilleur état de la peau qu’aux îles Sandwich et ici, on voit peu de personnes affublées de difformité dégoutante causées par des affections cutanées comme on peut le voir chez nos vieux amis hawaiiens.
Après avoir traversé le torrent à plusieurs reprises sur le dos de mon aimable guide attentionné, et parcouru la distance mentionnée plus haut, un Naturel nous doubla, le pas rapide, vociférant avec mon compagnon des propos menaçants, et ignorant les miens. Soudain pris d’embarras, ce dernier s’exclama : « Rentrons ! ». Voulant connaître le pourquoi de cette décision, la seule réponse que j’obtins fut : « Retournons à la plage ! » et, me saisissant la main, il m’entraina dans sa course. Bien que la majorité des personnes rencontrées répondaient avec la gentillesse habituelle à mes « Aloha ! », je compris, au regards sombres et patibulaires de certains autres que quelque chose n’allait pas. Mon impression se trouva confirmée lorsqu’un colosse en furie, assis entre les deux statues de pierre de la maison tapu mentionnée plus haut répondit à mes salutations par une grimace démoniaque. La seule explication obtenue de mon guide fut : « Kakino », « C’est mauvais ! » (* Plutôt « Kikino ») qu’il me lança en me pressant d’avancer, expression manifeste de son appréhension qui disparut à notre arrivée sur la plage (216) où notre groupe commençait à se rassembler pour embarquer dans les canots. Je ne connais toujours pas la cause de l’embarras de mon guide, ni de l’agressivité manifestée à notre égard par de nombreuses personnes sur le chemin du retour.
____________
LETTRE XXXII
EXCURSION DANS LA VALLÉE DE HAKAPAA
Baie de Hooumi à Nuku Hiva
Le 8 août 1829
Hooumi est le plus oriental des trois profonds renfoncements découpant la Baie du Contrôleur, chacun d’eux étant séparé de son voisin par un magnifique promontoire verdoyant, mais dépourvu d’arbres, qui se prolonge en direction de l’ouverture sur l’océan. La partie centrale de la baie, la plus vaste et la plus profonde, s’enfonce à deux miles (*3.2km) plus profondément dans les terres que les deux autres ; elle se nomme Hakahaa, et sa basse vallée marque la limite entre les territoires des Hapaa et des Taipi. C’est dans cette partie-là que le Commodore Porter affronta ces derniers. Le renfoncement le plus à l’ouest se nomme Hakapaa ; il se trouve à une distance de trois milles (*4.8km) de Hooumi et c’est le plus petit des trois. Ses rives sont habitées par les Hapaa.
Afin de visiter ces endroits, nous embarquâmes dans trois chaloupes, et quittâmes le Vincennes à neuf heures ce matin. À peine eûmes-nous doublé le premier cap, à un demi-mille du navire, que du point de vue spectacle au moins, l’intérêt de l’excursion nous sauta aux yeux. Le sommet du promontoire, composé de strates successives de lave noire recouvertes d’herbe, étincelait fièrement dans la lumière matinale, tandis que l’intérieur entier de la vallée, et les montagnes la surplombant, étaient noyés dans la masse des bosquets aux essences d’arbres magnifiques et variés. Jusqu’au sommet des montagnes, éparpillés parmi les bois qui s’y accrochaient, on apercevait les cottages des Taipi, aussi blanchis par la succession du soleil et des pluies que les maisons chaulées de chez nous. (217) Ainsi perchées sur les cimes solitaires de la forêt et en partie exposées à la vue, parmi l’ombre épaisse qui les encercle et les surplombe, si nous n’avions pas su qu’elles étaient des antres de sauvages, il ne nous aurait pas été difficile d’imaginer qu’à les voir ainsi élégantes et de bon gout, y résidaient des hommes plus heureux de leur sort que les Highlanders d’Écosse ou les paysans des Alpes.
Notre première destination était la vallée de Hakapaa afin de rencontrer le Taua des Hapaa et d’échanger avec lui ; nous tirâmes sur nos avirons afin de traverser en ligne droite la partie de la baie qui s’étend sur deux milles (* 3.2km) en direction de la zone neutre, la plage de la vallée centrale, qui s’étire jusqu’aux lointaines montagnes bleutées, précédées du second promontoire. Ce dernier masque entièrement la partie habitée de Hakapaa et, après l’avoir doublé, notre regard fut immédiatement attiré par le sommet d’une chute d’eau, tombant d’une hauteur de cinq ou six cent pieds (* 150 à 180m) au milieu d’un précipice richement boisé qui, l’entrée de la baie exceptée, enserre la vallée toute entière d’un galbe d’un demi-mille de large (* 800m). Le cours d’eau était le plus imposant de tous ceux déjà observés, et son approche promettait de satisfaire nos attentes qui ne furent pas déçues.
(Temple pour les sacrifices humain dans la vallée de Hakapaa, îles Washington)
Les deux photos suivantes sont de Lionel Gouverneur - Photo Marquises - septembre 2021; la 1ère donne une vue d'ensemble depuis l'entrée de la baie du Contrôleur à gauche, et la vallée de Taipi à droite.


En accostant sur la petite plage qui baigne le pied de la vallée, les caractéristiques générales du lieu ne nous parurent pas différentes de ce que nous avions observé auparavant ; l’élégance et le caractère massif des murets de pierres, ainsi que le confort apparent des habitations, étaient semblables à tout ce que nous avions déjà aperçu, même dans la vallée de Taioa. La rivière qui court dans la vallée, descend rapidement de la cascade pour se jeter dans la partie orientale de la baie. Près de son embouchure, une flotte de pirogues de pêche était remontée sur le sable et, parmi elles, reposait une grande pirogue de guerre, de la même facture que celle (218) dans laquelle les chefs de Taioa étaient venus rendre visite à notre navire. En plus de la divinité en bois et des touffes de cheveux humains ornant la plateforme surélevée de la poupe, deux crânes de victimes Taipi y étaient fixés sur chacun de ses côtés, proclamant les prouesses du vainqueur lors de combats passés, et destinés, de par leur regard spectral, à intimider et à terroriser un ennemi assez téméraire pour s’approcher lors d’une prochaine bataille. Comme c’était la première fois que nous étions confrontés à un tel spectacle, cette vision brutale nous fit comprendre que nous nous trouvions bien dans un de ces « endroits obscurs de la terre » qui sont « pleins d’exemples de cruauté ».
Entourés d’une foule joyeuse et admirative, nous suivîmes les détours du torrent jusqu’à la résidence de Taua-tini (* Tāuàtini), prophète des Hapaa, titulaire du grade religieux le plus élevé de sa tribu, tout comme Piaroro, doté du grade civil le plus haut dans la sienne. Sa maison se dresse au centre du village, sur une vaste plateforme basse, à l’ombre de nobles géants. Probablement avisé de notre arrivée avant même que nous accostions, le Taua s’était visiblement préparé à notre rencontre ; il nous attendait. C’est un homme grand et mince, vénérable, aux traits bien marqués, dont le comportement et l’attitude sont bien plus sereins et dignes que ceux de ses compères déjà rencontrés. À notre arrivée, il resta assis sur une natte posée le long de sa maison, juste devant une petite entrée. Il était entièrement enveloppé d’un vaste manteau blanc de tapa ou étoffe locale sur lequel une autre pièce d’étoffe écarlate, de la finesse du tissu de cachemire, lui tombait des épaules dans le dos ; les deux vêtements étaient fixés par un gros nœud reposant sur sa poitrine. Un double enroulement de tapa blanc magnifique lui enserrait le front, tandis que ses cheveux, séparés en deux chignons serrés, étaient maintenus sur le sommet de la tête par de longs rubans du même tapa. La prestance saisissante (219) et patriarchale qui rayonnait du personnage tout entier nous mit en condition favorable à son égard, et nous porta à lui manifester un respect et une politesse inhabituels à mesure que nous nous approchions de lui.
Après avoir échangé les salutations d’usage, et présenté ses officiers, le Capitaine Finch, passant par l’interprète, entama la conversation, faisant état des motifs de sa visite, à savoir, le souhait de lui manifester le même respect qu’aux autres Taua, amis et ennemis, et le désir de l’encourager à faire régner paix et amitié entre sa tribu et les Taipi. Il développa ensuite son point de vue, pointant du doigt les maux et les inconvénients des hostilités actuelles, et mettant en exergue les avantages et les bienfaits qui découleraient d’une paix durable.
Plongé dans ses pensées, le Taua prêta une attention sérieuse et attentive aux propos du capitaine ; à la fin, après avoir réfléchi en silence, il fit part de son approbation réjouie de tout ce qui venait d’être dit. Nous étions tous extrêmement satisfaits du bon sens et du profond sérieux, tout en restant aimable, de cet homme remarquable que nous plaçâmes immédiatement en tête de liste des hommes respectables de l’île. Dans son comportement, nulle légèreté enfantine, nulle propension à se laisser distraire de la discussion par une futilité de passage, comme en sont coutumiers les Naturels incultes des Mers du Sud, mais au contraire, une sobriété et une considération constantes, convenant à son rang et au sérieux des sujets traités.
Après la conversation qui ne fut pas très longue, la distribution de cadeaux commença, et l’on requit la présence des femmes de la maisonnée afin de leur en faire profiter. Elles se trouvaient dans une maison voisine d’où apparurent bientôt l’épouse et quatre filles dont la cadette avec ses douze ans, et l’aînée (220), âgée de vingt ans ; toutes jolies et avenantes, elles incarnaient à un degré peu commun pour des dames de Nuku Hiva, la réserve et la dignité de leur père. À en juger de par leur teint à peine plus foncé que celui d’une brunette opaline, on avait du mal à croire que c’était ses filles, tant le tatouage recouvrant chaque repli visible de sa peau le faisait ressembler au plus noir des Maures. Leur tenue se composait de longues toges blanches enveloppantes, et des bandeaux et turbans de la même étoffe ajustés avec un gout et une grâce des plus seyants.
Considérant d’importance capitale pour l’établissement de la paix que Tauatini et les chefs Taipi se rencontrent en personne, le Capitaine Finch l’invita à nous suivre au navire, accompagné d’un grand guerrier et des femmes de sa famille. Ils ne s’attendaient pas à cette proposition qui provoqua chez eux une grande surprise. Néanmoins, au terme de quelques minutes de réflexion et d’un semblant de débat silencieux, il exprima son désir de se placer sous la protection du capitaine, et de lui retourner la politesse de sa visite en prenant part à une conférence de paix sur le navire en présence des Taua et des Hekaiki (* hakāìki = chef) de la tribu ennemie. Les dames aussi se montrèrent très heureuses de la proposition, faisant une seule requête, celle de leur laisser le temps d’ajuster leur « toilette » avant de nous rejoindre ; faveur que nous leur accordâmes avec joie tandis que nous partions en avant à l’affut des originalités intéressantes de cette petite vallée sauvage.
L’examen d’un temple immédiatement contigu à la demeure du Taua nous laissa une impression de profonde mélancolie, faisant ainsi état de la dégradation de l’esprit et des passions humaines auxquelles conduisent l’ignorance et la superstition lorsque leur influence n’est pas contrôlée. Les preuves évidentes de délabrement profond dans lequel se trouvaient la plupart des structures de ce genre, que nous avions rencontrées de par le passé, nous conduisaient insensiblement à les considérer plutôt comme les ruines (223) d’un système de croyances dont les rites avaient cessé, et comme les traces monumentales abandonnées par des croyants apostats à la curiosité du visiteur de passage. Cependant, dans toute la fraicheur de leur difformité, ces structures étaient bel et bien destinées à des cérémonies de consécration rituelle en ce moment même et, à cet endroit, nous fûmes en mesure de constater de visu que la superstition continuait à maintenir les hommes sous l’emprise de la cruauté et de la crainte.
Tout comme le lieu identique visité dans la vallée de Taioa, cet endroit est réservé aux sacrifices des victimes humaines qui ne sont pas consommées. Une plateforme de pierres, haute de trois pieds (*90cm) et longue de vingt (*6m), enfouie, sauf à son entrée, dans un enchevêtrement de pandanus dont elle est le cœur, marque l’endroit où les restes des victimes immolées sont jetés après s’être putrifiés et dissous sous les yeux des statues des divinités auxquelles elles furent sacrifiées. Immédiatement en face de ce fourré, dans une auge profonde et sculptée à une extrémité d’une tête grossière grimaçant hideusement et prête à dévorer les curieux, était allongée une victime de la cruauté, masse informe de putridité, dont saillaient les os verdâtres et décolorés du crâne et des côtes que nous pûmes discerner clairement à la faveur du rapide coup d’œil que nous y jetâmes. Toute proche, la statue difforme à laquelle ce corps fut sacrifié, elle-même couverte de pourriture verdâtre, reposait contre la plateforme dans une attitude d’impuissance et d’inanité qu’un esprit éclairé trouveraient suffisantes pour qualifier de déraisonnables les mains qui l’ont sculptée et les esprits qui s’inclineraient devant pour l’adorer.
Sur la droite, se dressait un Tupapau, ou maison des morts (* Tūpapaù est en fait le nom donné de nos jours aux défunts ou aux revenants), contenant un cadavre dont la putréfaction rendait l’air irrespirable, et dont les mânes avaient peut-être réclamé le sacrifice mentionné plus haut ; à droite, on voyait un autel gardé par une idole à chacune de ses extrémités, et devant lequel des offrandes avaient été déposées dernièrement. Outre les noix de cocos et les fruits à pain frais placés sur le sol, des poissons et (224) des morceaux de viande de porc avaient aussi été suspendus très récemment à l’entour ; deux chiens, tués et préparés, mais grossièrement, comme pour être consommés, avaient été accrochés devant les statues, un par le cou à un poteau, et l’autre reposant dans un panier de feuilles de cocotier accroché à un piquet, le tout grouillant de mouches et répandant une odeur nauséabonde amplifiée par le soleil de midi.
Mon cher H _______, telle est la vision d’un temple à Nuku Hiva, un jour de sacrifice ! Après avoir vu une telle scène, ou en avoir entendu le récit, qui osera dire : « Les païens n’ont nul besoin de l’Évangile de Jésus pour devenir plus sages ou plus heureux ! Leur religion est inoffensive et leurs sacrifices sont tout à fait acceptables pour un Dieu juste et bon ! » Face à de tels actes, qui pourrait croire un seul instant que le missionnaire de la Croix cause plus de mal que de bien quand la Providence divine fait de lui l’instrument de la destruction de tels autels d’abomination sanglante et, sur ces ruines, le bâtisseur d’humbles chapelles de prière et d’adoration où la seule offrande requise est le sacrifice « d’un cœur humble et contrit », et où la seule victime expiatoire de ses fautes est « L’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ! » Il me fut impossible d’être témoin de ce spectacle sans adresser à Dieu, par pitié pour ses créatures, la plus ardente des prières, le suppliant de préparer sans tarder le chemin conduisant au renversement total de ce système de mort obscurantiste et, en prêchant l’Évangile du Salut, de faire en sorte qu’en ce même lieu, par ces mêmes gens, Lui, l’Esprit pur et glorieux, soit honoré en esprit et en vérité.
Les quelques instants passés devant ce spectacle nous affectèrent autant le corps que l’âme, et nous détournâmes rapidement les yeux de ce spectacle révoltant en quête de nouveautés et de beauté capables de dissiper le dégout qui nous déchirait le cœur.
Quel que puisse en être l’éloignement, j’étais déterminé à prolonger ma promenade (225) jusqu’à la cascade que j’avais remarquée de loin, en entrant dans la baie. Comprenant mes intentions, le Taua désigna promptement un guide pour m’y accompagner. Doutant de ses capacités physiques à se lancer dans une telle marche, le Capitaine Finch déclina mon offre ; je partis donc accompagné de l’aspirant Huntt, escorté par l’équipage en armes de la chaloupe. Néanmoins, c’est avec le groupe au complet que nous remontâmes le long du torrent afin d’avoir une vue générale du village.
À peine avions nous fait quelques pas qu’un homme à l’allure digne, à l’air amical et affable, âgé d’environ trente-cinq ou quarante ans, nous fit signe avec son éventail depuis la haute plateforme de sa maison, nous invitant à venir le rencontrer ; invitation acceptée sans hésitation tant étaient évidents le soin apporté à l’entretien de la propriété et la respectabilité de son propriétaire. C’était un chef de haut rang et, en découvrant les raisons de sa requête, nous ne regrettâmes pas d’y avoir satisfait.
Peu après notre arrivée à Nuku Hiva, virent à notre oreille les détails d’atrocités perpétrées récemment par un navire y faisant escale, qui suscitèrent notre indignation face à la mauvaise conduite d’hommes venant d’un pays chrétien, et nous inspirèrent compassion et sympathie pour les insulaires maltraités.
Un baleinier américain se mit à la cape dans une des petites baies de l’île indiquant qu’il voulait communiquer avec la terre ; une grande pirogue prit sa direction avec sept hommes à bord. À peine cinq d’entre eux eurent-ils posé le pied sur le pont que le navire prit le large. Trois des hommes les plus gaillards furent mis à part et détenus à bord tandis que les deux autres furent jetés à la mer et durent rentrer à la nage, leur pirogue étant hors de portée. (226) Un des hommes kidnappés, âgé de dix-huit ou vingt ans, était le fils unique d’un grand chef, et très apprécié dans sa tribu. Aux côtés de ses parents et de sa sœur, une épouse aimante pleurait son absence dans l’ignorance du sort qui lui avait été réservé.
Les circonstances de cet épisode nous avaient profondément interpelés lorsque nous les avions entendu raconter dans l’autre baie ; elles ressurgissaient maintenant avec une intensité et une compassion redoublées en apprenant ainsi fortuitement que cette magnifique vallée était le lieu du crime, et que nous nous trouvions sous le toit et en présence du père avec, devant nos yeux, la mère, la sœur et l’épouse du chef kidnappé. Une tristesse profonde et sincère se lisait sur leurs visages tandis qu’ils nous répétaient les détails du tragique épisode. Touché par les sanglots qui interrompaient leurs supplications, le Capitaine Finch s’engagea à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire revenir chez lui celui qui avait été si brutalement enlevé à leur affection. À chaque pleine lune, un nœud était ajouté sur une cordelette de tapa devenue outil de mesure du temps écoulé depuis le drame ; on y comptait déjà cinq de ces marques qui désignaient le mois de mars comme période de l’infamie.
Cet enlèvement était probablement destiné à combler une pénurie d’équipage causée par la désertion ou la mort d’un des hommes. Après avoir profité des services rendus par ces Naturels, et s’ils survivent assez longtemps, ce cynique de capitaine n’aura aucun scrupule à répéter sa forfaiture en débarquant les malheureux sur n’importe quelle île, fusse-t-elle à des milliers de milles de chez eux. Ou encore, à les abandonner sur un rocher inhabité comme ce fut le cas en des circonstances qui ont été rapportées à un membre éminent de notre gouvernement (227) dans cette partie du monde, et qui m’en a assuré de la véracité.
La grande affliction manifestée naturellement par cette famille, leur gentillesse et leur amabilité, le confort et la respectabilité de leur demeure mobilisaient notre profonde sympathie à leur égard. Après avoir condamné dans les termes les plus forts l’agression commise sous pavillon américain, et manifesté sa compassion la plus sincère, le Capitaine Finch leur assura que tous les moyens seraient mis en œuvre pour leur restituer leur proche, et faire éclater au grand jour la vilénie du coupable de cet acte qui avait plongé leur famille dans le chagrin du désespoir.
Après cet épisode, Mr. Huntt et moi reprirent notre marche vers la cascade dont le déferlement nous emplissait déjà les oreilles. À quelques douzaines d’enjambées, à travers la cime des arbres, nos yeux perçurent l’éclat de sa blancheur ; peu après, elle nous apparaissait dans toute l’impétuosité de sa chute qui surpassait nos attentes de par sa hauteur et sa beauté. Tandis que nous avancions prestement, nous exclamant de ravissement à chaque pas, nous envoyâmes un des hommes de la chaloupe prévenir le capitaine de la proximité de la chute d’eau afin de faire bénéficier notre groupe entier de notre émerveillement. Cette cascade ne doit pas faire loin de 300 pieds de haut (* 91m). Son sommet se dégage contre le ciel, se précipitant d’une falaise, et retombant dans une gorge formée de deux parois boisées ; puis, sautant les différentes strates d’un escalier de pierre, elle plonge de soixante-dix ou quatre-vingt pieds (* 21 à 24m) dans un bassin formé par une corniche couverte de buissons et de lianes où elle disparait un moment avant de ressurgir un peu à droite de la saillie pour retomber d’une seule masse, bondissant de rocher en rocher, le long des derniers 200 pieds (* 60m) d’une falaise presqu’à pic. Le débit de l’eau n’est pas très fort, mais sa plongée verticale d’une si grande hauteur qui se termine dans un bassin presque calme et tranquille suffisent à produire une forte impression visuelle et sonore. (228)
Je me lançai dans l’exécution d’une esquisse rapide tandis que le Dr. Malone parvenait à mesurer la basse section de la chute d’eau avec une ligne, ce qui nous permit d’avoir une estimation plus précise de sa hauteur. Sur mon esquisse, j’avais évalué la hauteur de la corniche à soixante-dix pieds (*21m) ; une fois mesurée, la ligne nous donna le nombre de soixante-six pieds (* 20m), ce qui me conforta dans la rectitude de mon estimation totale à deux-cent quatre-vingt ou trois cents pieds. (* 85m à 91m). L’endroit nous enthousiasmait tellement que nous ne pouvions nous résigner à le quitter mais, quand j’eus terminé mon esquisse, nous fûmes dans l’obligation de rejoindre nos embarcations si nous voulions avoir le temps, comme nous l’avions programmé, de rendre visite à la baie et la vallée toute proche de Hakahaa.
_________
LETTRE XXXIII
HAKAHAA, LA VALLÉE EN TERRAIN NEUTRE
Baie de Hooumi à Nuku Hiva
Le 9 août 1829
Hier, en descendant de la cascade, à notre arrivée chez le prophète, nous le trouvâmes prêt à nous suivre sur le Vincennes avec son épouse te ses filles.
Néanmoins, au moment de nous mettre en route, la fille cadette dut se soumettre à une obligation qui lui fut source de tristesse et de déception. Elle venait de nous rejoindre d’une humeur joyeuse lorsque, malheureusement, on entendit soudain les pleurs d’un nourrisson de quelques mois. La grand-mère l’enjoignit de rester avec lui et, par devoir parental ou par amour filial, la jeune fille se résolut à obéir, mais à contre-cœur, je n’en doute pas.
Aux îles Sandwich, avant l’influence récente du christianisme, ce genre de péripétie aurait probablement trouvé une issue bien différente, et le bébé aurait braillé en vain. (229) Je me réjouis de signaler ici que toutes mes enquêtes passées aboutissent à l’heureuse conclusion que l’horrible crime d’infanticide, si fréquent chez les Hawaiiens et d’autres Polynésiens, est un crime païen qui épargne les Nukuhiviens et leurs compatriotes des îles Washington et Marquises. Pour autant qu’on puisse en juger, le peuple de ces îles est aussi tendre avec ses enfants, et leur démontre autant d’attachement et de soin, que les habitants des pays civilisés. C’est un fait dont ce bonheur mérite d’être mis en exergue, comparé à l’horreur de l’infanticide, dévoilé à l’occasion des descriptions du paganisme des insulaires des îles du Roi Georges et des îles Sandwich.
Toutes les relations familiales apparaissent ici, en effet, sous des auspices beaucoup plus favorables qu’elles ne l’étaient, à l’origine, chez ces deux groupes de population. Bien qu’existant presque exclusivement sous la forme blâmable qu’est la polygamie, c’est-à-dire pluralité d’époux au lieu d’épouses, les liens du mariage paraissent plus marqués, plus contraignants et plus durables qu’aux îles de la Société et aux îles Sandwich. Mis à part un échange de cadeaux entre le futur époux et le père de la fiancée, et un banquet familial accompagné de danses et de chants, il ne m’a pas été donné d’entendre dire qu’une cérémonie particulière soit célébrée à l’occasion de l’engagement des époux.
En effet, nous n’avons encore jamais été amenés, à aucun niveau de la société, à rencontrer un homme ayant deux épouses, mais on nous a décrit comme universelle la coutume pour une femme d’avoir deux maris. Alors qu’ils sont encore très jeunes, un familier de la maisonnée ou de la suite du père devient le mari de la fille, qui vit sous le même toit que son père jusqu’à ce qu’un mariage soit contracté avec un deuxième élu ; à la suite de quoi, elle déménage avec son premier compagnon chez le second qui pourvoit aux besoins matériels du duo. (230)
Pour des raisons trouvant leur origine dans la politique ou l’ambition, il arrive fréquemment que des alliances comportant de grandes différences d’âge soient contractées au sein des familles de notables ; un enfant, garçon ou fille, est alors promis à une personne du sexe opposée d’âge mûr ou même avancé. Les contrats de ce genre apparaissent fréquemment au moment de l’établissement de la paix entre deux parties ou deux tribus hostiles ; les membres des familles alliées sont alors protégés de toute forme de violence et de mort en cas de guerre future ou de dévastations opérées lors d’incursions menées avec succès sur le territoire de l’une ou l’autre tribu.
On nous a rapporté des exemples de profonde affection conjugale, avec même des cas dans lesquels l’infidélité ou la méchanceté de l’époux ou de l’épouse avait tellement affecté l’autre qu’il ou elle n’hésitait pas à se suicider.
Nous avons ramé environ trois milles (* 5km) pour faire le tour du promontoire qui surmonte cette petite vallée, et déboucher dans la partie centrale de la baie de Hakahaa baignant la zone neutre qui offre une variété de perspectives splendides. L’anse centrale s’enfonce dans les terres sur une profondeur d’environ deux milles et une largeur d’un mille (* 3.2 à 1.6km). En doublant le promontoire, venant de Hakapaa, nous découvrîmes les flancs des collines couvertes d’herbe épaisse mais, parvenus à mi-chemin de la plage où nous devions accoster
« Un paysage boisé, des deux côtés,
Descendait en crètes de verdure
Venant accrocher au rivage
La douceur de son ombre ». (* Citation d’origine inconnue)
Cela était particulièrement vrai pour les pentes occidentales. Posée sur une base de galets aux pieds de la plage, une grève verdoyante s’élevait en pente douce, sur quelques enjambées, pour former une vaste terrasse bien régulière qui s’étendait le long des collines jusqu’à l’entrée de la vallée à une distance d’un mille dans les terres ; elle était si boisée qu’on aurait dit les prémices d’une charmille conduisant à une noble et riche demeure. (231) Cela me rappelait les promenades en carriole à travers les parcs anglais ; mais aucun aristocrate du royaume ne peut se targuer d’une telle parure pour ses terres qui rassemblerait, comme ici, d’un seul coup d’œil, autant de luxuriance, de grâce et de variété de feuillage. Immédiatement en face, de l’autre côté de la baie, notre attention fut attirée par un élément de paysage tout aussi frappant bien que moins pittoresque, à savoir, une immense plantation d’arbres à pain faisant saillie au-dessus des pentes en un alignement aussi parfait que celui des vergers de chez nous. C’est la première fois qu’il m’est donné de voir une plantation aussi bien ordonnée dans les Mers du Sud ; cela conforte agréablement l’idée de la grande beauté qu’offrirait ce pays si ses habitants se trouvaient correctement éduqués et formés par des cultivateurs habiles et dévoués.
En nous approchant, l’étendue et l’importance de cette zone neutre, presque inoccupée, nous parut de plus en plus manifeste. De par sa forme et la hauteur des montagnes qui l’entourent, de par la platitude et la largeur de sa plaine alluviale et la rivière coulant en son centre, et de par l’évidente richesse du sol, cette étendue ressemble plus à une vallée américaine que tout ce que nous avons pu observer auparavant. Aucune trace de formation volcanique, si remarquables à Taioa et Taiohae mais, au contraire, toutes les douces caractéristiques d’une terre susceptible de recevoir un développement agricole de haut niveau. Cette différence lui procurait un charme nouveau qui nous réjouissait le cœur, non seulement à cause du contraste avec ce que nous avions observé récemment, mais aussi parce qu’elle nous rappelait des paysages familiers, bien de chez nous.
Les femmes de la famille du Taua se refusaient à franchir les limites du territoire ennemi, mais leurs craintes s’évanouirent lorsque nous annoncèrent que leur canot (232) resterait un peu au large pendant le débarquement de notre groupe. Tauatini fut le seul Naturel à débarquer aux côtés du capitaine. Bien qu’un nombre considérable de Taipi, guerriers et gens du commun, se fût rassemblé sur l’épaisse pelouse au-dessus du sable, personne ne semblait surpris de trouver, dans notre groupe, une personne de rang aussi distingué que Tauatini, membre d’une tribu avec laquelle ils étaient en guerre. Nous ne remarquâmes, non plus, aucune différence entre le comportement du prophète avec eux et ceux de sa propre tribu. Assis parmi eux sans crainte apparente, il conversait comme s’ils avaient tous été dans les meilleurs terme du monde.
L’exercice physique et les émotions du matin nous avaient mis en appétit et, une fois sur la grève, nous ne tardâmes pas à envoyer Morrison, l’interprète, se mettre en quête d’un endroit adapté à une séance de rafraîchissements. Une fois l’endroit sélectionné, nous nous y installâmes et, assis sur nos cirés, à l’ombre d’un grand arbre très fleuri, le capitaine nous régala d’une collation richement pourvue de viandes variées, servies par l’équipage, comme il est de coutume en de telles circonstances.
Agglutinés de l’autre côté du chemin que nous avions défini comme limite tapu à ne pas traverser, nos amis cannibales observaient avec étonnement notre rapacité endiablée, pensant peut-être que nous étions aussi voraces qu’eux ; fort à propos, la vitesse à laquelle disparurent les volailles présentées sur nos tréteaux sylvestres, apporta de l’eau à leur moulin.
Les bosquets où nous nous trouvions, et le chemin les traversant, sont le lieu même où débutèrent les escarmouches entre le Commodore Porter et les Taipi lors de sa première tentative d’invasion de la vallée, où il était venu avec son navire depuis le port de Taiohae. Après avoir subi le déluge des pierres de fronde et des lances (233) des embusqués le long du chemin, il réussit à s’infiltrer avec quelques hommes à une distance de deux milles en amont jusqu’à une lourde muraille de défense qui s’avéra un véritable obstacle à sa progression ; il dut alors battre en retraite en profitant d’une occasion lui permettant l’éviter le déshonneur de la reculade. J’étais impatient de suivre ses traces et, après le repas, je m’engageai sur le chemin qui allait dans cette direction.
Guidé par des Taipi, je m’enfonçai avec mes amis dans les enchevêtrements d’hibiscus de la rive occidentale de la rivière, suivant des sentiers si encombrés de végétation que nous fûmes contraints de marcher à quatre pattes et de ramper en maintes occasions. À un mille de la plage, nous traversâmes la rivière sur le dos des Naturels qui se trouvèrent très satisfaits d’être récompensés de leur service par quelques portions de tabac que nous avions apportées dans ce but. Le reste du trajet se fit par des bosquets continus d’arbres à pain magnifiques et, après avoir traversé et retraversé la rivière de la même façon que précédemment, et parcouru deux milles et demi (* 4km), nous arrivâmes à la muraille.
Les Insulaires qui nous accompagnaient paraissaient parfaitement au fait du déroulement des opérations, et se firent un plaisir de nous indiquer la position des Américains et les lignes de défense des Insulaires, particulièrement un épaulement à l’épreuve totale des armes à feu ; en faisant des grimaces et des cabrioles enjouées, ils tentèrent de nous évoquer l’esprit du tableau original. Porter n’a aucunement exagéré les difficultés et les dangers de l’entreprise dans les compte-rendu qu’il en a publié.
Comme le Capitaine Finch ne nous avait pas autorisés à nous absenter au-delà d’une demi-heure ou trois quarts d’heure tout au plus, nous dûmes nous contenter (234) d’une observation restreinte de la structure qui semblait se poursuivre sur une longue distance en amont de la vallée ; à une personne non avertie de son rôle, cet ouvrage n’aurait été rien d’autre qu’une grosse muraille de pierres courant au pied ses collines et servant d’enclos.
À l’endroit où nous nous trouvions, nous ne remarquâmes rien qui ressemblât à la forteresse décrite dans le journal de Porter. À pas forcés, nous rejoignîmes nos compagnons à l’heure dite, et le navire, un peu plus tard.
Une forte rafale de vent descendue des collines de l’est provoqua la rupture d’un de nos câbles d’ancrage pendant la nuit ; nous fûmes ainsi privés de la présence tant appréciée du premier Lieutenant, Mr. Stribling, et du maître-voilier, Mr. Lardner, partis en quête de l’ancre et occupés à d’autres activités cruciales.
À neuf heures, le Lieutenant Magruder, le Docteur Wessels, les aspirants Kieth, Maury, Renshaw, Wurts et moi-même reprirent la direction de Hakapaa. Rentrèrent avec nous le Taua des Hapaa accompagné du prophète et du chef civil des Taipi qui, tout en lui rendant la politesse de sa visite, lui manifestaient ainsi la sincérité de leur désir de paix. Leur réunion à bord s’était déroulée dans la concorde et, après avoir dormi tous ensemble sous une tente dressée sur la dinette, sans aucune intervention de notre part, les Taipi exprimèrent le souhait d’aller jusqu’au terme de l’échange de civilités. Les femmes étaient rentrées chez elles la veille au soir.
La matinée se passa principalement à passer en revue les curiosités qui avaient attiré notre attention la veille.
Ayant appris d’un certain nombre de guerriers qu’une anfractuosité de la falaise à proximité permettait d’accéder à l’autre versant de la vallée donnant sur la zone neutre, j’entrepris de me rendre à pied à Hakahaa où je rejoindrais nos embarcations (235) se trouvant sur la plage de la baie centrale. Les aspirants Wurts et Maury se portèrent volontaires pour me suivre ; accompagnés de Te Ipu, le guerrier de Taiohae qui nous escortait, et guidés par Morrison, nous prîmes congé du chef et des villageois de la vallée et nous nous mîmes en route tandis que nos compagnons s’embarquaient pour retourner au navire.
La colline est une des plus escarpées que j’aie jamais escaladées, en maints endroits presque verticale ; on ne peut la gravir qu’en s’agrippant d’une pointe de rocher à une autre, ou en empoignant les branchages des arbustes et des buissons qui en recouvrent la surface. Sans l’influence rafraîchissante des alizés bloqués par les crètes au-dessus de nous, et avec la chaleur du soleil de midi qui nous heurtait de plein fouet, nous nous trouvions dans l’obligation de nous arrêter fréquemment afin de reprendre notre souffle. Mais la nécessité se fit soudain délice à la vue des recoins magnifiques et variés de notre petite vallée se dévoilant à chaque pas, ses humbles cottages, ses habitants candides, marchant nonchalamment le long de la rivière ou se remémorant, pensifs et indolents, l’agitation causée par notre visite, à l’ombre des palmiers dont les plumets se balançaient élégamment à nos pieds, en contrebas.
Après avoir gagné le sommet d’un des crètes rocheuses les plus hasardeuses, j’arrivai au sommet de la colline, en plein soleil. Au moment où je me retournai un court instant, je fus frappé d’admiration en découvrant dans le lointain une nouvelle scène à la beauté sauvage, une deuxième cascade, tombant dans un profond ravin qui bifurque sur le côté ouest de notre belle vallée. Elle se trouvait juste en face de moi, peut-être à une distance d’un mille, et à environ cent-cinquante ou deux cents pieds (* 45 ou 60m) en contrebas du rocher sur lequel je me tenais. La vallée de Tempé elle-même ne peut se targuer d’une telle beauté. (* La vallée de Tempé (en grec moderne : Témpi) est le nom donné par les anciens Grecs à la gorge creusée par le Pénée, entre le mont Olympe au Nord et le mont Ossa au Sud, pour s'ouvrir un passage de la plaine de Thessalie vers la mer. Les Ottomans l'appelèrent Boghaz (« défilé ») et les Byzantins Lykostomo (« Gueule du loup »). Wikipédia). C’est un torrent de montagne impétueux qui coule dans un vallon densément boisé, éclaboussant le regard de son flot enfoui sous la végétation et qui, d’une large trainée ininterrompue d’argent étincelant (236), depuis le sommet du précipice, se déverse d’une hauteur d’une centaine de pieds (* 30m) dans un magnifique bassin circulaire. Cette vasque est encerclée de bosquets épais, au feuillage si riche et si varié, allant de l’ombre dense de l’arbre-de-fer en pain de sucre jusqu’aux feuilles et aux fleurs blanchâtres du bancoulier, plus large et plus touffu ; le spectacle ressemblait plus au travail éclairé d’un arboriste de bon gout qu’à un paysage naturel. Par-dessus les arbres, notre regard descendit se poser sur la surface de ce bassin tranquille et ombragé. Eussé-je été un Grec païen, que la silhouette des Muses, seules dignes d’un tel havre, n’aurait pas manqué de m’apparaître se cachant à la fraicheur des recoins.
Un nombre considérable d’habitants du village avait suivi notre groupe, ajoutant à la scène une touche de romanesque. En-dessous de nous, certains s’accrochaient encore aux escarpements sinueux ; d’autres, à différents endroits au-dessus de nous, continuaient leur lente ascension, ou bien, comme nous, faisaient une pause au sommet d’un promontoire. D’autres encore, arrivés au terme du trajet, se tenaient sur la crète la plus élevée ; leurs silhouettes se détachaient contre le ciel et ils agitaient leurs capes pour nous encourager à les rejoindre. Certains commençaient à brandir et agiter leurs massues et casse-têtes en direction des Taipi se trouvant dans la zone neutre, faisant résonner l’air de cris de mépris et de défi à leur encontre.
À ce moment-là, nous vîmes nos canots déboucher de derrière le promontoire dans la partie centrale de la baie. Sur toutes les collines de la petite vallée que nous venions de quitter, on voyait, éparpillés ici et là, les vêtements blancs des insulaires que notre visite avait attirés au bord de mer, et qui rejoignaient lentement l’isolement alpestre de leurs modestes cabanes.
Depuis le sommet que nous avions enfin atteint, la vue des deux vallées, les montagnes à l’entour et l’étendue de la baie forment un spectacle d’une grande beauté : (237) particulièrement celui offert par la zone neutre qui s’enfonce profondément dans les terres, traversant
« Des aridités fleuries
Et des déserts féconds, des mondes de solitude,
Où le soleil sourit et les saisons s’écoulent, en vain,
Ignorés, dédaignés. » (* Poème d’origine inconnue)
Seule l’herbe recouvre la crète de ce promontoire qui offre une vue complètement dégagée dans toutes les directions. Je la remontai sur un peu plus d’un mille afin d’observer minutieusement, avec ma longue-vue, les deux territoires Hapaa et Taipi dont les richesses et les possibilités de développement satisfirent ma curiosité. Je les crois tout à fait capable de subvenir aux besoins d’une population dix fois supérieure à celle qui les occupe actuellement, probablement inférieure à huit mille habitants. Je regrettai que le temps me manquât pour prolonger mon excursion jusqu’au sommet de la montagne mais, apercevant nos bateaux s’approcher de la rive en contrebas, et craignant de voir mes compagnons s’impatienter, je lançai un regard d’adieu à ces scènes charmantes, et hâtai le pas, loin d’avoir satisfait ma curiosité et rassasié mon admiration.
La descente était presque aussi abrupte et difficile que l’escalade l’autre côté, mais nous parvînmes en bas sans encombre. Un grand tumulte agitait les Taipi rassemblés en bordure de mer, présage d’agissements scélérats. Plusieurs de nos messieurs avaient été prestement soulagés de différents biens personnels : un poignard dans le fourreau de l’un, un mouchoir dans la poche de l’autre, &c. Épuisé de chaleur et de fatigue, je m’arrêtai un moment au milieu de ce tohu-bohu cacophonique lorsqu’un des membres d’équipage, m’agrippant par le bras, me hissa sur son dos et me transporta à la chaloupe à travers le ressac ; néanmoins, j’avais bien senti deux ou trois belles tractions sur mon mouchoir, mais je n’avais pas oublié, parmi nos bons amis de ce pays, de le nouer à une boutonnière comme on me l’avait appris (238) aux îles Sandwich.
Nous fûmes bientôt rejoints par tous nos amis et, au terme d’une traversée à marée montante, nous étions de retour à bord du Vincennes sains et saufs.
__________
LETTRE XXXIV
DÉPART DE NUKUHIVA
USS Vincennes, en mer,
Le 13 août 1829
Mon cher H_______, on ne peut s’attendre à ce qu’un voyage autour du monde se passe sans incident ; et, dans la matinée du 11 courant, notre splendide vaisseau a bien failli disparaître corps et biens.
En tentant de sortir de la baie de Hooumi (* La Baie du Contrôleur), nous étions encalminés dans un fort courant qui nous portait sur la côte, et dans une eau trop profonde pour pouvoir y jeter l’ancre. Le ressac nous entrainait irrésistiblement contre les falaises de la « Tour de Roc » jusqu’à en effleurer les écueils. Le navire fonçait droit devant dans les brisants, et seuls les grappins lancés depuis la dunette sur la falaise nous évitèrent le choc qui aurait, inéluctablement, conduit à un naufrage qui, face à une roche dénudée, d’une hauteur d’une centaine de pieds (*30m), et dans une grande profondeur d’eau, n’aurait laissé apparaître que la tête des mâts au-dessus de la surface.
Pendant quelques longues minutes, à chaque soulèvement de la houle, nous nous attendions à voir le navire se fracasser dans un bruit terrible ; les visages étaient pâles de peur, et un silence de mort régnait sur le Vincennes. Les chefs de Taiohae se trouvaient en plein désarroi et, les larmes aux yeux, le guerrier Te Ipu serra soudain très fort le jeune prince Moana dans ses bras (239) et s’exclama : « Mate ! Mate oa ! Ke pahi nui manawa ! » « Détruit ! Complètement détruit ! La grande pirogue de guerre ! » (* De nos jours, navire de guerre se dit « manuā », de l’anglais « man-of-war ».) ajoutant plaintivement que nous serions tous dévorés par les Taipi. Puis, d’un coup, nos huniers s’enflèrent d’une brise de terre qui, en même temps qu’elle nous redonnait espoir, nous poussait triomphalement dans le souffle de l’alizé, vers la haute mer. Alors, s’approchant du Capitaine Finch d’un air défait, Te Ipu lui confia : « Si le navire de guerre avait été perdu, oh ! quel jour de larmes cela aurait été ! »
Nous rejoignîmes notre mouillage de Taiohae à douze heures le même matin, et passâmes la journée d’hier à faire notre stock de bois et d’eau douce.
Je ne descendis à terre que dans l’après-midi ; Mr. Stribling et moi-même allâmes nous promener du coté occidental de la vallée, remontant celle-ci par un vallon et la redescendant par un autre. Grâce aux précédentes excursions, je pus compléter l’examen du territoire entier de cette tribu. De notre randonnée, je peux sincèrement dire que :
« Les collines escarpées sur lesquelles, couronnés de fleurs sauvages,
Les rochers jaillissent des taillis ombreux et de recoins verdoyants ;
Où la nature exprime partout sa fougue,
Et, délicieusement luxuriante, prodigue ses milliers de pétales. »
(* Poème d’origine inconnue)
Nous rentrâmes au navire à la tombée de la nuit, juste à temps pour participer à la dernière distribution de cadeaux menée par le Capitaine Finch et nos officiers. Nous fîmes nos adieux aux chefs tandis qu’ils quittaient le navire pour la dernière fois, chamarrés de nos propres vêtements, emportant avec eux les dernières consignes de n’oublier aucun de nos conseils, de promouvoir et de maintenir la paix sur la totalité de l’île.
À huit heures, à la plus grande satisfaction des Naturels rassemblés sur le rivage, un feu d’artifice fut tiré depuis le navire, agrémenté de pétards et de feux de Bengale. À l’aube ce matin (240), nous levâmes l’ancre pour la dernière fois, et nous voici désormais en pleine mer, en route pour Tahiti.
Voilà, mon cher H_____, vous disposez maintenant d’un aperçu de ma quinzaine de jours passés aux îles Washington ; mes quelques dessins vous permettront aussi de vous faire une idée du caractère naturel des paysages qu’ils dépeignent, ainsi que de la physionomie, des us et coutumes, des principes moraux, de la religion et de l’état général des cinquante mille êtres immortels qui peuvent constituer la population de cet archipel.
Tout au long de mes observations du génie et de la condition des peuples, je me suis efforcé de rester impartial afin d’exposer fidèlement leur caractère authentique. Il faut en effet éviter de tomber dans le double piège que tend le sujet.
L’homme doté d’un bon sens moral, animé de la pureté de sentiment nécessaire à une piété sincère, s’expose, dans le dégout provoqué par une vision de débauche inévitable, à perdre de vue les aspects agréables et estimables de la nature et de la condition des habitants, et de ne prendre en considération que leur déviance morale et leur bassesse qui, par certains aspects, sont sans égales.
D’un autre côté, l’homme infâme et dépravé, qui porte un œil bienveillant sur ces iniquités, ou les voile de son indulgence fraternelle, risque de faire croire au monde qu’il n’y a pas homme plus heureux que ces peuples, que leurs îles sont semblables aux Champs élyséens (* Dans la mythologie grecque et romaine, les Champs Élysées, Champs Élyséens, ou simplement l’Élysée, sont les lieux des Enfers ou du séjour des morts où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur trépas. Wikipédia), que leurs habitants forment une race exempte des plaies ordinaires de la vie, et qu’ils passent leur temps en joies interrompues dans l’insouciance, ignorant les peines, l’anxiété et les préoccupations journalières.
J’ai bien pris soin d’éviter ces deux extrêmes, et je vous ai présenté des faits bruts qui permettent de prouver avec pertinence que si, d’une part, les paysages naturels peuvent indubitablement être qualifiés de « magnifiques sous tous rapports » (241), les insulaires possèdent des qualités physiques et mentales bien supérieures à celles des Naturels des autres parties du monde. En général, au sein de leurs familles et envers les étrangers de passage, ils entretiennent des relations sociales d’amitié et de cordialité. D’autre part, hélas, ils sont bien loin d’être exempts de la dépravation causée par les multiples et déplorables plaies du paganisme.
Le système obscurantiste qui constitue leurs croyances religieuses, la cruauté des rites qu’elles inculquent et approuvent, les conduit littéralement à subir le joug de la crainte tout au long de leur vie. Leur complète ignorance des principes moraux de bien et de mal les condamne à une débauche effrénée, et à commettre presque tous les péchés. En plus de leurs autres qualités malsaines, il faut mentionner sans restriction la tromperie, la traitrise, leur soif de vengeance, le plaisir qu’ils prennent à faire la guerre, piller, et à se délecter de la chair de leurs compatriotes. Les seuls fléaux dont le paganisme semble les avoir épargnés sont l’infanticide et le parricide. Si telle est la situation, je demande au philanthrope et au chrétien si ces gens n’aspirent pas à la puissance rédemptrice de la lumière ? N’ont-ils pas besoin d’être préparés à la pureté et à la bénédiction du Monde à venir ? D’où leur viendront la force nécessaire et les moyens de leur assurer ce cheminement tant désiré ?
Dans le travail d’observation qu’il nous reste à conduire dans les Mers du Sud, je suis profondément convaincu de ce que les évènements à venir parleront d’eux-mêmes en faisant la preuve indéniable que la PAROLE RÉVÉLÉE DE DIEU et que l’ÉVANGÉLISATION ININTERROMPUE, parce qu’ils sont adéquats, sont les seuls moyens d’atteindre cet objectif de glorieuse miséricorde. Avec la ferme conviction, basée sur l’histoire et les écritures, que la connaissance de la « Lumière de Vie » est le moyen le plus sûr et le plus direct (242) d’améliorer la condition humaine, unique vecteur du salut de l’âme, le seul appel que je lancerais, le seul qu’il soit nécessaire d’adresser au cœur des chrétiens, au nom de cette race digne d’intérêt mais si contaminée, résonne en écho à l’hymne missionnaire de Heber :
« Nous dont les âmes sont éclairées
De sagesse depuis les cieux,
Allons-nous dénier aux ignorants
Le faisceau de vie ?
Salut ! Ô Salut !
Proclamez ce mot joyeux
Tant que la nation la plus reculée
Ne connait pas le nom du Messie. »
(436) ANNEXE
Note : En 1833 et 1833, des missionnaires américains de Hawaii essayèrent, en vain, d’évangéliser Nuku Hiva. Grâce à leurs rapports, néanmoins, particulièrement ceux de William Alexander, on sait que Haape était toujours là, et Morrison aussi. Le premier mourut de mort naturelle le 5 décembre 1883, et le second, le lendemain, d’une crise cardiaque et d’étouffement.
MANUSCRIT LAISSÉ À NUKU HIVA PAR LE CAPITAINE FINCH
(* Probablement à Morrison à l’intention des prochains navires)
« Le navire USS Vincennes ayant fait escale dans les ports de Taiohae et Hooumi, tous deux sur l’île de Nuku Hiva, y ayant passé quinze jours, et me trouvant sur le point de mettre les voiles, je tiens à informer les prochains visiteurs qu’à mon arrivée, j’ai été fortement sollicité pour fournir des mousquets, de la poudre, des silex et autres munitions et armes de guerre, mais que je me suis abstenu d’accéder à ces requêtes dès que j’appris l’état de guerre qui régnait entre les différents clans. (La baie de Hooumi est très étroite et périlleuse ; il est aussi difficile d’y entrer que d’en sortir. Avec mes officiers, je suis allé visiter en canot les baies de Hakapaa et de Hakahaa)
« Les chefs et les Naturels se sont avérés serviables mais parfois pénibles du fait du grand nombre désireux de monter à bord ; notre patience et notre tolérance en ont été mises à rude épreuve. Néanmoins, personne ne fut autorisé à passer la nuit à bord.
« J’ai rencontré les principaux chefs de quatre tribus. J’ai eu des entretiens avec eux et je leur ai recommandé de faire la paix entre eux. Je leur ai pointé du doigt leurs qualités générales, individuelles et locales. Je les ai encouragés à être corrects et justes dans leurs relations avec tous les étrangers, particulièrement les navires de commerce, et ils ont promis de suivre fidèlement mes recommandations.
« Nous avons fait nos réserves de bois et d’eau, tout comme un navire de commerce français nommé la Duchesse de Berry, dont le capitaine adopta le même comportement (437) que nous concernant les relations avec les chefs et autres Naturels. Il est arrivé un ou deux jours après nous, et a repris la mer il y a quelques jours seulement.
« En échange du bois, de l’eau, des porcs, des noix de coco, des fruits à pain, &c., nous avons distribué des cotonnades simples et des teintées, de haches, des couteaux, des gouges, des limes et autres outils utiles ; de même que des peignes, du tabac et de vieux vêtements.
« Je n’ai eu vent que de quelques exemples de vol ou de malhonnêteté, et principalement lorsque nous étions chez les Taipi.
« Bien que nous ayons été reçus et traités avec cordialité, je recommande vigilance et circonspection envers les Naturels auxquels on doit accorder sa confiance avec prudence.
« Un homme très convenable et bien élevé, nommé William Morrison, qui est complètement familier de la langue locale, nous a été d’un grand secours dans toutes nos transactions. Il collecte le bois de santal.
« Haape est le plus grand propriétaire terrien de la baie de Taiohae dont il est le chef ; il est aussi régent et tuteur de Moana, le jeune orphelin, héritier légitime du titre de roi ou de grand chef de l’île toute entière qui lui reviendra, je pense, quand il en aura atteint l’âge. »
W.C.B. Finch, Nuku Hiva, le 11 août 1829
Traduction de Jacques Iakopo Pelleau, achevée le 01/08/2021
Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 27/08/2022.
BIBLIOGRAPHIE
*- Crook, William Pascoe - Récit aux îles Marquises, 1797-1799 ; traduit de l’anglais par Mgr Hervé Le Cléac’h, Denise Koenig, Gilles Cordonnier, Marie-Thérèse Jacquier et Deborah Pope-Haere Pō-Tahiti-2007
*- Delmas, Père Siméon, « La Religion ou le paganisme des Marquisiens », éditions Beauchesne, Paris, 1927. « Histoire de la Mission des îles Marquises, 1838-1881, Paris, 1929, 358 p. »
*- Krusenstern, Adam von : « Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 », Paris, 1821/ Hachette - BNF
*- Porter, Commodore David, « Nukuhiva, 1813-1814 ; le Journal d’un corsaire américain aux îles Marquises », éditions Haere Pō, Tahiti 2014.